
Alex Taylor et David Joy, la voix des sans-voix

Deux nouveaux romans, et romanciers, confirment que la littérature américaine aime à donner une voix aux sans-voix. Un goût pour les trous perdus et les laissés-pour-compte, qui continue de nourrir les grands néo-polars ruraux.
William Faulkner, déjà, avait mis la barre haut. Ou plus exactement au nord-est du Mississippi, dans le comté de Yoknapatawpha, bled imprononçable et d’ailleurs fictif. Une « terre fendue » dans la langue chickasaw, où le prix Nobel de littérature de 1949 situa l’essentiel de ses intrigues et de ses personnages, du Bruit et la Fureur en passant par Absalon, Absalon! Un morceau d’Amérique oublié de tous, occupé par quelques-uns, et où il ne se passe guère autre chose que des catastrophes naturelles ou sociales. Un cul-de-basse-fosse où pourtant, William Faulkner pensait avoir capturé une certaine âme américaine, loin, très loin, de ses métropoles gargantuesques, de leurs downtowns sevrés de modernisme et de réussite, et d’une middle ou high class pourtant érigée en modèle par le rêve américain. Un sillon mêlant petites gens et grande littérature américaine, entamé par l’un des plus importants auteurs de ce pays plus vaste que l’Europe, et creusé depuis par des générations d’écrivains US sous bien des formes littéraires, mais dont le néo-polar semble être devenu la norme. Un genre dans le genre pourtant né en France après Mai 68, mêlant intrigues policières, milieu rural et questionnement sociétal, le tout porté par des écritures enfin dignes de ce nom, mais qui a trouvé dans l’immensité des États-Unis suffisamment de bons auteurs et de bleds vraiment perdus pour fleurir mieux qu’en France -laquelle ne semble plus en cette rentrée littéraire avoir grand-chose à montrer dans ce style-là, pourtant puissant. Tout le contraire des USA, qui viennent encore de nous offrir deux nouveaux et premiers romans remarquables, et d’ailleurs remarqués en ces temps de saturation. Chacun dans leur style, et leur coin d’Amérique, Alex Taylor et David Joy viennent de s’inviter à la table des grands romans rednecks.
Rififi au Kentucky
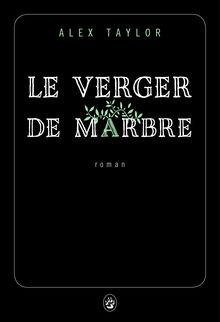
Le Verger de marbre vaut à son jeune auteur Alex Taylor, jusqu’ici inconnu, d’être déjà comparé à Cormac McCarthy (De si jolis chevaux, La Route), à Daniel Woodrell (Un hiver de glace) ou encore à Donald Ray Pollock (voir encadré plus bas), pour la puissance, la noirceur et la ruralité de son roman noir à l’intrigue apparemment simpliste, mais qui s’avère d’une profondeur rare. Beam Sheetmire, jeune gars de 17 ans ni très malin ni très énergique, aide parfois son père à faire fonctionner le misérable bac sur lequel ils font traverser la Gasping River aux rares habitants et passants de ce coin très, très perdu du Kentucky. Une vie de labeur morose et sans perspective, qui tourne soudain au drame: Beam tue un soir de pluie un passager qui menaçait de le détrousser. Passager qui n’est autre, et pas seulement, que le fils du caïd du coin. Beam va donc fuir, croisant sur son chemin de croix les personnages secondaires les plus forts et tordus qu’on ait lus depuis longtemps: un barman manchot, un routier christique, un sauveur grabataire et sa vieille fille de fille, plus forte que tous les autres déglingués réunis… Autant de personnages issus autant du Kentucky profond que de la tragédie grecque, donnant à cette intrigue simple, presque cliché, la profondeur d’un grand roman sur l’inéluctabilité de la poisse, l’injustice des vivants et le goût des ténèbres. Alex Taylor y déploie, aussi, surtout, une langue d’une richesse inversement proportionnelle à celle de ses personnages, lesquels sont tous, sans exception, servis par une prose certes boueuse, mais qui transcende leurs conditions sociales, culturelles ou humaines. On ressort lessivé de ce cimetière des espérances qu’est ce Verger de marbre, mais convaincu aussi d’avoir vu naître un grand auteur, plus qu’à sa place dans l’exigeante collection « néo-noir » de Gallmeister, qui vise justement à mettre en avant de grandes voix américaines ayant les pieds bien sur leurs terres.
Crise à The Creek

Autre prose et autre cul du monde pour David Joy. Dans Là où les lumières se perdent, cette fois chez Sonatine, c’est dans une région retirée des Appalaches, en Caroline du Nord, et baptisée The Creek, que le jeune auteur installe son intrigue et les protagonistes de son drame plus suburbain et forestier que rural. On va y suivre, le coeur effectivement serré, les non-choix qui se présentent à Jacob, 18 ans: partir enfin de ce trou et essayer de se construire une vie ailleurs, autrement. Ou rester dans l’ombre et le business de son dingo de père, prince de la fabrication et de la distribution de crystal meth dans la région, seule manière, avec l’alcool, de s’en échapper de temps en temps. Servi là aussi par une langue riche et lyrique, Là où les lumières… ne fait jamais l’impasse sur l’extrême violence de cet environnement suburbain -de la toxicomanie de la mère à la brutalité du père, en passant par l’absurdité des systèmes de valeurs mis en place par les Rednecks du cru, qui va broyer un gamin pourtant armé pour s’en sortir: « J’avais été chié par une mère accro à la meth qui venait juste d’être libérée de l’asile de fous. J’étais le fils d’un père qui me planterait un couteau dans la gorge pendant mon sommeil si l’humeur le prenait… »
Drame familial plus qu’intrigue policière, et formidable plongée dans la complexité des sentiments d’un jeune homme en quête de ré- demption, LE thème de la littérature américaine moderne, Là où les lumières se perdent use du microcosme de The Creek pour embraser un propos autrement plus vaste, et universel, à voir la rapidité avec laquelle il se retrouve désormais et déjà traduit entre autres en français. Au jeu des comparaisons, ce premier roman de David Joy en rappelle lui aussi d’autres du même sillon: Tom Drury pour la verve presque poétique, Frank Bill pour la crudité extrême de la violence décrite, Daniel Woodrell encore pour l’empathie qu’il parvient à faire vivre aux lecteurs, face à des personnages que pourtant rien ne semble pouvoir sauver, et certainement pas eux-mêmes. Et ici aussi, cet impossible rêve d’ailleurs donne à voir une galerie de déglingos plus proches du théâtre burlesque que de l’Américain moyen. Mais qui en disent long sur les paradoxes et les échecs d’une société qui ne réfléchit plus, contrairement à ses écrivains, à ses contradictions: « Je viens de Jackson County, la région de Jacob, et des Jacob, j’en ai connu des centaines dans ma vie », résumait récemment l’auteur dans une de ses interviews américaines. « J’ai grandi avec des gamins comme lui, cherchant désespérément un quelconque signe d’espoir malgré leurs circonstances de vie. Je voulais suivre le fil de ce minuscule espoir. Écrire un vrai thriller « page-turner », mais aussi proposer un vrai voyage dans l’âme humaine ». Une ambition qui remonte à loin et à Faulkner, d’une remarquable vivacité.
Le verger de marbre, d’Alex Taylor. Éditions Gallmeister. Traduit de l’anglais (USA) par Anatole Pons. 288 pages. ****(*)
Là où les lumières se perdent, de David Joy. Éditions Sonatine. Traduit de l’anglais (USA) par Fabrice Pointeau. 320 pages. ****
Les raisins de la colère, de John Steinbeck

Violence, religion et petit peuple en souffrance: si Les Raisins de la colère écrit en 1939 tient avant tout du chef-d’oeuvre plus que du néo-polar, tous les ingrédients y sont pour influencer des générations entières d’écrivains américains, déjà soufflés par Faulkner: Steinbeck y décrit par le menu mais aussi avec une langue sublime l’exil sur la Route 66 de milliers de « Okies » vers la Californie, tous ruinés par le Dust Bowl puis par la Grande Dépression. Steinbeck s’y met dans les traces de Tom Joad et de sa famille et ne leur épargne aucune souffrance ni catastrophe. Tragédie grecque dans l’Amérique rurale et ouvrière, ses Raisins restent une oeuvre majeure et l’un des plus grands livres sur la terrible réalité du rêve américain, et de ses laissés-pour-compte.
1275 âmes, de Jim Thompson
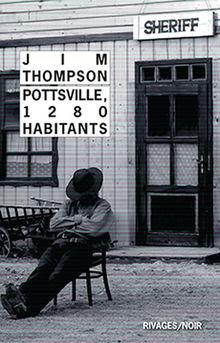
Le trou perdu, version grandiose. A-t-on jamais mieux décrit et sans doute aimé les bouseux que dans 1 275 âmes, l’oeuvre la plus connue de Jim Thompson? C’est en 1964 que paraît ce polar féroce, presque burlesque, qui fait de Potts County, l’un des plus petits comtés du Texas, le coeur du monde des romans noirs américains. Derrière son intrigue de tueur en série tordu dans un bled qui ne l’est pas moins, lui-même peuplé d’individus qui le sont encore plus, Thompson donne à palper la condition humaine d’hommes retirés du monde des hommes. Chef-d’oeuvre absolu longtemps charcuté dans ses versions françaises -Potts County comptait 1 280 habitants dans sa version d’origine, avant la traduction aujourd’hui très contestée de Marcel Duhamel, qui en fit tout de même le numéro 1 000 de sa Série Noire- Rivages l’a heureusement réédité cette année dans sa version intégrale, sous le nom Potsville, 1 280 habitants. Dont acte.
Le Diable, tout le temps, de Donald Ray Pollock
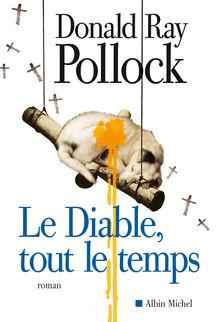
Il y a quatre ans, déjà, que Donald Ray Pollock, jeune écrivain de 57 ans après 27 d’usine de pâte à papier, mettait tout le monde d’accord et d’équerre derrière son Le Diable, tout le temps, plongée infernale et remarquablement écrite à Knockemstiff, Ohio, moins de 400 âmes en 1957, dont « presque toutes étaient liées par le sang. Tout ce que les gens mangeaient, c’était du gras, et encore du gras. » D’emblée propulsé au rang de stars du Southern Ohio Gothic à la Harry Crews, Pollock recrée lui aussi une ambiance de tragédie grecque dans un milieu rural, pauvre et d’une extrême violence. Rendez-vous est pris, ici aussi, pour son nouveau roman, Une mort qui en vaut la peine, édité le mois prochain chez Albin Michel.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici