Apres le remarqué Comme un ciel en nous, consacré à son père, Jakuta Alikavazovic revient avec le superbe Au grand jamais, cette fois sur la figure de la mère.
Au grand jamaisde Jakuta Alikavazovic
Gallimard, 256 p.
La cote de Focus: 4/5
La mère de la narratrice vient de mourir. Ex-poétesse reconnue dans son ex-Yougoslavie natale, elle avait soudain arrêté d’écrire. Elle-même écrivaine et mère à son tour, la narratrice va enquêter pour résoudre «l’énigme qu’est une personne». Beaucoup se le demandent: roman pur ou autobiographie? «Une seule goutte de fiction suffit à faire roman», répond l’écrivaine. D’ailleurs, les pages sur la jeunesse de la mère au sein d’un groupe de poètes, passionnantes, ne jureraient pas dans un roman de Roberto Bolaño. Plus loin, le texte lorgne cette fois le fantastique et les histoires de fantômes slaves du dernier William T. Vollmann (Dernières nouvelles et autres nouvelles). Plus qu’un énième «roman familial», Au grand jamais est un texte libre et virtuose sur la transmission, le temps qui passe et, bien sûr, la littérature. A peine terminé, on meurt d’envie de le relire.
Un peu rapidement rangé au rayon très tendance des romans familiaux, Au grand jamais éblouit par son style et la profondeur des questions qu’il couvre. Dans ce livre salué par la critique et sélectionné pour le prix Femina, Jakuta Alikavazovic paraît au sommet de son art. Après plusieurs livres de «fiction pure», dont les remarqués Le Londres-Louxor ou L’Avancée de la nuit, elle semble s’engager dans une veine plus autobiographique. Son texte précédent, Comme un ciel en nous (prix Médicis essai 2021), publié dans la célèbre collection «Ma nuit au musée» des éditions Stock, s’attachait déjà à des motifs plus personnels: sa nuit au Louvre était prétexte à raviver les souvenirs de ses visites d’enfance avec son père –clin d’œil à l’actualité, il y était aussi question d’un hypothétique cambriolage du célèbre musée…
Avec Au grand jamais, elle s’attache cette fois à la figure de la mère. Si elle balaie d’un revers de main le terme d’«autobiographie», elle raconte dans le livre, semblant par endroits s’écrire sous nos yeux, avoir réalisé que sous cette fiction supposément «pure», sa vie avait en fait toujours servi de «matériau» pour ses romans. Entre la guerre, l’émigration, cette mère poétesse qui s’arrête soudainement d’écrire, mais qui s’ingénie à transmettre un énigmatique «don familial»… En voilà, en effet, de la «matière première» pour encore une fois déchaîner d’intrigants pouvoirs de la littérature.
Quel fut le point de départ d’Au grand jamais? Ce texte s’est-il imposé à vous?
C’est un livre qui a connu plusieurs vies. J’ai commencé à y penser en 2013, peut-être même avant, et j’ai publié d’autres choses entre-temps. Il s’est imposé avec le temps, je dirais.
Vous parlez de «fiction autobiographique» pour ce nouveau roman, comme si vous vous interdisiez presque d’écrire ouvertement sur votre famille. Est-ce le cas? Et pourquoi y avoir plonger malgré tout?
Je ne m’interdis rien. Du moins, pas en ce qui concerne l’écriture. J’insiste sur la «fiction» pour rééquilibrer le rapport de force, qui à notre époque favorise le côté «autobiographique». La vie –ma vie– est devenue un matériau pour moi, c’est vrai. Une matière première, disons. Il se trouve que l’histoire de ma famille est marquée par la guerre et l’émigration. Aujourd’hui, je pense que ces deux sujets ont une importance particulière pour l’Occident, et que ce qu’on appelle la «petite» histoire éclaire la «grande». Par ailleurs, raconter une histoire vraie, c’est toujours la réinventer, qu’on en ait conscience ou non, qu’on l’assume ou pas. Moi qui suis avant tout romancière, j’embrasse cette liberté, et j’insiste sur cette dimension créatrice, parce qu’elle me semble belle et juste.
«La vérité n’est pas dans les faits, dans l’intrigue ou le sujet, mais dans l’atmosphère.»
Dans le texte, vous citez certains de vos livres précédents. Comme si vous réalisiez, en écrivant, que vos origines ont en réalité déjà été présentes dans votre œuvre.
Je crois que les origines affleurent, qu’on le veuille ou non. Mes premiers romans, que j’imaginais être des fictions pures et dures, sont à leur façon extrêmement biographiques. Simplement, la vérité n’est pas dans les faits, dans l’intrigue ou le sujet, mais dans l’atmosphère. Ecrire un roman triste plutôt qu’un roman heureux, ou un roman heureux plutôt qu’un roman triste, c’est déjà dire quelque chose de son rapport à l’origine… On écrit chaque livre comme s’il était le seul, comme s’il était l’unique. Entièrement neuf. Mais avec le temps, on se rend compte qu’on est traversé par des thèmes, des images, des obsessions qui reviennent. Que chaque livre menait au suivant. Moi, je suis écrivain, ça signifie que mes origines sont avant tout dans mes livres –et dans les livres, au sens large.
Vous parlez, à propos d’un vers que la narratrice pensait venir d’un poème de sa mère, d’une «dette imaginaire» qu’elle aurait contractée envers elle. Pense-t-elle lui devoir ce livre? Et y a-t-il eu, même inconsciemment, une volonté, en quelque sorte, de poursuivre l’œuvre de la mère?
Je ne me prononce pas sur l’inconscient des personnages, ni d’ailleurs sur celui des personnes réelles: chacun a droit à son secret. Disons que les œuvres et les idées circulent, de façons qui parfois nous échappent.
Le texte paraît très libre, et il semble y avoir des dizaines de réjouissants départs de romans à l’intérieur du roman, comme lorsque vous parlez de ce groupe de poètes dont la mère faisait partie ou de son hypothétique passé d’espionne. Comment cela vous est-il venu? Y puiserez-vous le sujet d’un prochain roman?
Ma liberté et mon temps sont mes seules richesses, donc le compliment me touche. Merci! Pour le prochain roman, je ne sais pas, je crois que c’est lui qui viendra puiser en moi; je sais d’expérience que je serai la première surprise…
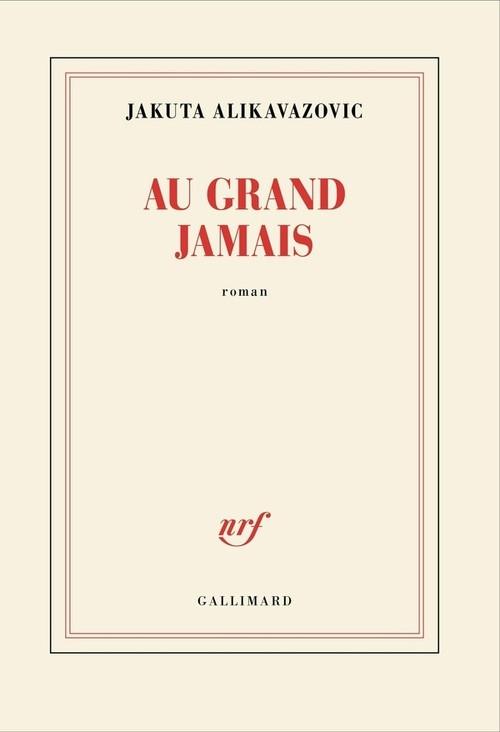
Cette apparente liberté donne une impression de fluidité et même de virtuosité, laissant imaginer que vous avez éprouvé, malgré la gravité et le sérieux de certains passages, du plaisir à écrire ce texte.
Oui, ce fut du plaisir. Ce plaisir, en écrivant, est même un indice fort d’être sur la bonne voie. C’est l’autre nom d’une forme de justesse –c’est de sentir que c’est «juste» qui est réjouissant. Et puis, malgré la gravité historique de certains chapitres, c’est un livre plein d’amour, d’humour et d’espoir.
Des médias ont lourdement insisté sur le nombre élevé de romans consacrés à la famille lors de la rentrée littéraire 2025. Cela vous a-t-il irritée?
Je trouve un peu dommage de réduire les livres à leurs thèmes. Ecrire sur un sujet –que ce soit un membre de sa famille, une expédition spatiale, un cheval mort ou une fenêtre cassée–, c’est toujours écrire sur le monde. Et en écrivant sur le monde, on le crée, on le recrée, on le prolonge. Ou on le contredit, et parfois même on le corrige.
