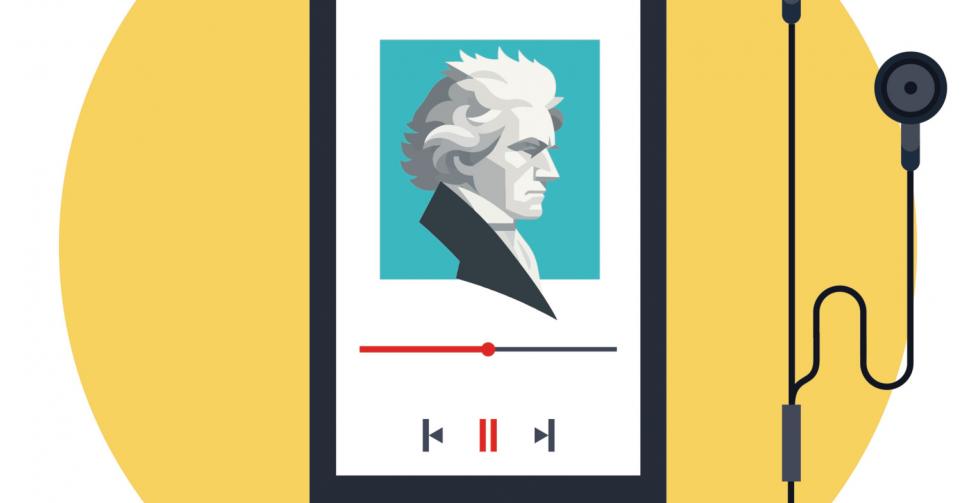Hier fidèles à leurs vastes discothèques, les mordus de classique, derniers réfractaires, cèdent aujourd’hui aux sirènes du streaming. Hélas au détriment de musiciens et de maisons de disques dont trop de plateformes ignorent encore les besoins spécifiques.
Plus la vente de galettes à la pièce s’effondre au profit de forfaits tout compris sur des plateformes rétribuant la musique classique au même tarif que les divas des charts –c’est-à-dire en fonction de leur part de marché dans le panier total–, plus le secteur, déjà marginal, souffre financièrement. Logique. La faute à «un système de rémunération des ayants droit remontant à une époque où une même typologie de streamers écoutait un même type de musique: les jeunes amateurs d’électro, écoutant compulsivement une même piste», explique Didier Martin, directeur général du distributeur et producteur franco-belge Outhere. Loin, donc, des habitudes des fans de classique qui, même lorsque leur obsession du moment se fixe sur un seul morceau, aiment plutôt comparer les versions. C’est là un problème que ne pose aucun autre genre musical.
Car si un tube du domaine public peut encore rapporter gros, les recettes s’émiettent entre les ayants droit des gravures écoutées –ils sont parfois des dizaines, voire des centaines. Pour ne rien arranger, «les algorithmes dictent une loi qui ne tient pas compte des différentes interprétations d’une même œuvre», ajoute Didier Martin. Mieux vaut en effet être le bénéficiaire de la version qu’une requête basique mettra en avant. D’autant que, puisqu’on ne prête qu’aux riches, les recommandations automatisées favoriseront ensuite les réalisations de l’exécutant élu au lieu d’orienter vers d’autres lectures du morceau. Certaines restant difficiles à trouver, même en sachant ce qu’on veut, faute de soin ou de facilité de recherche du côté métadonnées (nom du compositeur, titre, artistes, date de sortie, etc.).
Lire aussi | L’âge d’or du streaming déjà terminé?
Fuite en avant
Crise du disque? S’il entend la rengaine depuis longtemps, le mélomane reste gâté: chaque vendredi, jour de sortie, une pluie de nouvelles parutions inonde la page d’accueil des plateformes. Blockbusters –The Disney Book de Lang Lang, John Williams in Vienna ou autres «néo-classiques, genre Canada Dry, qui atteignent des scores faramineux», constate le patron d’Outhere–, mais pas seulement. Loin s’en faut. Et les indépendants aventureux bien plus que les majors friandes de ces produits marketés aux petits oignons. Dépoussiérage d’œuvres baroques, sauvetage de compositrices dans les oubliettes de l’histoire, albums-concepts tous azimuts, on produit à tour de bras. N’empêche. Si les artistes pouvaient jadis espérer quelques royalties bienvenues, entrer en studio frise désormais le bénévolat. Lorsqu’ils n’y vont pas de leur poche. Alors à quoi bon?
Pianiste entendu sous pavillon Cyprès et voix bien connue des auditeurs de Musiq3 (Ça vient de sortir, Table d’écoute), Pierre Solot y voit une volonté de s’inscrire dans une tradition, «parce que les grands aînés enregistraient», et une «angoisse plus psychologique par rapport au temps qui passe, ce qui suscite l’envie de laisser une trace en tant qu’interprète». Il observe surtout que ces publications «créent une activité médiatique sur base de laquelle il est ensuite possible de construire une tournée de concerts. Pour l’artiste, le CD n’a pas besoin d’être rentable: les concerts le seront. Ce qui renverse parfois les choses. Aujourd’hui, on immortalise éventuellement des morceaux que l’on joue pour la première fois avant d’ensuite les «rôder» en public. L’interprétation évolue ainsi en cours de route, mûrit, là où le résultat du disque, même très bien préparé, reste plus immature qu’à l’époque où on gravait les choses après les avoir longuement éprouvées sur scène.»
«Les algorithmes ne tiennent pas en compte les différentes interprétations d’une même œuvre.»
Pay-per-track vs. pay-per-second
Il faut cependant que les éditeurs s’y retrouvent. Or, tout en écoulant encore un pourcentage de galettes physiques, fût-ce sous la forme de luxueux coffrets pour collectionneurs, leurs recettes viennent de plus en plus de ce que les plateformes redistribuent. Donc peu de choses, même de la part des mieux intentionnées. Pionnière française dans le domaine du classique –avec une offre aujourd’hui élargie à tous les genres–, Qobuz fut le premier service de streaming à miser sur le haut de gamme. Avec des morceaux en haute résolution et du contenu rédactionnel inédit, la société fondée en 2007 donna le ton. Avec un coût: pas de modèle freemium se finançant par la publicité, mais une approche qui évite «la dévaluation de la musique et assure une croissance durable du secteur. Cela se traduit par des paiements plus élevés aux ayants droit et, par extension, aux artistes», promet Xandrie, propriétaire du service depuis 2015. Soit, en chiffres pour l’année 2024, 18,02 euros versés par tranche de 1.000 écoutes –fameux plafond sous lequel Spotify ne rend, elle, pas un sou. Cinq fois plus que les concurrents les plus chiches, mais peanuts pour les acteurs du secteur.
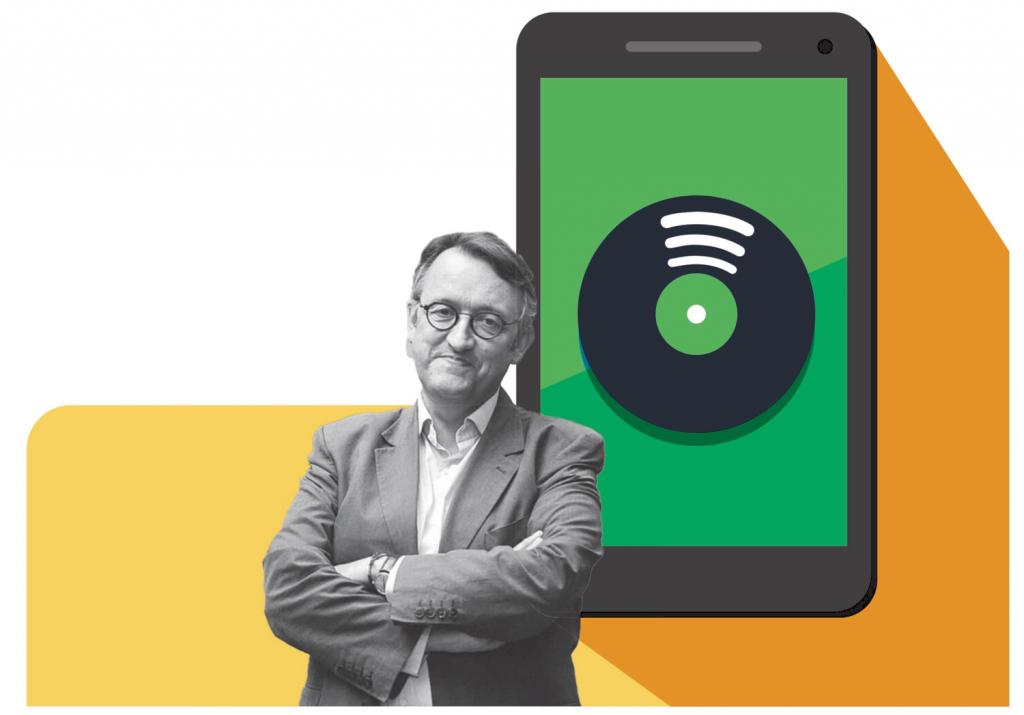
« Une solution? Les plateformes de streaming spécialisées dans le classique avec de vraies politiques éditoriales et une rémunération équitable. Mais leur modèle économique reste très fragile», note Didier Martin. Parmi ces services de niche, Presto Music, disquaire et distributeur basé près de Warwick (Royaume-Uni), se lance dans le dématérialisé en mars 2023, une semaine après le début de la campagne annonçant l’application dédiée d’Apple. Presto Music tire son épingle du jeu en communiquant sur un système de rétribution basé sur l’écoute à la seconde plutôt qu’à la plage –celui également pratiqué par l’Allemande Idagio: «La durée des œuvres varie énormément. Une symphonie de Mahler dure souvent plus d’une heure pour seulement quatre pistes, alors qu’un enregistrement des Variations Goldberg en couvre généralement 33 en moins de temps. Ce qui explique que, sur d’autres services, une seule écoute de l’album Bach génère huit fois plus de revenus qu’une audition de l’œuvre de Mahler», commente Chris O’Reilly, CEO du site anglais. A l’heure de faire les comptes, les appointements semblent effectivement multipliés par sept ou huit comparés à ce que propose Qobuz. Mieux, mais toujours pas assez.
Les nababs exploitent surtout les fonds de catalogues. Peu les nouveautés.
Classique à deux vitesses
Aux labels de s’adapter pour survivre. Si certains projets d’indépendants sont éligibles à subvention tandis que d’autres se montent en coproduction ou se financent par crowdfunding, les majors médiatisent des virtuoses que le crossover ou l’easy listening ne rebutent pas –«L’argent fait tout», chante la Marceline des Noces de Figaro. Reste alors à espérer qu’une plage de tel violoncelliste revisitant Piaf ou la B.O de La Boum se retrouvent en tête d’une playlist populaire. Pour le reste, les nababs exploitent surtout les fonds de catalogues. Les leurs et ceux rachetés à tour de bras. Ainsi, passée dans le giron d’Universal en 2023, l’anglaise Hypérion, pourtant bénéficiaire et jusqu’alors absente des plateformes, les alimente désormais comme les autres. Merveilleux pour l’oreille gourmande, moins pour le mélomane gourmet: aucune chance que le nouveau propriétaire, à la stratégie seulement comptable, poursuive vraiment la ligne pour happy fews des Londoniens. Les nouveautés ne viennent plus qu’au compte-gouttes.
Aux premières loges, Didier Martin constate les dégâts: «Les états-majors des grands labels ont les yeux rivés sur les chiffres et ne veulent plus enregistrer d’opéras, de récitals lyriques, voire de symphonies ou de concertos… Il y a bien sûr des exceptions, mais je crains un vrai changement de paradigme et de politiques artistiques des acteurs du classique. Aujourd’hui, trouver un label pour une jeune voix relève du défi –je reçois des dizaines de propositions chaque mois. Même dans le domaine du piano, « roi du streaming », on voit que nombre de virtuoses ne gravent plus les concertos de Rachmaninov, mais préfèrent enregistrer des compositeurs baroques ou classiques sur instrument moderne, avec un storytelling adapté aux réseaux sociaux.» Ce qui rajeunira –et donc renouvellera– le public, dont le goût se raffinera ensuite? Affaire à suivre.