Dans Mes petites morts, Frédéric Roux revient à la boxe. Un recueil de nouvelles dans les coulisses des rings qui figure parmi notre sélection livres du moment.
Mes petites morts
Nouvelles de Frédéric Roux. Editions Allia, 112 pages.
La cote de Focus: 3,5/5
«Ecris sur ce que tu connais», déclarait Faulkner. Un conseil suivi à la lettre par Frédéric Roux. S’il excelle dans le récit familial (Mal de père) et le faux roman d’aventure (L’Hiver indien), l’ancien boxeur amateur devenu journaliste et écrivain ne s’éloigne jamais très longtemps des rings, ce carré de 6,10 mètres de côté où la nature humaine zigzague entre grandeur et disgrâce. Pour ce nouveau round, l’auteur de Lève ton gauche a choisi la forme courte. En cinq nouvelles sèches et nerveuses comme un direct du droit, son alter ego François, ou Macho Man, immerge le lecteur dans les coulisses de ce monde de sueur, de larmes et surtout de désillusions.
Flamenco Blues, qui ouvre le bal, voit ainsi défiler son lot de boxeurs maudits dont les rêves de gloire se fracassent au premier combat. Ou même avant, la trouille les faisant parfois fuir. Et même lorsque les planètes semblent s’aligner, comme pour «Sa Majesté Gipsy le King», la dérouillée qui fracasse la silhouette et l’honneur n’est jamais loin. Sparring partner occasionnel de ces candidats à la gloire, le journaliste sportif les jauge, détaille leurs points forts et leurs faiblesses, mais surtout documente une forme de disparition. Disparition des capacités physiques, de la rage de gagner du champion (Pâques en octobre). Voire disparition de la reconnaissance. Spécialiste de Mohamed Ali, François se fait griller la politesse par une novice pour une série radiophonique au long cours consacrée à «The Greatest» (Ou alors, des cèpes). Un K.-O. technique dur à avaler.
L’ambiance générale est imprégnée d’une mélancolie arty qui rappelle les films de John Cassavetes. Ici aussi perce l’autoportrait d’un écrivain qui n’entre pas dans les cases habituelles, trop intello pour les sportifs, trop sportif pour ses collègues de la culture. Ce serait un peu déprimant si la boxe, comme philosophie de vie et comme supplice des corps, n’avait le pouvoir magique de débrider la langue. Il y a du Audiard chez Roux. Illustration ici quand il décrit l’état d’un pauvre bougre qui se relève après avoir embrassé le tapis: «Il avait commencé à faire le ménage dans ses synapses. D’après le médecin de la réunion qui en avait vu d’autres, il allait avoir du mal à le faire dans les coins.» Un recueil à ranger entre Un steak de Jack London et Fat City de Leonard Gardner.
L.R.
5 autres coups de cœur livres
Quitter la vallée
Roman de Renaud de Chaumaray. Editions Gallimard, 208 pages.
La cote de Focus: 3,5/5
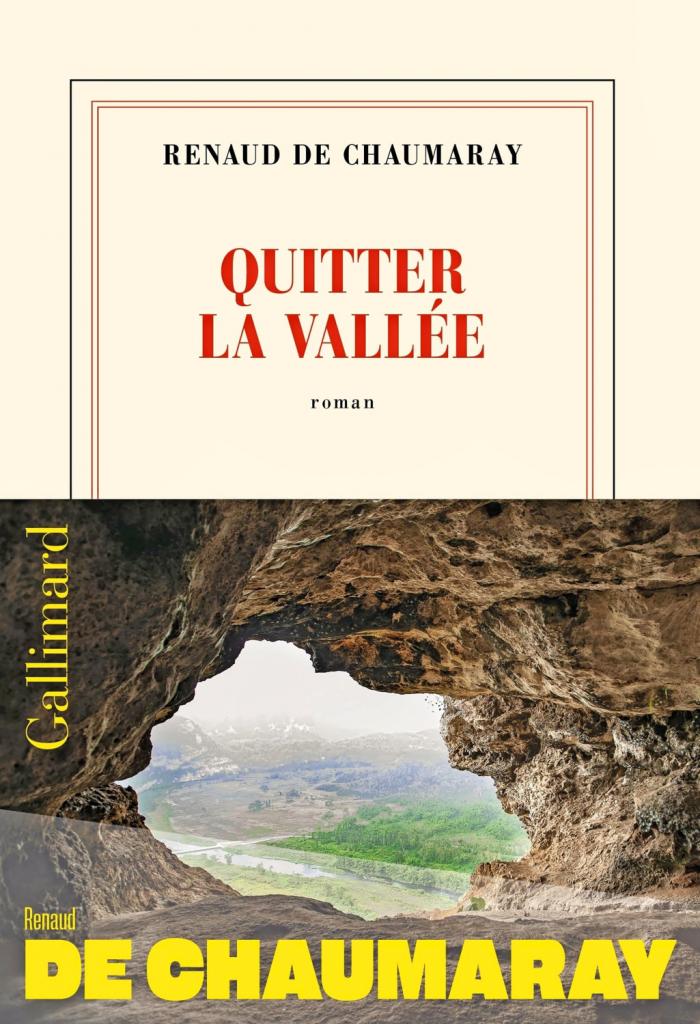
En cavale, Clémence et son fils trouvent refuge dans une maison encastrée dans le relief d’une vallée en Dordogne. De son côté, Johanna retrouve son père, spécialiste de la préhistoire, pour une excursion souterraine du côté de Lascaux. Quant à Marion et Guilhèm, ils se frôlent et s’apprivoisent depuis leur rencontre dans une salle des fêtes. Soudain, une disparition… Enchevêtrant trois récits dont les ramifications tardent, à dessein, à se rencontrer, Renaud de Chaumaray laisse son intrigue croître et infuser minutieusement. Construit en millefeuille, minéral et sauvage, ce thriller en Périgord noir procède à pas de loup. Dissimulé dans le revers de la forêt, enfoui dans les goulots d’une grotte ancestrale, son univers feutré réconforte et étouffe à la fois. La maîtrise technique refuse tout effet grandiloquent: gardien jaloux de son secret, le suspense lancinant progresse tel le lierre sur une façade. «Il sait la force qu’il faut pour s’extraire de ces provinces dont la douceur vous endort.»
F.DE.
L’Epris littéraire
Roman de Julien Leschiera. Editions Le Dilettante, 272 pages.
La cote de Focus: 4/5
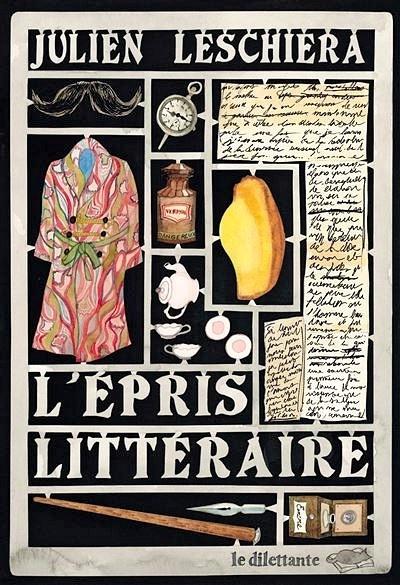
«Comment avance le roman, Monsieur?» Entraîné par deux complices narquois à rendre visite au «type le plus proustien du monde», un écrivain en panne d’inspiration pénètre un décor suranné. De fait, alité au milieu de ses paperolles, tousse un vieillard souffreteux se prenant pour Marcel. Si le visiteur flaire le piège à touristes, la méfiance le dispute à la fascination… Multipliant les visites, le narrateur s’éprend de Céleste, servante claudicante houspillée par un maître des lieux tyrannique. Cédant aux charmes de la domestique, le littérateur émoustillé s’installe bientôt à demeure, se glissant littéralement dans les pantoufles de l’autre… Après tout, «une fois chez soi, tout le monde est original, à sa manière».
Dans un premier roman épatant (Mes vies parallèles), Julien Leschiera traçait le portrait d’un aquoiboniste faussant compagnie aux soubresauts de son existence. Si les thèmes des doubles, de la réclusion sociale ou de l’oisiveté enluminent toujours la partition, la farce grinçante délaisse, dans L’Epris littéraire, l’humour noir pour lui préférer la cruauté du huis clos psychologique. Il y a du Misery (Stephen King), du Baby Reindeer (Mon petit renne, série venimeuse de Richard Gadd) dans le décor obsessionnel de cet appartement sarcophage où le lecteur sous emprise s’enlise tel l’infortuné héros. Derrière le simulacre de rêve grotesque, sadisme et fausseté ourdissent les noces étouffantes d’un cauchemar fantastique où ce livre-piège, aux allures d’escape room, trempe des madeleines à l’arsenic. Empreint de critique sociale, ce thriller gothique très maîtrisé entrelace mystère et romantisme pour dire combien la perte de l’estime de soi conduit à une chute inexorable. «Au final, tous autant que nous sommes, on finit toujours par ne voir que ce qui se passe dans notre tête.»
F.DE.
La Mort brutale et admirable de Babs Dionne
Polar de Ron Currie. Editions Flammarion, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Charles Recoursé. , 464 pages.
La cote de Focus: 4/5
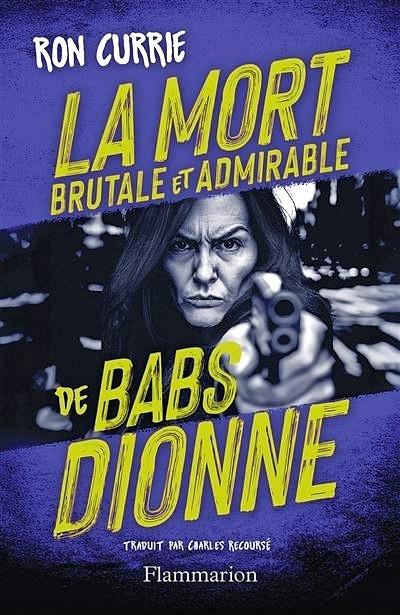
Elle s’appelle Barbara Levesque, mais tout le monde l’appelle Babs depuis plus d’un demi-siècle. Et Babs, «une connasse en acier trempé», dixit elle-même, règne depuis son premier meurtre sur Little Canada, le quartier (pourri) franco-canadien de la petite ville (pourrie) de Waterville, dans le Maine. Là, précisément, où l’auteur a grandi et où «les pauvres sont pauvres, le reste n’est que dates et détails». Ne croyez pas, malgré les apparences, que tout est dans le titre: si la mort, de fait, sera brutale et admirable, le chemin qui y mène tient du polar social, réaliste et difficile à lâcher, dans lequel les femmes règnent en maître et où, surtout, les fantômes rôdent à chaque page. Ron Currie, que l’on découvre ici en français à son cinquième roman, use surtout du genre pour soulever la question du déterminisme, du poids du passé et de notre dette envers les morts –«Ainsi, lecteur, lectrice, considère qu’ils ne font qu’un avec toi. Une entité unique, s’étalant sur des siècles et des siècles.» Une voix à suivre.
O.V.V.
L’homme est une fiction
Enquête intime de Carmela Chergui. Editions Tusitala, 128 pages.
La cote de Focus: 4,5/5
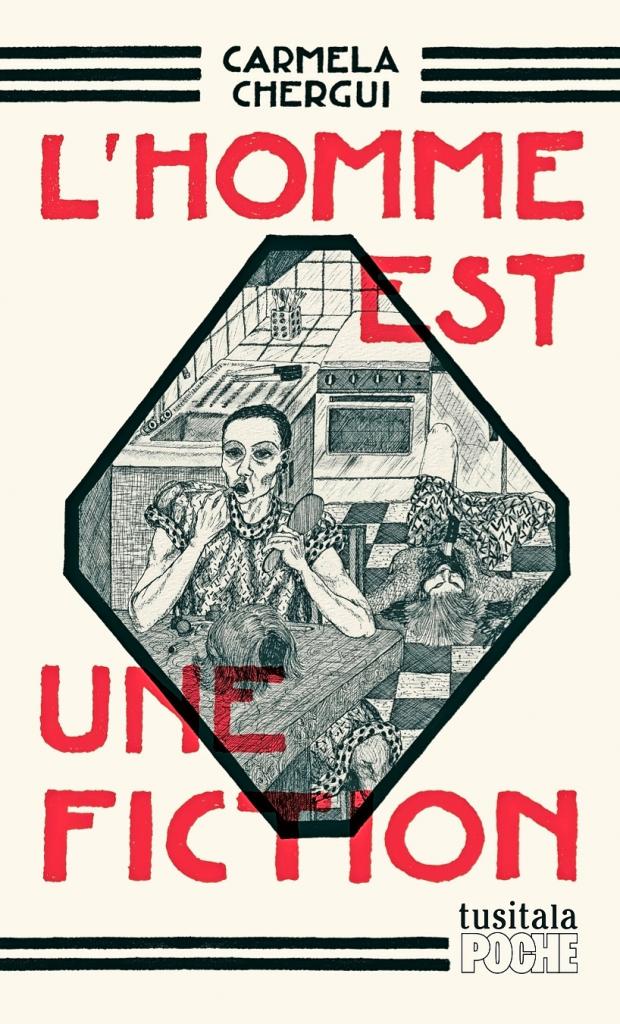
Le critique littéraire un tant soit peu professionnel prend des notes, colle des Post-it® ou corne au moins les pages des livres censés faire l’objet d’un «papier», comme on dit «dans le métier». Avec L’Homme est une fiction, dernier né de la collection Poche des éditions franco-belges Tusitala, impossible de suspendre la lecture (même pour surligner grossièrement une phrase au marqueur fluo), on a été happé.
Si on a bien tout compris, Carmela Chergui avait brièvement parcouru la Belgique (Bruxelles puis Liège) pour conter une énigmatique enquête lors de conférences/performances qu’on regrette d’avoir ratées. C’est son compère Mickaël Demets, cofondateur (avec elle!) de Tusitala, qui lui a soufflé l’idée d’en faire son premier livre. Dont acte. Comme toujours chez Tusitala, le livre (l’objet) est particulièrement soigné, et bourré de photos aussi belles et touchantes que les phrases ensorcelantes de l’autrice.
Et cette fameuse enquête? Elle débute dans l’illustre librairie bruxelloise pour laquelle la néodétective travaillait alors. «A l’affût de textes ou de bandes dessinées à rééditer», elle se procure, pour une bouchée de pain, le fonds de catalogue du légendaire éditeur de BD Futuropolis. C’est là qu’elle tombe sur ce vieil album des années 1980, Etrange apocalypse d’Etienne Mériaux. «On y lisait, dans des cases tordues, des scènes de drague malhabile entre hommes.» Elle y reconnaît un bar devant lequel elle passait avec sa mère durant son enfance parisienne. Intriguée, elle veut tout savoir de ce Mériaux. La voilà qui ratisse les sites de BD, interroge ceux pour qui cette histoire «fait comme un trou de cigarette dans la photo de famille». Car l’auteur, en vérité artiste protéiforme passé par la case internement psychiatrique, est mort en 2000. Mais «une enquête en dit surtout beaucoup sur la personne qui la mène», et il en faut plus pour stopper Carmela. Ses investigations la mèneront de Bruxelles au fin fond de la Bretagne via un détour imprévu et intime par la dictature militaire argentine de la fin des années 1970… C’est passionnant.
Cela dit, on se questionne: l’a-t-elle vraiment suggéré? Ou l’a-t-on rêvé, que ce n’était là peut-être que le début de ses investigations enfiévrées? Maudit oubli de prise de notes (et de surlignage grossier)…
M.R.
Les Vulnérables
Roman de Sigrid Nunez. Editions Stock, 272 pages.
La cote de Focus: 4/5
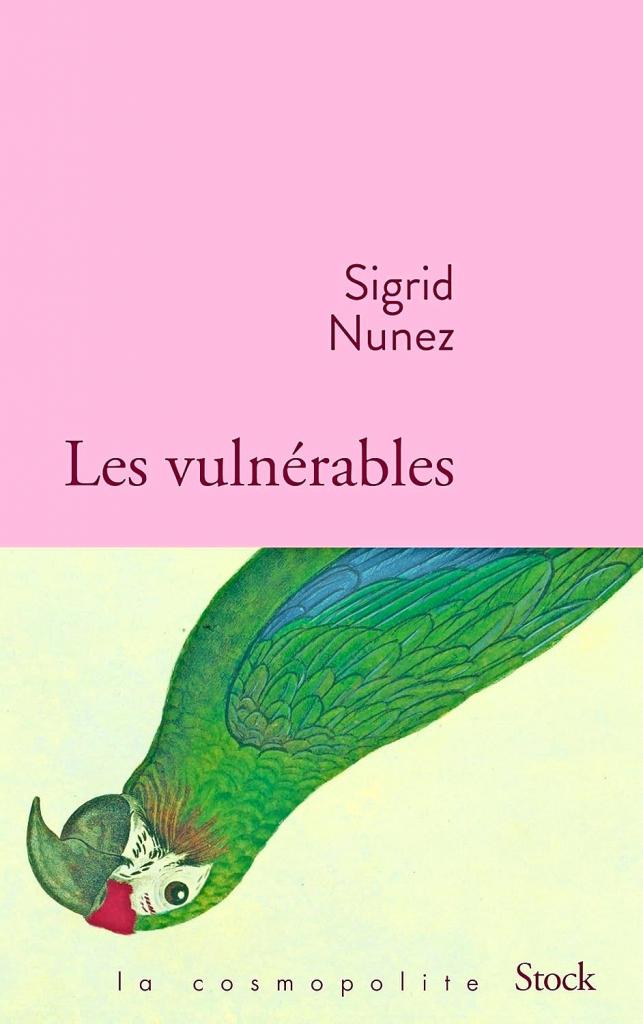
Des livres et des animaux. Il n’en faut pas plus à Sigrid Nunez pour donner corps à un récit séduisant, où la fiction se déguise en autobiographie (comme le disait de Proust l’un de ses traducteurs cité par l’autrice), récit qui convoque abondamment les lectures de l’écrivaine, mais aussi ses souvenirs, matériau mouvant de sa prose. Pour lancer le geste d’écrire, il faut un prétexte. Ici, le confinement volontaire en pleine pandémie de Covid dans l’appartement new-yorkais d’une amie partie à la campagne, afin de prendre soin d’Eurêka, son précieux perroquet. Mais bientôt débarque dans ce nid un jeune homme, précédent gardien de l’animal, qui s’immisce dans cette relation précaire. Aux conversations intérieures de la narratrice se substituent peu à peu les vraies conversations avec Vetch, jeune homme charmant et instable, qui confronte l’écrivaine à ses limites, à commencer par sa mortalité. Ce qui compte, ce n’est pas tant la mémoire que l’on a des événements d’un livre, que des sentiments et des questions qu’il a suscités à sa lecture, réfléchit Nunez, et de fait, Les Vulnérables entame avec le lecteur une discussion souvent vive et parfois drôle sur la vie et l’écriture, dans une Amérique post-Trump en pleine ébullition.
A.E.

