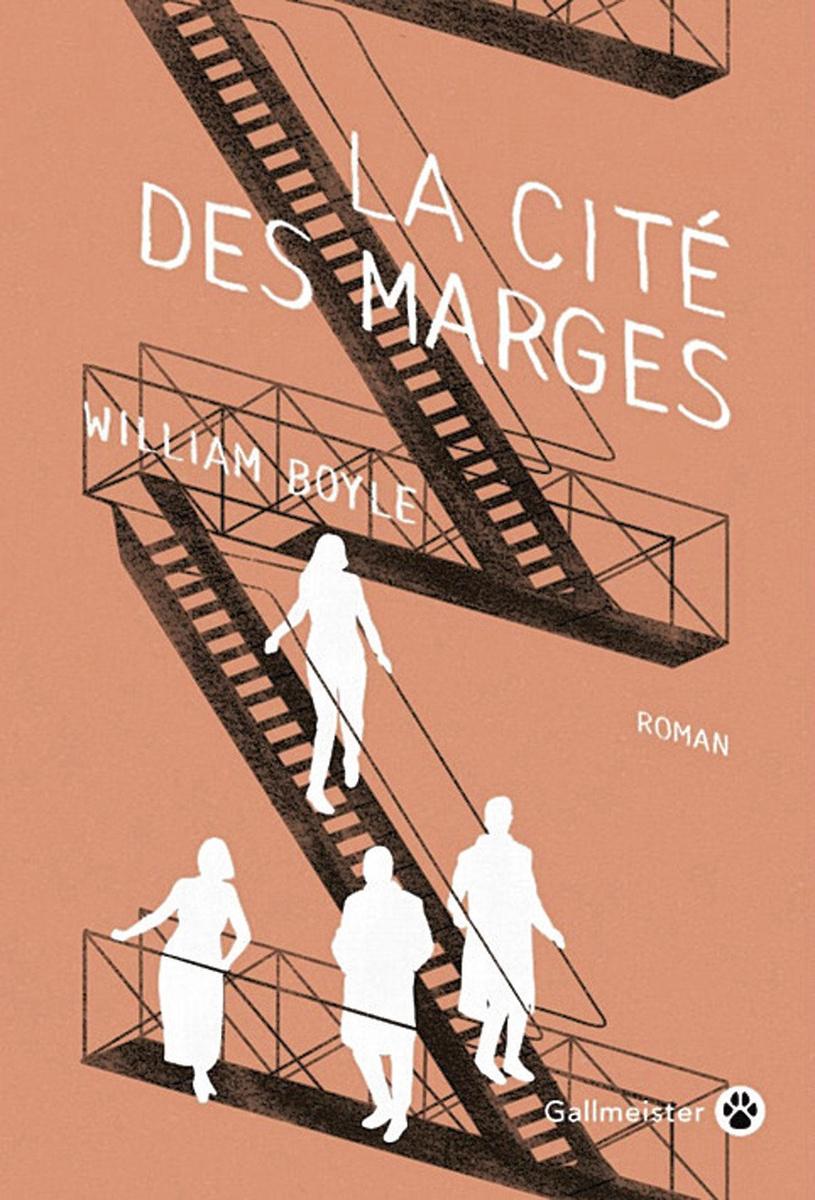La Cité des marges est le cinquième roman de William Boyle, le plus cinéphile des écrivains américains. Avec toujours le Brooklyn des années 90 comme terrain de jeu, l’auteur de Gravesend propose un récit qui tient autant du polar nerveux et violent que du mélodrame sur fond de spleen adolescent.
Découvert en 2016 avec Gravesend, numéro 1 000 de la collection Rivages/Noir et au rythme de quasi un roman par an -ont suivi depuis Tout est brisé, Le Témoin solitaire, L’amitié est un cadeau à se faire et La Cité des marges tous chez Gallmeister-, William Boyle s’impose mine de rien comme un des grands auteurs américains d’aujourd’hui. Ses intrigues sont fluides mais complexes. Ses références au cinéma et à la musique multiples. Son écriture mélancolique. Foncièrement humaine. Ses personnages féminins puissants. Leurs homologues masculins fragiles, borderline et attachants. William Boyle est plus proche de George Pelecanos et surtout de Richard Price que -au hasard- de John Grisham ou Harlan Coben. Sa nouvelle livraison La Cité de marges, roman choral extrêmement touchant, constitue une excellente porte d’entrée dans l’univers de l’Américain, que nous avons rencontré longuement dans les bureaux de sa maison d’édition parisienne.
Si vous fermez les yeux quelques instants et que vous vous télétransportez à Gravesend, le quartier de Brooklyn où vous avez vécu enfant et adolescent, quelles sont les premières images, les premiers sons ou les premières odeurs qui vous reviennent à l’esprit?
La cuisine de ma grand-mère, de mes grands-parents. Ma maman vit d’ailleurs toujours dans cette maison. Ma mère et moi vivions à l’étage et mes grands-parents au rez-de-chaussée. Ça n’a pas beaucoup changé depuis. En tout cas, la cuisine est restée la même. Là, maintenant, je peux y voir quelques bols dans l’évier, sentir l’odeur du café et, ensuite, visualiser le quartier, les maisons des voisins. Mais la plupart du temps, j’atterris toujours dans cette cuisine. J’y ai grandi comme fils unique. Ma mère s’est remariée et a eu des enfants mais je n’ai aucun lien avec eux.
Est-ce que grandir en tant que fils unique reste une expérience propice à développer son imagination? À la nourrir de fantasmes?
Je ne sais pas vraiment. Mais ce que je sais, par contre, c’est que les livres, les films et la musique m’ont permis de survivre parce que j’y trouvais à chaque fois une connexion, une résonance qui faisait que je me sentais moins seul. Je n’ai aucun point de comparaison, c’est juste les circonstances qui ont fait que j’ai grandi de cette façon alors qu’il n’y avait pas de livres à la maison, encore moins de musique… Adolescent, j’allais de temps en temps passer le week-end chez mon père biologique qui était un grand lecteur. Je me souviens d’avoir vu traîner des Ed McBain, des Stephen King… C’est probablement mon premier lien avec la littérature. Avant cela, je n’ai pas d’autres souvenirs si ce n’est que ma mère ne lisait pas. Mes grands-parents ne lisaient pas plus et n’écoutaient pas beaucoup de musique non plus. En revanche, j’avais un oncle, le frère de ma mère, qui était un musicien de jazz. Il me fascinait. C’était une espèce de vieil hippie qui incarnait à mes yeux un mode de vie très cool. La musique, j’ai commencé à en écouter dès que j’ai eu une radio mais le cinéma et la littérature, c’est venu beaucoup plus tard, lorsque j’ai commencé à fréquenter la bibliothèque ou les vidéoclubs comme Kim’s Video & Music dans East Village, où je me rendais à chaque fois que j’allais à Manhattan quand j’étais au lycée. J’y achetais également des vinyles et des films qu’on ne trouvait pas dans mon quartier. C’était une autre époque. Internet n’existait pas. Je découvrais les films vraiment par hasard, en fonction de la jaquette ou d’une critique dans le Village Voice.
Bien avant la musique et la littérature, votre première passion, c’est le cinéma. Quel est le premier film qui vous a retourné au point de vous demander si ce que aviez vu était bel et bien réel?
À partir de huit ou neuf ans, j’étais déjà un tout grand fan de cinéma et je regardais les succès de l’époque comme Back to the Future. Mais le premier film qui a fait office d’électrochoc et a changé ma vision de pas mal de choses, c’est Blue Velvet, que j’ai vu quand j’avais douze ans. Je sais, c’est très jeune. Je ne connaissais rien du contenu lorsque je l’ai loué. Je l’ai regardé un samedi après-midi seul chez moi juste avant d’aller à l’église avec ma mère et mes grands-parents. Il y a vraiment un avant et un après Blue Velvet dans ma vie. Le film a changé ma perception du monde, ma façon de regarder les gens et même de regarder l’Amérique.

Quand la littérature débarque-t-elle dans votre vie? Au lycée?
J’ai détesté le lycée la plupart du temps mais j’ai eu la chance d’avoir deux profs d’anglais que j’appréciais. L’un d’eux était un flic à la retraite qui ne se conduisait pas comme tel. Il avait de longs cheveux, adorait l’art en général et conduisait une moto. Je l’ai eu plusieurs années de suite et il m’a fait découvrir Tom Wolfe, John Steinbeck et Tim O’Brien. Avec l’autre prof, j’ai fait la connaissance de James Joyce et de Toni Morrison. Il adorait parler cinéma et il m’a même offert sa copie de Raging Bull. J’avais déjà vu Taxi Driver et Goodfellas mais je n’avais encore jamais vu Raging Bull. Pour revenir à la littérature, ma mère n’était pas trop inquiète du moment qu’elle me voyait avec un bouquin à la main; elle était juste contente que je lise même si j’avais douze ans et que c’était du James Ellroy. Une seule fois, elle m’a juste refusé un livre à l’occasion des fêtes de Noël sur les conseils de mon beau-père: j’avais treize ans et c’était American Psycho de Bret Easton Elllis.
Après le lycée, vous quittez Brooklyn à l’âge de 18 ans pour l’université à New Paltz. Que retenir de ces années formatrices?
C’était une petite ville, dans l’État de New York, dont l’université a accueilli pas mal de comédiens comme John Turturro. J’y suis resté huit ou neuf ans. C’était vraiment une bonne période et j’y ai étudié la littérature anglaise de 1996 à 2000. C’est aussi la fin d’une époque pré-Internet, pré-téléphones portables, pré-11 septembre. C’était génial. Il y avait deux disquaires incroyables, deux librairies bien fournies, un cinéma pas loin de la ville et, au Bard College voisin, un chouette club où j’ai vu pour la première fois Sufjan Stevens et Will Oldham. Il faut croire que je n’étais pas vraiment un aventurier; mon seul trip à cette époque, j’ai 20 ans, c’est en Irlande, où j’ai passé quelques semaines, essentiellement pour y voir les Pogues. Avec ma future épouse, on s’est installé à Austin, Texas, fin 2001 pour y passer une année où j’ai trouvé du boulot dans le bâtiment. Ensuite, nous sommes retournés à New Paltz, brièvement dans le Bronx avant de partir à Oxford dans le Mississippi il y a treize ans. Essentiellement pour mon amour envers un écrivain comme Larry Brown et le blues du Delta.
Quand est-ce que vous vous dites que vous avez envie d’écrire, d’en faire votre métier?
J’ai essayé d’écrire des pièces de théâtre, des scénarios, de la poésie vers 18 ou 19 ans mais ce n’était pas très bon. Par contre, la fiction s’est imposée naturellement parce qu’elle me permet d’y glisser mon amour des dialogues et de la musique.
Si Tout est brisé est sans doute votre roman le plus mélancolique et L’amitié est un cadeau à se faire le plus cinématographique, La Cité des marges est peut-être votre meilleur livre parce qu’au-delà de vos références et de la mélancolie qui traverse votre écriture, vous signez un pur hard-boiled sans perdre de vue ni vos personnages, ni leur humanité, chaque fois avec des personnages féminins forts. Y voyez-vous une évolution naturelle?
En tout cas, je savais comment j’allais construire La Cité des marges. J’adore les mélos de Douglas Sirk et j’aime y ajouter des éléments criminels. Ce nouveau roman résume en tout cas toutes mes passions, toutes mes obsessions avec de la violence et de la noirceur. À bien des égards, tous mes romans sont personnels mais peut-être encore plus celui-ci. Le personnage du jeune Mikey est sans doute le plus proche de moi de toute ma bibliographie.
Le point de départ de Gravesend était inspiré d’une histoire criminelle authentique que vous avez fictionnalisée. Quid de La Cité des marges?
Le déclic vient de The Seven Five, un documentaire qui retrace la corruption policière dans le 75e arrondissement de New York dans les années 80 et se focalise sur Michael Dowd, le plus pourri d’entre eux qui fut finalement arrêté au début des années 90. J’ai commencé à écrire dans la foulée du docu et j’en ai fait Donnie, un sale flic paradoxalement mâtiné d’un bon samaritain.
Un des thèmes de La Cité des marges, c’est aussi le spleen adolescent qui peut conduire au suicide. Comment était la vôtre d’adolescence?
Bien sûr que j’ai connu le spleen adolescent. Les deux ados que je décris dans le roman, ce sont juste deux versions d’une même personne. J’ai puisé dans ma propre adolescence pour les dessiner. Mais aucun de mes potes ne s’est donné la mort.
On évoque souvent l’univers de The Sopranos à propos de votre nouveau roman. Ceci dit, Donnie, votre flic corrompu, tient plus de Vic Mackey, le policier ripou de The Shield. Une influence?
J’ai adoré chaque saison de The Shield, qui est beaucoup plus underground que les grosses séries HBO comme The Wire. La complexité des personnages de The Shield où tout n’est jamais ni noir ni blanc est très séduisante pour l’auteur que je suis. L’impact de The Sopranos sur mon travail est énorme, ne fût-ce que dans la manière de construire une histoire et de développer des personnages. Toutes ces séries qu’on vient de mentionner -auxquelles j’ai envie d’ajouter Deadwood– sont romanesques au sens littéraire du terme. Il me semble évident que tous ces shows nous enseignent, à nous écrivains, l’art de la structure.
Écrire sur le Brooklyn des années 90 n’est-il pas un moyen de rester connecté à cette période de votre vie qui était plus innocente en quelque sorte?
Sans doute. En tout cas, j’ai encore quelques histoires dont l’intrigue se déroulera à Brooklyn. D’ailleurs, mon prochain livre Shoot the Moonlight Out, d’après le titre d’une chanson de Garland Jeffreys, se déroulera à New York en juin 2001, soit l’été avant le 11 septembre qui scellera définitivement la fin d’une époque.
La Cité des marges
Roman noir. De William Boyle, éditions Gallmeister, traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril, 432 pages. ****
Auréolé du numéro 1 des 20 meilleurs romans policiers du Washington Post pour 2020, devant Carl Hiaasen et Walter Mosley, ce cinquième ouvrage de William Boyle réunit une galerie de personnages reliés par la mort de deux personnes dans le Brooklyn des années 90: celle d’un père harcelé par un usurier et du fils unique d’un flic pourri jusqu’à la moelle. Par un effet papillon, le destin de ces femmes et de ces hommes va irrémédiablement basculer vers un croisement improbable entre Little Odessa, The Graduate et The Shield avec un parfum de The Sopranos. Brillant, tout simplement.