Organisateur amateur de concerts punk-new wave, Philippe Kopp, devenu pro incontournable, a récemment pris sa retraite après 42 ans de business live. Témoignage en exclu.
« On tenait les portes du 140 pour éviter qu’elles n’éclatent sous la pression du public qui voulait absolument entrer, alors qu’on essayait d’évacuer les 500 spectateurs du premier show de Public Image par l’autre sortie, en contrebas du théâtre. Avant de laisser entrer les gens venus au second concert programmé à 21 heures. Et là, j’ai vu un mec de l’entourage de PiL (Don Letts, NDLR), débouler avec une batte de baseball. Et je ne pouvais rien faire, je tenais la porte!!! » Quasi 42 ans après ce double concert mouvementé au Théâtre 140, Philippe Kopp n’a rien oublié de la soirée schaerbeekoise du 20 décembre 1978. On y était et c’était le bordel, entre les postures de John Lydon qui exige du speed, pousse la table de mix à fond et pète un baffle -« bonjour le son pourri« , dit Kopp- et chante le dos tourné au public. Résultat: les voisins et le directeur Jo Dekmine sont furieux, le 140 est privé de rock pendant quelques saisons. Pour Kopp, né en 1955 à Uccle, le souvenir reste néanmoins mémorable, alors qu’il vient de tirer -le 1er avril, « et ce n’est pas une blague« – sa révérence à l’industrie du concert belge en ne renouvelant pas le contrat qui le liait depuis 2001 comme consultant au géant Live Nation. Le petit-fils de George Kopp, immigré russe cité par un autre George, Orwell, dans Homage to Catalonia, ne prévoyait pas de conquérir 1984 et consorts. Pourtant…
En janvier 1978, avec tes copains Gilles Verlant et Christian Verwilghen, rencontrés à l’ULB, tu organises ton premier concert: Talking Heads et XTC dans l’arrière-salle d’un resto ucclois, Le Vieux Saint-Job. L’entrée est fixée à 200 francs belges (5 euros). Tu te souviens du cachet de Talking Heads? 50.000 francs (1250 euros)?
Franchement, je ne m’en souviens pas, mais le chiffre que tu évoques est plausible. L’université ne m’avait pas vraiment réussi (sourire) et 1977 est arrivé: une claque dans la gueule. On a créé, même pas une société, mais une association de fait, Clean-X, dont Talking Heads a été le tout premier concert, devant un public qui ne devait pas dépasser 400 personnes! Pour commencer, on a mis chacun 7.500 francs belges sur la table. On a enchaîné The Cure au Klacik et puis, par exemple, XTC de retour en avril 1978 au Vieux Saint-Job, où je renfonçais les plombs dans le tableau électrique chaque fois que les spots chargeaient un peu…
Même avec l’index, la valeur adaptée du franc belge en euro, les prix de l’époque paraissent modestes. Gainsbourg en janvier 1980 au Cirque Royal coûte de 320 à 360 francs le ticket, soit en tenant compte de l’inflation, 26 et 29 euros…
Oui, pareillement, Clash en octobre 1978 à l’Ancienne Belgique, coûte 240 francs (6 euros). On est toujours dans une structure amateur, on ne déclarait rien, comme une association d’étudiants, sans payer de taxes sauf peut-être la communale. Et puis en mai 1979, on se professionnalise en SPRL sous le nom Sound & Vision. Avec un accord de partenariat unique avec Herman Schueremans (Monsieur Werchter, futur patron de Live Nation Belgique, NDLR), qui a déjà des contacts en Angleterre… En fait, à la fin des années 70, personne ne pouvait savoir le parcours que feraient The Cure, U2, Talking Heads ou Depeche Mode. Ces derniers jouant quand même au Disque Rouge de la rue Blaes (discothèque alors décatie, NDLR), bien avant qu’elle ne soit réaménagée et rebaptisée Fuse. On a appris le métier en même temps que les artistes, ce qui a été extraordinaire. Quand on a commencé à faire des concerts à l’AB, on s’est dit qu’il y avait du potentiel, qu’on pouvait peut-être en vivre. Gilles a quitté assez vite Sound & Vision pour poursuivre sa vie d’étudiant puis de journaliste, et même en pleine organisation de concerts, Christian a longtemps travaillé à plein temps chez Caroline Music. Je faisais aussi toutes sortes de petits boulots.
Quand change le business du concert?
Le 10 décembre 1980, on fait notre premier Forest National avec Talking Heads et The B-52’s. On a été emportés par un truc, c’est sûr. On pensait tellement peu « faire l’Histoire » qu’on a d’ailleurs viré toutes les affiches des premiers concerts, récupérées par un type qui les a bien vendues ensuite comme collectors. Le business live change au milieu des années 80, en plein yuppisme, et devient progressivement une industrie. On y participe de manière relativement inconsciente puisqu’on s’adapte aussi aux demandes des groupes, dont les exigences techniques qui tiennent d’abord sur une feuille s’épaississent jusqu’à faire aujourd’hui 35 pages.
Les moments d’excentricité?
On a fait Kiss à Forest et l’une des exigences du contrat était que les promoteurs soient habillés en Kiss… On ne l’a pas fait et c’est quand même passé. Notre force a été de réunir dès le début des gens autour de nous dans lesquels on avait pleinement confiance, notamment les régisseurs Philippe Lengelé et Ronald Van Cutsem.
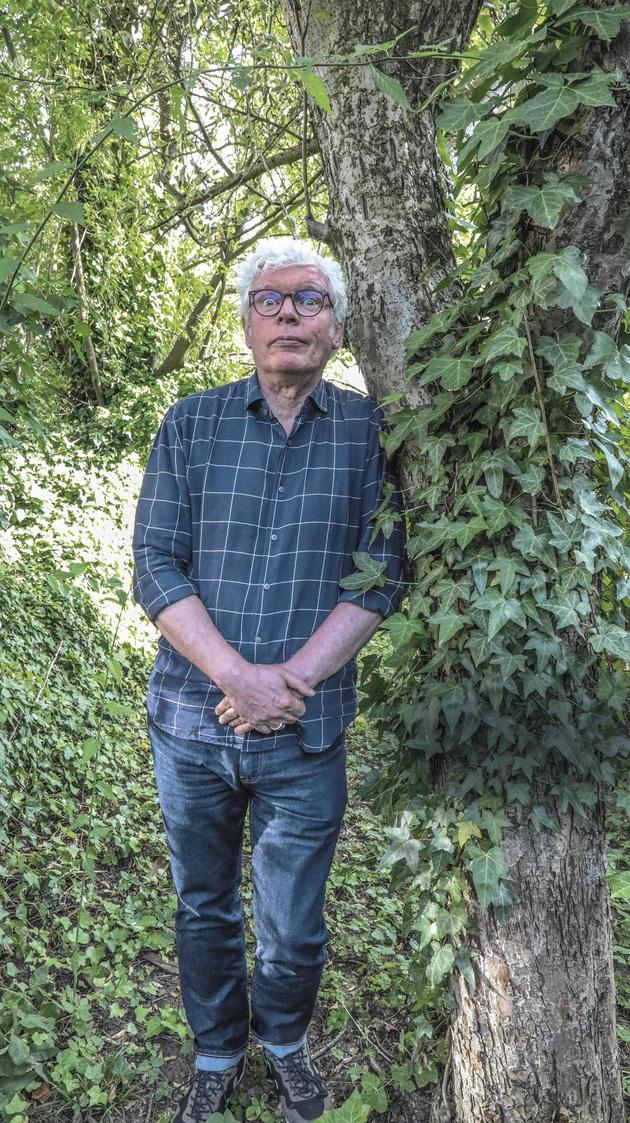
Pendant longtemps, il fallait payer le groupe en cash. Tu te trimballais donc avec une mallette bourrée de dollars?
Ou alors de livres sterling, ils ne voulaient pas de francs belges! Généralement, un mois avant le concert, on payait la moitié du cachet puis le décompte après la prestation, le soir-même. Pour les premiers concerts de hip-hop, il fallait payer cash avant que le concert ne commence, sinon ils ne montaient pas sur scène (sourire). Généralement, on faisait le décompte avec le tour manager -après c’est devenu des comptables- pendant le concert, que je ratais donc. J’ai obtenu une dispense pour la fabuleuse prestation de Page & Plant à Forest National.
Dans l’après-Woodstock, l’industrie du live glisse vers le gigantisme, celui des concerts en stades ou dans d’énormes festivals, à des prix flirtant volontiers avec les 100 euros. La maison mère américaine de Live Nation a annoncé au printemps 2020, en plein Covid, que les affaires ne pourraient reprendre à grande échelle qu’à l’automne 2021.
Ce qui est attaqué, ce sont les fondements mis en place dans notre civilisation. Schématiquement, on est passé d’une société industrielle à une société de services qui est aujourd’hui en danger. L’Horeca, les concerts, le théâtre, tout l’événementiel et le service/plaisir sont dans un état dramatique. Il suffit de voir l’annonce de l’AB, qui se sépare de 200 collaborateurs: un vrai cri d’alarme. Les concerts à 200 personnes, c’est plus symbolique qu’autre chose. Ça peut perdurer dans le temps puisqu’on nous dit que les virus vont faire éternellement partie de notre vie.
En mai 2001, votre société Sound & Vision a été rachetée par le géant américain Clear Channel, ensuite devenu Live Nation. Comment et pourquoi?
Le point d’entrée, c’est Herman Schueremans, qui est contacté et puis nous en parle: les négociations ont duré pendant deux-trois ans, avec la société SFX ensuite rachetée par Clear Channel. Ce n’était pas illogique: on négociait sans cesse avec des agents anglo-américains à une époque où les artistes tournaient peu en Inde, en Chine, dans les pays de l’Est ou en Australie. Il y avait donc la volonté des agents et des artistes de « planétariser » la bonne parole rock. On n’a pas trouvé le rachat choquant et ce n’était pas possible que Sound & Vision reste indépendante, parce que le métier fonctionne avec des agents et des relais dans chaque pays, comme une chaîne dont tu dois faire partie.
La dimension du chèque?
(sourire) Disons que j’aurais pu prendre ma retraite en faisant très très attention (sic). On a été audités et ils nous ont fait une proposition, à prendre ou à laisser.
Lors de cette opération de rachat par l’américain Clear Channel/Live Nation de l’ensemble du business belge des concerts -Schueremans, Make It Happen de Paul Ambach, Sound & Vision- la presse a pointé le risque de monopole. Tu n’as jamais eu l’impression d’avoir trahi tes racines punk/new wave?
Dans ma tête, je suis toujours indépendant. C’est un statut que j’ai conservé, je n’ai jamais été employé de Live Nation. Il y a certaines règles à appliquer, mais elles sont logiques dans le métier, comme le secret des contrats. Ce sont les artistes, leurs managers, leurs avocats qui l’exigent. On fait une fixation sur Live Nation, mais il suffit de voir ce qui se passe en France avec Fimalac ou en Allemagne avec FKP Scorpio. J’ai accepté tout ça jusqu’à une certaine industrialisation, le mot ne me choque pas. Ce que je constate, c’est que pour beaucoup, c’est devenu un business où on voit arriver des Solvay boys… Le premier conseil que je leur donne, c’est « apprenez à désapprendre » (sourire). Moi, j’ai voulu faire dans Live Nation le même travail que j’assumais avant. Avec la liberté complète d’organiser tel ou tel concert.
À un moment, tu t’es spécialisé sur le marché français.
Oui, il y a une vingtaine d’années, parce que j’avais l’impression que les Anglo-Saxons savaient tout mieux que nous et il se passait plein de choses en France, que ce soit Noir Désir, Miossec, Dominique A, Sylvain Vanot. J’avais toujours « fait du français », par exemple le package Ze Records à la salle Arlequin en avril 1980 avec Lizzy Mercier Descloux, Modern Guy, Les Garçons, Suicide Romeo…
Quand des artistes déjà richissimes, comme Fleetwood Mac, proposent un package VIP à un prix exorbitant lors de leur tournée mondiale qui passe en juin 2015 au Sportpaleis d’Anvers -729,50 euros-, tu ne te sens pas mal?
Ce sont les groupes qui gèrent ça: on n’a aucun contrôle là-dessus. Nous, on est en bout de chaîne. C’est devenu du business qui va vers des meet and greet qui peuvent comprendre une vision partielle du soundcheck ou un pass qui ne te permet de toute façon pas d’aller sur aucune autre date de la tournée (sourire). On est dans un business qui pousse aussi loin la possibilité de faire de l’argent. Il y a également une compétition financière entre tous ces groupes: à celui qui fera le plus gros chiffre mondial.
Trop d’argent en jeu?
Pour moi, ce sont des vases communicants: le fric gagné d’un côté, permet de l’autre côté de développer un artiste, le placer dans des clubs, toucher des commissions riquiquis, mais faire en sorte que les artistes aillent plus loin.
Vos coups de fric? Les dix concerts de Goldman à Forest?
Pas forcément, non. On a fait une fois trois dates, puis dix puis sept puis huit au fil des tournées successives. Mais en 40 ans, on est passés d’une répartition de 60% pour l’artiste et 40% pour le promoteur à 70-30, puis 80-20, 90-10 et aujourd’hui, dans certains cas, si on veut avoir l’affaire, on doit travailler à 5%! Un groupe qui fait aujourd’hui Forest, selon le prix d’entrée, peut partir avec un cachet de 150 à 200.000 dollars.
Tout cela n’est-il pas devenu dingue?
La remise en question du métier est complète: on ne peut pas reprendre les concerts avant 2021, voire 2022 et certains spécialistes nous disent déjà que les vaccins ne seront peut-être efficaces que pour 70% de la population. Et que d’ici là, on pourrait avoir d’autres virus. Comment pourra-t-on faire de ce modèle quelque chose qui fasse encore de l’argent? Ça ne concerne pas que les actionnaires, mais aussi tous les gens que l’on fait travailler… C’est tout le modèle économique qui doit être remis en question. Un véritable défi.

