Autrice, actrice, scénariste et metteuse en scène, Séphora Pondi signe un premier roman à fleur de peau qui hybride avec dextérité son goût des textes classiques et des séries fantastiques.
Avale de Séphora Pondi
Grasset, 224 p.
La cote de Focus: 4/5
Dès ses pages inaugurales, brutes, crues, percutantes, Avale est placé sous le signe de la dévoration et de la misogynoir, une haine qui combine racisme et sexisme, et qui orchestre la collision entre les destins que tout oppose de Lame, comédienne «jeune, noire, grosse» et star en devenir, et Tom, trentenaire amer qui s’échappera de l’anonymat du harcèlement en ligne. Au travers de ces deux trajectoires qui se pulvérisent l’une l’autre, Séphora Pondi remonte l’histoire de ses deux protagonistes, saisissant avec un sens du détail puissant la texture d’une adolescence racisée ou pas, mais souvent précarisée, au féminin comme au masculin. Le corps, traité sous un prisme fantastique, dans sa prédation et sa déliquescence, est au cœur des traumas et des obsessions, dans un style direct qui emprunte autant aux classiques qu’aux séries ou au cinéma.
«En général, les personnes non blanches sont là pour détendre l’atmosphère dans les productions culturelles. Mais moi, je préfèrerais la tendre un peu!» Tendre l’atmosphère est à l’opposé de l’heure passée avec l’autrice, à la fois spontanée et très réfléchie, généreuse dans le partage et précise dans l’échange. Mais cela décrit parfaitement l’effet provoqué par son premier roman, Avale, «une histoire de monstres», se plaît-elle à dire, qui narre la collision annoncée de deux personnages habités par une violence à laquelle ils réagissent de façon diamétralement opposée.
Lame est actrice, elle a un «profil de comédienne rare: jeune, noire, grosse.» Son corps, scruté de toutes parts, désiré, jugé, évalué, est son outil de travail, jusqu’à ce qu’un jour, il se rebiffe. «Je voulais écrire ce corps avec la satisfaction narcissique qu’il amène, ce n’est pas qu’un corps meurtri, c’est un corps désiré aussi. Mais il y a une tension entre l’envie de disparaître et celle d’éclore. Les problèmes de peau qui défigurent Lame lui permettent de garder une sorte d’intégrité. Il était plus intéressant pour moi de travailler sur un mal qui la ronge de l’intérieur. A travers ses problèmes de peau, existe un sous-texte racial assez important. La peau devient comme une sorte d’ennemi, une manière symbolique de raconter que la façon dont notre épiderme est regardé peut nous mettre en danger.»
Tom, lui, va retourner la violence contre l’extérieur. Jeune trentenaire un peu paumé, autrefois harcelé à l’école, il nourrit des fantasmes de dévoration. Il est le produit d’une socialisation inconfortable, voire éprouvante à l’adolescence. «Il était très tentant pour moi de raconter l’étrangeté des rapports entre garçons à cet âge. Un homoérotisme latent, l’omniprésence de la sexualité, dont, en même temps, on a peur. L’adolescence n’est pas un espace très sécurisant pour des garçons qui se construisent.»
Si Lame se voit confier l’autorité du récit, présenté à la première personne dans ses segments, Tom est raconté à la troisième personne. «Il y a une part de malice à me mettre dans la posture de celle qui a le pouvoir de raconter la vie de Tom, alors que je suis au départ dans la position d’une femme noire venant d’une classe moyenne un peu paupérisée, s’amuse l’autrice. C’était une façon de faire en sorte qu’enfin, ce soit un garçon trentenaire blanc qui devienne l’autre. Que ce ne soit pas tout le temps moi, l’altérité en littérature.»
«Les garçons ne sont pas les seuls à pouvoir poser un œil critique et ironique sur les autres.»
Racine rencontre Buffy
Si Lame partage des caractéristiques avec Séphora Pondi, elle aussi comédienne «jeune, noire, grosse», là s’arrêtent les similitudes. Vu son profil, on aurait tôt fait de l’imaginer dans le registre de l’autofiction, pour enrichir le répertoire fantasmé des «nouvelles voix» de la diversité en littérature française. Mais la romancière s’affranchit crânement de ces idées préconçues. «Je savais que, spontanément, on projetterait sur moi certaines attentes. C’était très satisfaisant de les déjouer. Et puis, je voulais asseoir ma légitimité d’autrice en allant chercher le romanesque. Par ailleurs, c’était très plaisant de rappeler à des garçons qui pensent être la norme le fait qu’ils peuvent aussi être regardés. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir poser un œil critique et ironique sur les autres. J’avais envie à mon tour d’être le surplomb.»
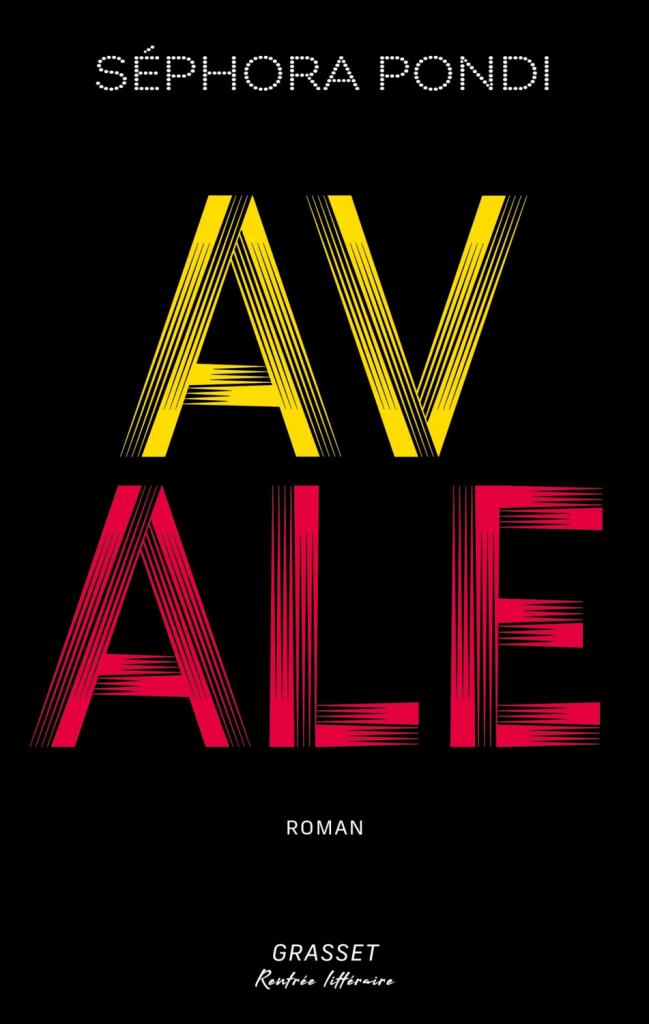
Ce plaisir de la fiction passe par le choix des protagonistes, des instances d’énonciation, mais aussi du genre, et de la langue. D’un côté, une langue parfois savante qui s’invite dans un contexte ultracontemporain, qui emprunte aux textes classiques qui sont le quotidien de la comédienne de la Comédie-Française. De l’autre, le body horror, et plus largement le fantastique, goût hérité des marottes adolescentes. Comme si Racine rencontrait Buffy contre les vampires, dans une audacieuse hybridation. «L’hybridation, c’est ma culture, et c’est vraiment ce vers quoi je tends. Le body horror, c’est d’abord lié à mes goûts d’ado, quand on a vu émerger des séries comme Charmed, Buffy, ou même Twilight au cinéma. Il y avait une grande notion de danger, notamment du fait que le corps s’y métamorphosait. Et puis, j’ai été traumatisée par Carrie, c’est un film fondateur pour moi. J’ai eu des formes très vite, été réglée très tôt. J’étais dépassée par mon corps, il y avait une vraie dissonance avec mon état d’esprit encore ancré dans l’enfance, c’est un sentiment d’étrangeté qui m’a construite.»
Conquérir l’adolescence
De fait, Avale raconte aussi très bien l’adolescence, surtout quand elle semble confisquée aux jeunes filles par le regard des autres, qui, rendant leur corps obscène, les projette directement dans l’âge adulte, un processus peut-être encore plus fort pour les fillettes racisées. «L’adolescence suppose une certaine dose de légèreté et d’insouciance; or, dans un foyer modeste ou pauvre, c’est un luxe. Avoir le temps, l’espace pour être à la fois dans la torpeur et la sollicitation, ce n’est pas une évidence pour tout le monde. De plus, l’adolescence est une période de la vie pas toujours reconnue dans les cultures non occidentales, elle ne va pas de soi, il faut la conquérir. Lame va arracher l’adolescence à sa condition socioculturelle. Mais elle réclamera aussi le droit à faire des erreurs. C’était important pour moi qu’elle ne soit pas parfaite. Que ce soit dans la vie ou dans la fiction, il y a une obsession de l’exemplarité pour les personnes racisées, surtout chez les filles. Un syndrome de la première de la classe, que j’ai l’impression de retrouver dans beaucoup de fictions, d’autofictions surtout, et je comprends très bien pourquoi. On montre des parcours idéalisés, assez lisses, finalement. Je voulais déjouer cette posture de perfection avec Lame.» Et lui permettre, aussi, de se libérer du regard blanc intériorisé qui l’empêche.
«Ce regard, que l’on retrouve dans des textes plus théoriques, mais aussi dans un roman que j’aime beaucoup, Djinns, de Seynabou Sonko, est une présence envahissante. C’est comme une espèce de contamination qui habitait déjà ses parents et leurs parents avant eux. C’est une vigilance que beaucoup de personnes non blanches vivent, qui s’ajoute à celle que vivent les femmes, cet œil intériorisé du patriarcat.» Une censure intériorisée qui vole en éclats dans ce premier roman défiant le genre et les genres.
