Suite d’Au revoir là-haut, Couleurs de l’incendie poursuit l’autopsie de l’entre-deux-guerres avec un casting renouvelé emmené par une Madeleine Péricourt aux deux visages. Pierre Lemaitre se et nous régale.
Personnage de tapisserie dans Au revoir là-haut – avec lequel Pierre Lemaitre, connu jusque-là pour ses polars, rafla haut la main le Goncourt 2013 -, Madeleine Péricourt porte sur ses épaules le deuxième épisode de cette trilogie qui a les accents d’une « Histoire naturelle et sociale d’une famille dans l’entre-deux-guerres » pour paraphraser le sous-titre des Rougon-Macquart, la célèbre fresque littéraire de Zola. La jeune femme reprend le témoin de son frère, « gueule cassée » fomentant, dans le précédent volet, une délectable vengeance contre le responsable de ses malheurs, l’affreux Pradelle, qui avait poussé le vice jusqu’à épouser Madeleine, et avec elle la fortune du père, puissant banquier.
De vengeance, il en est encore une fois question dans Couleurs de l’incendie, qui démarre en 1927, soit sept ans après le suicide à grand spectacle d’Edouard. Dévastée par un double drame, la mort de son père et surtout la tentative de suicide de son fils Paul, l’héritière de l’empire est une proie facile pour quelques fripouilles sans scrupules qui vont la dépouiller vite fait bien fait. Fin du premier acte et début des hostilités. Madeleine, désormais ruinée mais bien décidée à se faire justice, imaginant un plan machiavélique pour rendre la monnaie de sa pièce à chacun de ceux qui l’ont abusée.
L’illusion de la facilité que je donne masque une manière de travailler plutôt lente, plutôt difficile
Dumas et les grands feuilletonistes du XIXe siècle ont murmuré à l’oreille de ce formidable conteur, qui réussit à résoudre cette équation romanesque délicate: trouver l’équilibre parfait entre une intrigue à tiroirs qui vous colle au fauteuil et une galerie de personnages complexes – plus gris que noirs ou blancs -, entre une mécanique narrative parfaitement huilée et une peinture ultraréaliste des travers de cette époque où la presse, la finance, la politique filaient – déjà – un mauvais coton. Plus incisif, plus méchant mais aussi plus drôle que le précédent opus, qui était habité par ce spleen spectral des lendemains de cauchemar planétaire, ce Couleurs de l’incendie a le goût acide du cynisme qui a proliféré à l’ombre des compromissions (fraude fiscale, corruption, populisme…), ces maux qui continuent de nous pourrir l’existence. On ne s’attache pas seulement aux personnages, y compris secondaires comme la diva castafioresque ou le solide et libertaire Dupré, on profite également d’une vue imprenable sur le naufrage moral, responsable d’une marée noire qui finit par engluer les âmes les plus pures. Madeleine en fait l’amère expérience: pour laver l’affront, elle va devoir s’abaisser au niveau de ses ennemis.

Peu importe au fond les étiquettes, roman populaire, historique, féministe, anarchiste, d’aventure, voire polar… Avec Lemaitre, on a et le flacon et l’ivresse littéraire. A l’image de la scène d’ouverture, magistrale, transformant un moment solennel – les funérailles – en roller coaster émotionnel convoquant burlesque, coup de théâtre et démonstrations de vanité, entre ralentis et accélérations fulgurantes. Ou comment attraper le lecteur par les tripes pour ne plus le lâcher.
Aviez-vous prémédité d’écrire une trilogie?
J’avais laissé ouvertes quelques portes à la fin d’ Au revoir là-haut pour le cas où. Ce sont des précautions de feuilletoniste. J’ai imaginé une suite pour retrouver la jubilation ressentie en l’écrivant.
Vous écrivez donc dans l’allégresse?
Non. Je travaille de manière assez laborieuse. Je n’écris pas facilement. L’illusion de la facilité que je donne masque une manière de travailler plutôt lente, plutôt difficile. Je ne suis pas un écrivain qui souffre mais je ne suis pas dans l’aisance, malheureusement.
D’où vient la jubilation, alors?
Au début du processus, on prépare l’intrigue, on prépare le scénario mais on laisse aussi beaucoup d’espace pour l’écriture. C’est là que naît la magie. Tout d’un coup vous écrivez un mot qui ouvre une nouvelle porte, vous déposez votre stylo et vous vous demandez avec excitation où cette idée va vous mener.
Vous avez emmagasiné énormément de documentation. Comment faire le tri?

Dans le genre de littérature qui est le mien, à savoir le roman d’aventure, ne pas savoir où on va, c’est l’assurance d’aller dans le mur. C’est comme pour un roman policier : si vous ne connaissez pas la fin, il y a beaucoup de risques que vous bricoliez une résolution qui ne sera pas satisfaisante, ni pour vous ni pour le lecteur. Il faut trouver un équilibre entre préparer suffisamment pour être sûr de ce qu’on veut faire, et ne pas non plus trop préparer pour laisser le soin à l’écriture de vous surprendre. Il faut éviter le piège de la documentation historique. Vous êtes souvent tenté d’utiliser tout ce que vous savez. Vous voulez rentabiliser quelque part les recherches que vous avez faites. Même si vous avez découvert des choses passionnantes mais qu’elles ne vont pas dans le droit fil de l’histoire, il faut les abandonner.
L’intrigue est redoutable et, en même temps, les personnages sont complexes. Souvent les romanciers soignent un aspect au détriment de l’autre…
Il faut trouver un bon équilibre, et ce n’est pas toujours facile, entre une intrigue assez solide pour tenir en haleine et des personnages suffisamment forts pour que le lecteur ait envie de les connaître, de les suivre. Ce que certains oublient parfois c’est qu’une bonne intrigue tient beaucoup aussi à la qualité des personnages secondaires. Sinon, vous avez l’impression de visiter une ville vide, comme s’il n’y avait personne dans les rues.
Vous êtes un peu une exception dans le paysage littéraire français. Vous écrivez des romans populaires, un genre encore souvent considéré comme mineur, et en même temps vous avez reçu le Goncourt…
Littérature populaire rime souvent avec littérature démagogique. On a l’impression que pour faire un livre populaire, il faudrait moins de mots, moins de vocabulaire, des intrigues moins complexes, comme si le public était idiot ou inculte. C’est une vision très réductrice de ce que peut être un roman populaire. Et c’est vrai que la littérature populaire est remplie de romans de gare qui ont tissé cette réputation. Elle n’est donc pas totalement surfaite. Se revendiquer d’un mode encombré de beaucoup de mauvais livres n’est pas toujours simple.
La fraude fiscale, la corruption, la place des femmes, le populisme, le chaos politique… Le portrait que vous faites de l’époque ressemble furieusement à ce qu’on connaît aujourd’hui…
Je n’ai pas voulu créer une duplication entre les années 1930 et aujourd’hui. Je ne pense d’ailleurs pas que l’histoire se répète de manière si mécanique. L’Europe d’aujourd’hui ne ressemble pas trait pour trait à celle des années 1930. Mais il y a évidemment des résonances. C’est intéressant, non pas d’expliquer le présent par le passé, mais de porter sur hier le regard d’aujourd’hui. C’est à ça que sert le roman historique. Comprendre comment nous en sommes arrivés là. Si je prends le thème de la fraude fiscale, il est fécond de se rendre compte que, dès les années 1930, les questions que nous nous posons aujourd’hui étaient déjà d’actualité. On peut le regretter et se dire que la politique n’a pas fait grand-chose pour changer ça.

Vous critiquez en filigrane le poids des experts dans les sphères dirigeantes. Difficile de ne pas faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd’hui…
Je raconte des histoires et chacun est libre d’en tirer la morale qu’il veut. Mais j’ai en effet été frappé de voir que dans les années 1930, on assiste à la naissance de la technocratie, c’est-à-dire le pouvoir des techniciens. Or, monsieur Macron a été élu en expliquant que la politique, c’était fini, qu’il n’était ni de droite ni de gauche, et qu’on allait mettre aux manettes des pragmatiques, des experts. C’est le degré zéro de la politique.
Pour vous, c’est une impasse?
Oui. La politique, c’est une vision de la société pour aujourd’hui et pour l’avenir. Si vous n’avez pas de vision pour l’avenir et que vous prenez des décisions au coup par coup, vous faites de la technique mais pas de la politique. La gestion de la cité réclame une vision un peu plus complexe.
On fête cette année les 50 ans de Mai 68. Qu’en reste-t-il aujourd’hui selon vous?
Tous les peuples, à tous les moments, cultivent des braises de révolte face aux systèmes politiques. Mai 68, on en a dit beaucoup de mal mais je retiens surtout que ce mouvement a changé la vie quotidienne des hommes et des femmes. C’est grâce à Mai 68 qu’on a eu des écoles mixtes, que les femmes ont eu accès à la pilule et à l’IVG. La reconnaissance du droit au plaisir est aussi à mettre à l’actif de cette période. Les femmes ont trouvé une nouvelle liberté, même si elle n’est jamais gagnée comme je le montre dans mon roman. Mai 68 nous a laissé quelques acquis durables sur lesquels nous vivons encore.
Le roman est moralement ambigu. Le personnage principal, Madeleine Péricourt, est à la fois victime et bourreau…
Cela tient à ma conception de la littérature. J’imagine un personnage auquel on peut adhérer parce qu’il agit pour des raisons légitimes et compréhensibles, et en même temps il fait des choses qu’on a envie de condamner. Au lecteur de faire son boulot. Quand il aura terminé le livre, il pourra décider si Madeleine a plutôt raison ou tort, si elle a agi correctement, si elle a été excessive dans sa vengeance, si elle est morale, immorale ou amorale. Je n’ai pas à dire aux gens ce qu’ils ont à penser, et encore moins à les obliger à penser comme moi.
Pierre Lemaitre président, quelle serait sa première décision?
J’appellerais auprès de moi des économistes atterrés en leur demandant quelle seraient les mesures économiques et fiscales, notamment sur la question de la répartition des richesses, qui permettraient de réduire cette fracture immense qui existe dans notre pays entre les plus pauvres et les plus riches, et qui est un volcan sur lequel nous sommes assis. On vient de ristourner aux riches 4,5 milliards d’euros alors que dans le même temps 400 personnes meurent tous les ans dans la rue.
On vous sent énervé sur ce sujet…
Ce qui m’insupporte le plus, ce n’est pas qu’il y ait des riches, je ne les tiens pas pour responsables de la pauvreté du monde. Mais je tiens pour responsables les politiques qui n’ont pas fait suffisamment de choses, ne se sont pas battus farouchement pour réduire la fracture entre le 1% qui détient le quart des ressources de la France et la masse des neuf millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C’est insupportable dans un pays moderne. Et ce faisant, les politiques entretiennent une braise sociale qui va inévitablement déclencher un incendie un jour ou l’autre…
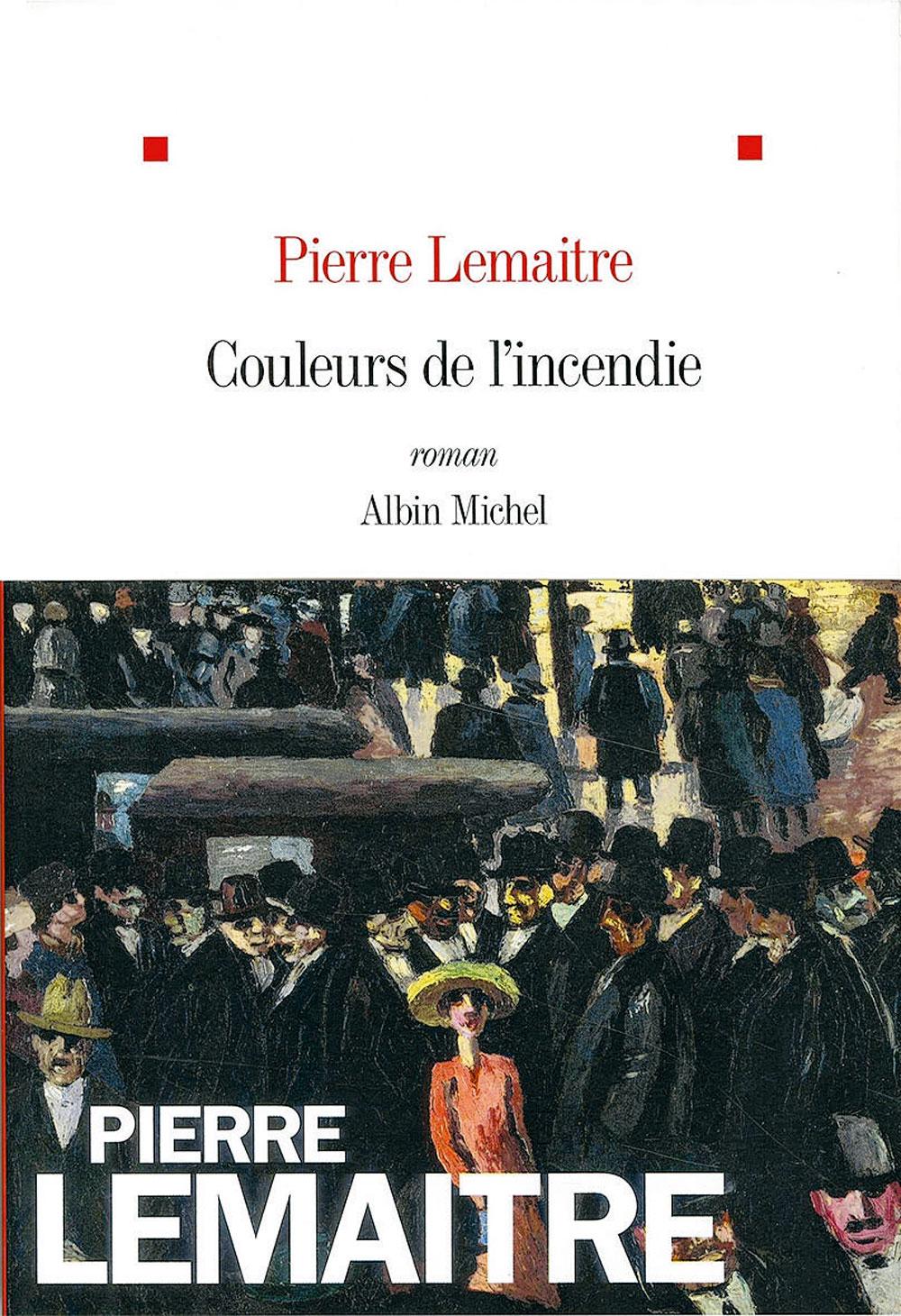
Que pensez-vous des nouvelles technologies, et notamment de leur impact sur la littérature?
Il n’y a pas à être critique. C’est un nouvel état du monde. On peut le regretter. On peut s’en féliciter. Mais on ne pourra rien y faire. Le développement des nouvelles technologies, on ne pourra pas l’arrêter car c’est un train qui va plus vite que notre faculté de penser. Et c’est en ça que la politique sert à quelque chose. Elle doit nous aider à penser ces phénomènes. Il faut plus de philosophes, de psychologues, de sociologues car les sciences sociales nous donnent les outils qui doivent nous aider à mieux appréhender ces nouvelles technologies. Quant à la littérature, elle n’est pas menacée. Elle va avoir une place plus réduite, mais elle a bénéficié pendant des siècles d’une position hégémonique qui était excessive. Il n’y avait que la littérature pour raconter des histoires. D’autres arts majeurs et aujourd’hui les nouvelles technologies font que ce territoire doit être partagé. Je pense qu’il y a de la place pour tout le monde. Je viens de terminer un roman mais je viens également de terminer l’écriture d’une minisérie de six épisodes pour Arte tirée d’un de mes romans, Cadres noirs. La fiction survivra, quelle que soit sa forme. On aura toujours besoin d’elle pour comprendre le monde et le décrypter.
Couleurs de l’incendie, par Pierre Lemaitre, éd. Albin Michel, 538 p.

