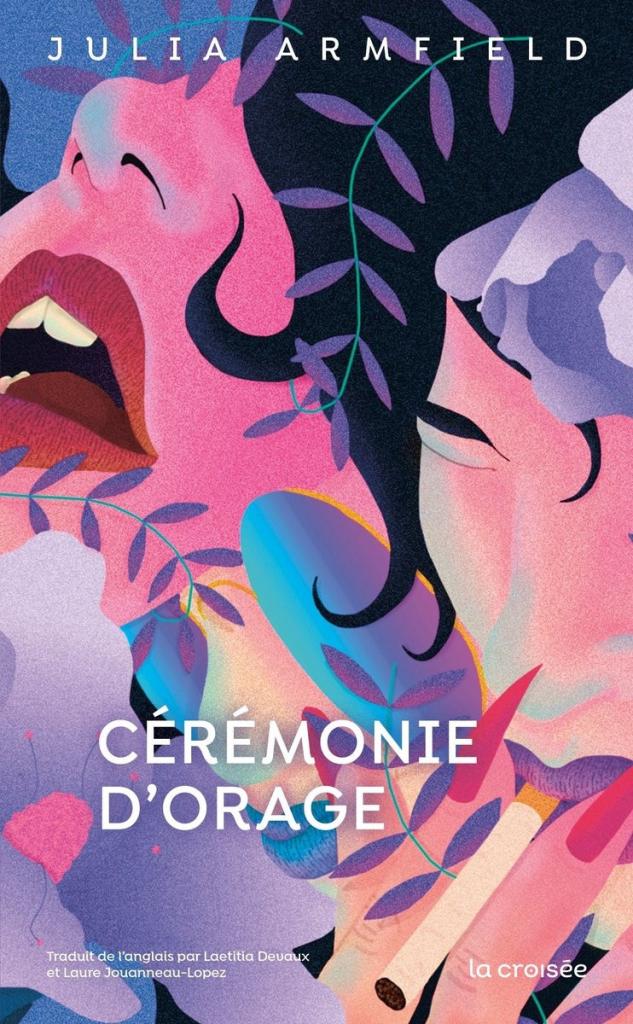Sheena Patel qui livre un premier roman incisif, un recueil de nouvelles de l’autrice coréenne Bora Chun ou Daphné Tamage signant un «guide à dévorer comme un roman» sur Bruxelles: nos choix bouquins pour la semaine.
1. Je suis fan
Premier roman de Sheena Patel.
Editions Gallimard, traduit de l’anglais par Marie Darrieussecq, 272 pages.
La cote de Focus: 4,5/5
«Je traque sur Internet une femme qui couche avec le même homme que moi.» Ainsi débute Je suis fan, premier roman de l’autrice londonienne Sheena Patel, une histoire d’obsession, amoureuse, un peu, identitaire, beaucoup. A travers la passion de la narratrice pour un homme pour qui elle n’est qu’un personnage secondaire, une amante occasionnelle qui à tout moment peut être «coupée au montage», l’autrice pose un regard perçant sur la question ultracontemporaine de la représentation de soi au temps des réseaux sociaux et des assignations identitaires.
Au fil d’un récit dense et rythmé par des chapitres aussi courts que percutants, la narratrice lève le voile sur la relation chaotique qui l’unit à cet homme qui aime le fait d’être vu aux côtés d’une femme racisée, et l’image de lui-même que cela renvoie, mais aussi sur sa propre construction narcissique, dans un monde où le récit de soi a pris le pas sur le soi. Jouer à être avant même d’être, avec les réseaux sociaux comme lieu d’exposition d’une intimité calibrée et caisse de résonance de nos existences devenues «marques individuelles scénarisées». La femme que piste la narratrice est blanche et bien née. Elle est de ces néohéroïnes urbaines mondialisées qui parviennent à «cueillir des légumes de façon photogénique», qui savent «où acheter de la poterie en édition limitée».
La critique est acerbe, mais la douleur irrigue chaque page ou presque, une douleur qui fait écho à celle des immigrants de la deuxième génération, un inconfort à être dans un monde où «la blancheur est partout, omniprésente», où elle est même «le principe». Alors comme tant d’autres, son identité réduite par la fétichisation dont elle fait l’objet de la part des hommes, et la précarité économique à laquelle elle fait face, elle joue le jeu de la grande «Altérité», sert «aux gens l’histoire qu’ils veulent entendre […] celle de notre assimilation à la blancheur ou de l’horreur ou de l’échec de cette assimilation». Sous ses dehors de conte âpre et moderne sur les dommages collatéraux des réseaux sociaux, c’est aussi et peut-être surtout une réflexion minutieuse sur la classe et la race que déploie dans une langue crue et incisive Sheena Patel.
A.E.
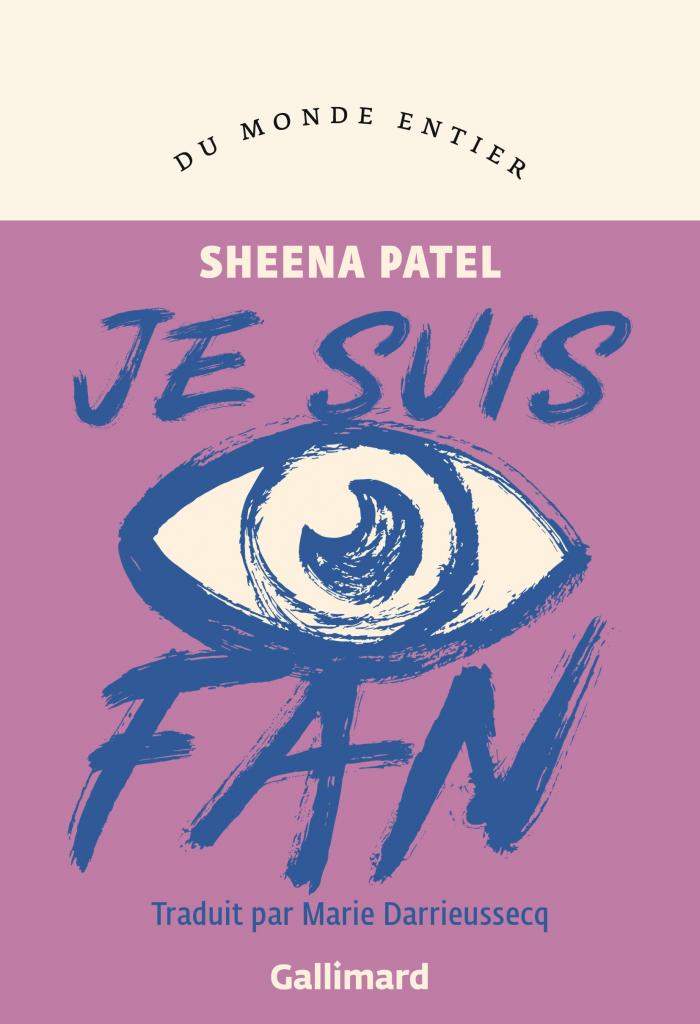
2. T’es mort
Roman de Sam Sax. Editions La Croisée, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Stéphane Vanderhaeghe, 256 pages.
Sa couverture pétaradante de couleurs flashy vous a forcément fait de l’œil en librairie. En plus, c’est auréolé d’un concert de louanges venu des USA et d’outre-Manche que le livre a débarqué chez nous. On n’a pas résisté bien longtemps. T’es mort (Yr Dead en V.O.), premier roman de Sam Sax, conte, à la première personne, la destinée d’Ezra, jeune libraire et activiste homosexuel. On l’apprend dès le début: Ezra finira par s’immoler par le feu lors d’une manif au pied de la Trump Tower de New York, «l’affreuse petite sœur de Babel». En une succession de vignettes parfois dans le désordre, on comprend peu à peu ce qui le mènera à cette funeste destinée.
Les noms de Justin Torres et d’Ocean Vuong, sensations littéraires US, sont mentionnés en quatrième de couverture –on avait effectivement pensé à eux dès les premières pages, promis. Comme Vuong d’ailleurs, Sam Sax vient de la poésie, et cela se sent: il a saupoudré son roman de mythes et de paraboles, et Ezra compare les bars à des lacs et leurs clients à de l’eau dont il s’abreuve… Il raconte aussi, du reste, ses virées dans les bars gays new-yorkais comme le Nowhere, et rappelle alors l’excellent Gay Bar: pourquoi nous sortions le soir de Jeremy Atherton-Lin (Tusitala, 2024). Malgré l’horizon peu jouasse qui s’offre à lui, Ezra sait aussi faire preuve d’une sorte d’humour (désespéré, forcément). Lorsqu’il fait les courses, il constate: «il y a tellement de monde que j’ai l’impression de m’être engagé à vivre ici et maintenant je crains qu’on me réclame un loyer.» Plus loin, il consigne les espèces, oiseaux ou rongeurs dont ce sera, comme pour lui, donc, la dernière année sur Terre («et ne me branchez pas sur les insectes»).
Il raconte la découverte de son âme militante, ses rendez-vous chez le psy, les coups d’un soir, les (nombreuses) déconvenues sentimentales, la violence de ce monde au bord du gouffre, bouffé par le tout-numérique. Puis son père, recroquevillé dans la religion juive depuis que la mère d’Ezra, elle, s’est soudainement volatilisée, et enfin cet Edwin mentionné dès les premières pages, et dont Ezra semble avoir été très proche… Ezra confesse «observer la vie comme un océanographe, un genre de commandant Cousteau» –et comme un écrivain qui dit merveilleusement son époque.
M.R.
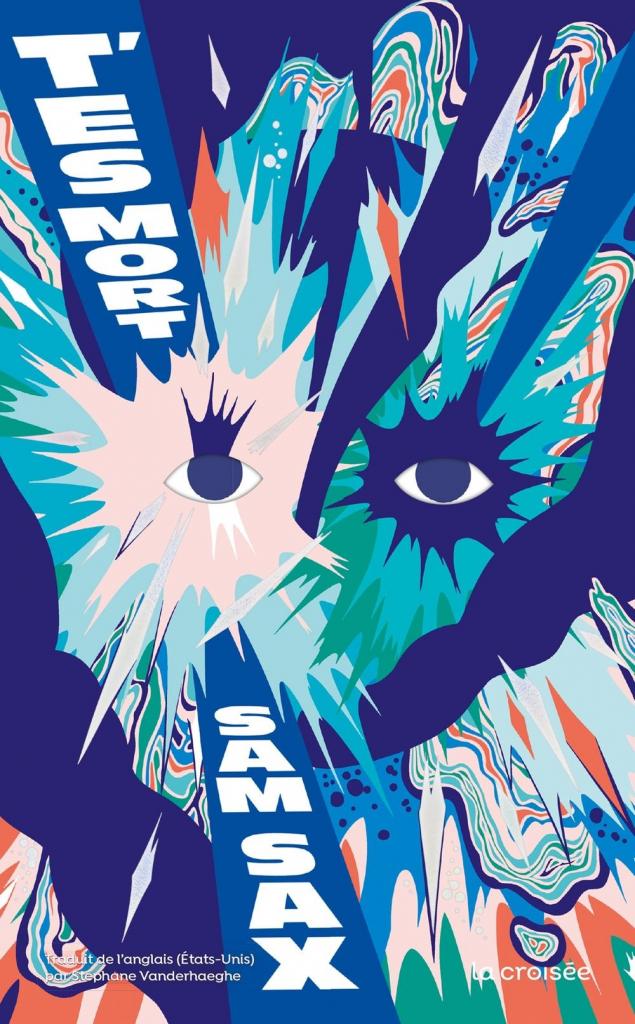
3. La Ronde de nuit
Recueil de nouvelles de Bora Chung.
Editions Rivages, traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou, 260 pages.
La cote de Focus: 3,5/5
Les amateurs de nouvelles et de «Korean Horror» connaissent sans doute déjà le nom de Bora Chung, autrice révélée il y a deux ans par Lapin maudit sorti au Matin Calme, mais qui ressort aujourd’hui en poche pour son arrivée chez Rivages avec son deuxième recueil de nouvelles, formant cette fois un tout, toujours aussi étrange voire malaisant. La Ronde nuit se découpe en sept nouvelles se déroulant toutes dans un étrange institut ultrasécurisé, et dont les cellules tiennent à l’écart du monde des objets hantés et/ou des animaux eux-mêmes porteurs de phénomènes paranormaux parfois spectaculaires. Un mouchoir brodé d’un oiseau capable de prendre vie, des baskets hantées par un agneau, un chat qui se demande qui l’a tué, un livre qu’il vaut mieux ne pas lire… Et tout autour, dans les couloirs, des surveillantes de nuit qui conversent avec l’Ancienne, aveugle mais éclairée, et qui tous ont pour tâche de «protéger des êtres sans vie pour qu’ils ne souffrent pas dans ce monde de lumière». Si l’étrange l’emporte cette fois sur l’effroi, Bora Chung fait à nouveau preuve d’un imaginaire étonnant, sans doute typiquement coréen, et tout en atmosphères.
O.V.V.
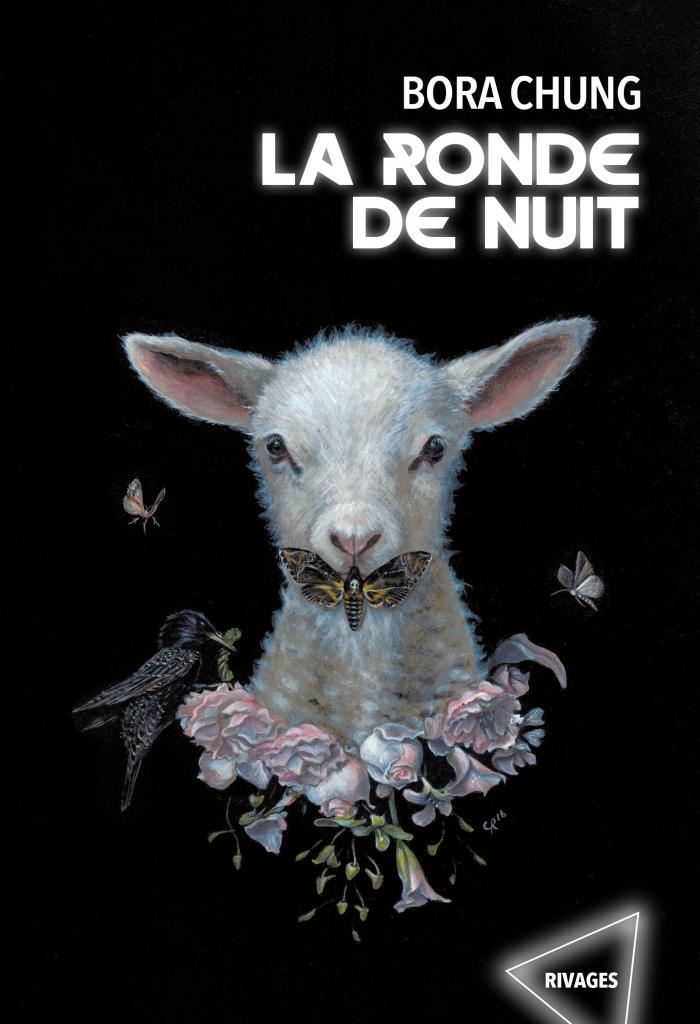
4. Pitié
Premier roman d’Andrew McMillan.
Editions Grasset, traduit de l’anglais par Laurent Trèves, 240 pages.
La cote de Focus: 4/5
Classée dernière commune d’Angleterre en matière de revenus, Barnsley s’accroche à ses souvenirs. La montée du club en Premier League remonte à 1996; le pub est devenu une église. Durant les années 1970, le toit s’est effondré sur les mineurs qui travaillaient sur le front de taille. Depuis, victimes collatérales du déclin de l’industrie lourde, les habitants se sentent piégés sous un ciel «chaussette grise usée jusqu’à la corde» et l’estime de soi demeure fragile. Costume deux-pièces et perruque trop grande, Simon répète le filage de son numéro de drag dans un pub. Il trépigne à l’idée que son père et son petit ami Ryan découvrent Puttana Short Dress, sa Thatcher effrontée clamant: «For the women of the working class!» Agent de sécurité dans un centre commercial, Ryan se repasse subrepticement les images de leur rencontre. Désormais, Simon se montre catégorique: «Si tu viens pas au spectacle, pas la peine de revenir.»
Plongé(e) au cœur des bassins miniers à l’heure de l’appli Grindr et des vidéos de sexe OnlyFans, cet étonnant roman sociétal et queer privilégie la subtilité psychologique au lyrisme. Avec un souci quasi documentaire, Andrew McMillan explore comment les catastrophes se fondent dans la mémoire collective. Puissante, la technique littéraire se fait discrète: tout est question de point de vue, d’angle, de hors-champ. A l’image de la scansion répétée du regroupement matinal des mineurs, ivres de fatigue, faisant mine de lacer une chaussure quand ils manquent de tomber. Entre Ken Loach et Mike Leigh, sur le fil entre le cru et la retenue, on entend siffler l’accent local «reight» (non pas «right»). «Appartenir au passé. J’ai le cœur qui se serre rien qu’à y penser, mais j’ai peur d’oublier et que tout revienne s’immiscer en moi jusqu’à ce que j’en étouffe.» Une découverte!
F.DE.
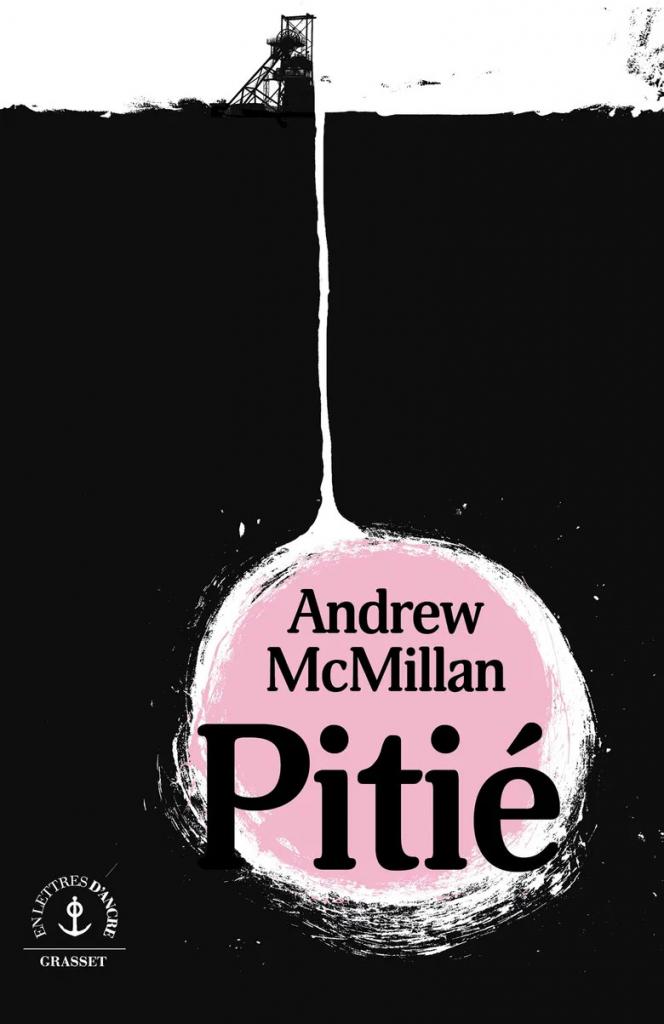
5. Bruxelles
Roman-guide de Daphné Tamage.
Editions L’Arbre qui marche, 144 pages.
La cote de Focus: 3/5
Daphné, jeune femme mi-carolo mi-uccloise, croyait en avoir fini avec cette ville qu’elle aime et qu’elle déteste –«J’avais réussi à m’échapper des griffes de la capitale désordonnée où j’étais née»– mais voilà que la mort de son mentor l’oblige à y revenir d’urgence. Un trip rapide qui démarrera à l’hôtel Espérance et se finira gare Centrale, et qui la verra (re)fouler, et (re)découvrir, maints quartiers, rues ou monuments décrits comme sur Wikipédia, et pour cause: ce Bruxelles se veut «un guide à dévorer comme un roman», voire comme un (court) roman à parcourir comme un guide. Il rejoint avec Tokyo, Bogota, Rome ou Barcelone la jeune collection «Premier voyage» dont chaque volume propose un lieu, un auteur du cru, cinq itinéraires de promenade et un plan. Soit beaucoup de contraintes et de contorsions pour l’auteur qui s’y colle, et encore plus quand on nourrit pour son sujet un tel mélange d’attraction et de répulsion.
O.V.V.
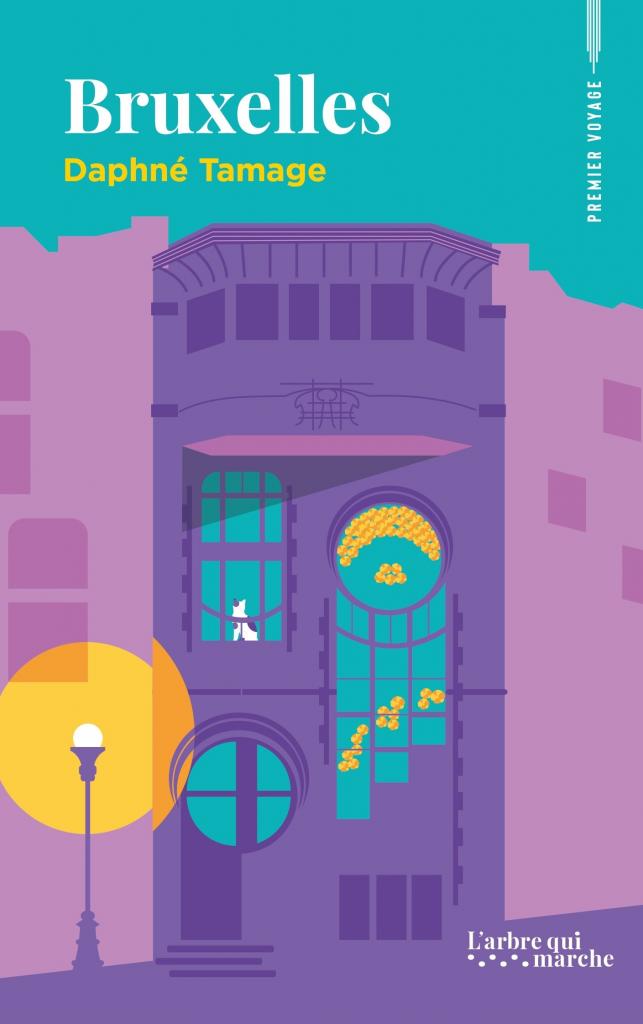
6. Cérémonie d’orage
Roman de Julia Armfield.
Editions La Croisée, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux et Laure Jouanneau-Lopez, 304 pages.
La cote de Focus: 4/5
Trois sœurs tentent de faire face à la mort de leur père, architecte réputé, dans une ville de Londres sous eaux: c’est Venise, mais en pire, et à l’échelle de la planète entière –il pleut presque sans discontinuer et la cité des Doges a d’ailleurs totalement disparu. Dans cette atmosphère de désastre permanent, la folie gagne doucement la population… Les points de vue alternent entre chacune des sœurs Carmichael, toutes trois lesbiennes; on les suit dans leurs couples respectifs, dans leurs échanges rendus délicats au fil du temps par ce père problématique. On y suit aussi la ville, personnage à part entière, craquant de partout sous le poids de cette eau qui la submerge. On se dit au départ que, tout de même, ça parle et ça réfléchit beaucoup dans Cérémonie d’orage. Mais dans ce roman ultramaîtrisé, son premier traduit en français, Julia Armfield parvient à toucher le lecteur à chaque page, tant elle tape juste sur la complexité du deuil ou les relations familiales. Avant un final dont on se souviendra, elle brille aussi à décrire la vie dans une société capitaliste comme la nôtre. Non, «ce n’est pas simple, ces temps-ci, de savoir être au monde».
M.R.