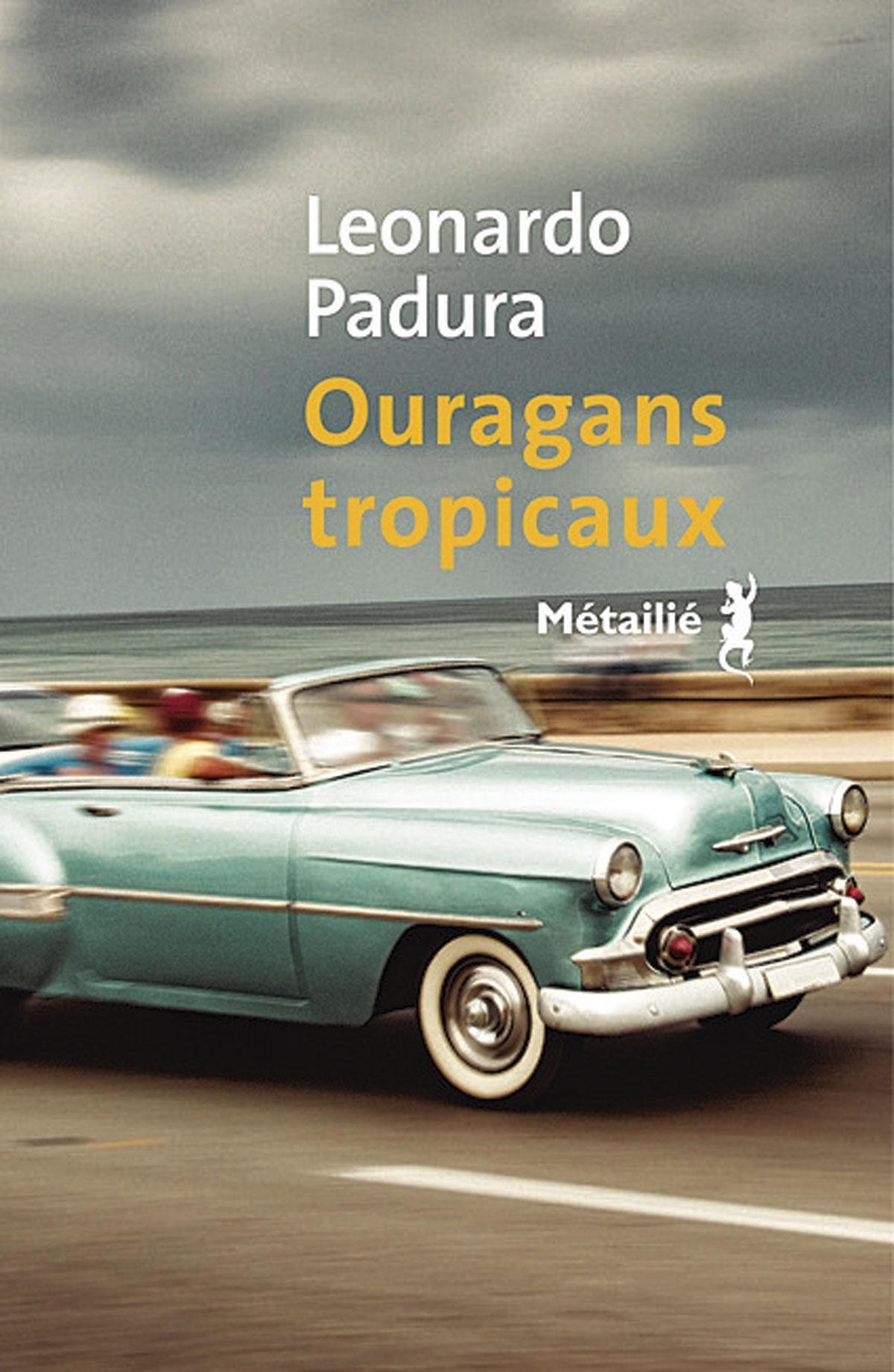Leonardo Padura ressuscite une dixième fois son ex-flic Mario Conde pour un roman policier devenu grande fresque historique et sociale, à travers trois moments-clés de Cuba, pour autant d’espoirs déçus.
Il y a, dans Ouragans tropicaux, “les crimes de sang du passé, ceux du présent et puis ceux, spirituels, de 1970”. Leonardo Padura entame son récit -l’un de ses meilleurs- par ceux du présent. Nous sommes en 2016, et La Havane connaît une effervescence rare: la capitale de Cuba va célébrer sa traditionnelle Fête des Travailleurs, mais va aussi recevoir le président Barack Obama, visite qui sera immédiatement suivie par un concert des Rolling Stones! Un moment d’ouverture et d’espoir qui voit revenir en masse les touristes américains, mais que regarde, avec beaucoup de circonspection, cynique et pas dupe, l’ex-flic Mario Conde -“aujourd’hui il y a du fric, et derrière le fric, les problèmes”.
Devenu à la fois bouquiniste, “vieux de merde” et apprenti-romancier, Conde est sollicité par la police, débordée, pour résoudre un crime sordide: le meurtre de Quevedo, alias “L’Abominable”, un ancien camarade-commissaire et censeur qui a brimé bien des artistes dans les années 70, et à qui on a aujourd’hui coupé le pénis et trois phalanges. Mario Conde va hésiter, pas longtemps, à s’en charger. D’abord parce qu’il craint de découvrir “que celui qui l’a tué est quelqu’un que j’aime bien”, et puis parce qu’il a mieux à faire: avancer sur le texte qu’il consacre au gangster Alberto Yarini et au Cuba de 1910, lorsque La Havane devenait la “Nice des Amériques” et que tout semblait possible -même un tenancier de bordel pouvait projeter de devenir le président de la toute nouvelle République de Cuba! Ces deux moments, 1910 et 2016, sont évidemment connectés, et pas seulement parce qu’ils ne véhiculeront que des espoirs déçus. Soit l’exacte matière première d’un des plus grands écrivains cubains de son temps qui, à l’instar de Sergio Ramírez au Nicaragua ou Paco Ignacio Taibo II au Mexique, a fait du polar un roman social fort et éminemment critique. De passage à Paris, l’auteur de bientôt 70 ans nous a consacré quelques instants à l’ombre de son double de papier, cet “acharné du souvenir” dans un pays “qui se débarrasse de ses frustrations en nourrissant l’oubli”.
Vous aviez délaissé le polar et votre personnage fétiche depuis quelques romans. Pourquoi y revenir aujourd’hui, une dixième fois depuis 1991 et Passé parfait?
Leonardo Padura: Il y a dans ce roman deux personnages qui me poursuivent depuis longtemps: Mario Conde et Alberto Yarini. Retrouver le premier allait de soi: nous parcourons le monde ensemble depuis 30 ans, il a toujours été mes yeux pour regarder la société cubaine. Il a son histoire, sa personnalité, mais nous avons beaucoup de points communs. Quant à Yarini, il me fascinait déjà lorsque j’étais journaliste. C’est un de ces personnages historiques sur lequel tout le monde sait quelque chose mais personne ne sait tout. Une sorte de mythe qui véhicule tous les clichés du macho cubain, un dandy au discours politique assez étrange pour l’époque. J’ai eu l’occasion de publier un long article sur lui, puis j’ai essayé d’en faire un film (Leonardo Padura est également scénariste, NDLR), mais dans les années 90, c’était déjà la crise… Le personnage a continué d’être là, à me poursuivre, jusqu’à ce qu’il sorte de l’ombre et s’invite dans ce roman. J’ai tout de suite été attiré par l’idée de faire se toucher ces deux moments historiques de Cuba et de La Havane. En 1910, alors que l’on pensait que la comète de Halley allait peut-être percuter l’île, La Havane devenait une ville moderne et un outil précieux pour l’industrialisation du pays, en même temps que Cuba devenait une demi-colonie américaine. Et en 2016, avec Obama, ce fut le retour de vrais échanges culturels, sportifs, académiques. L’argent et les touristes affluaient… Dans ces deux moments, il y a eu l’illusion d’arriver enfin à quelque chose de meilleur. Et dans les deux cas, ce fut comme des ouragans tropicaux, qui passent, détruisent tout et continuent leur chemin…
On peut en effet lire votre dernier roman comme le récit de trois déceptions qui hantent l’Histoire cubaine: la fin de l’idéal républicain, l’échec du modèle communiste et enfin cette brève ouverture américaine, qui s’est vite refermée avec Trump.
Leonardo Padura: On a même cru un moment qu’il y avait une vraie possibilité de lever l’embargo qui nous étrangle depuis 60 ans, mais Trump a tout de suite refermé la porte, juste pour plaire aux lobbys républicains du sud de la Floride. Le Covid a encore empiré les choses, et Cuba connaît aujourd’hui une crise profonde, où tout manque: la nourriture, les médicaments, l’essence. Toute une nouvelle génération prend la fuite: 230 000 Cubains sont partis rien que l’année dernière, et ce sera la même chose cette année.
À vous lire, l’espérance est une douleur. Elle ne provoque, à Cuba, que déception.
Leonardo Padura: Au contraire, je dirais que ce qui manque le plus aujourd’hui à Cuba, c’est l’espoir justement. Les gens sont fatigués, résignés, et nous vivons une Histoire où tout change, mais chaque fois pour le pire. Je vois des jeunes partir parce qu’ils pensent ne pas avoir de futur, et c’est ma responsabilité que de dire et écrire ce qui se passe. Il y a dans tous mes romans une vision critique de la réalité cubaine. Conde est peut-être encore plus pessimiste et désenchanté que moi, mais toute ma littérature interroge la vie cubaine, et le caractère même du système. Ça fait longtemps que, ici ou ailleurs, le roman noir est devenu une littérature à vocation sociale. Je n’ai aucune prétention politique, mais j’ai une responsabilité civile, et je l’exprime dans ma littérature.
Ouragans tropicaux ****(*), de Leonardo Padura, éditions Métailié, traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis, 496 pages.