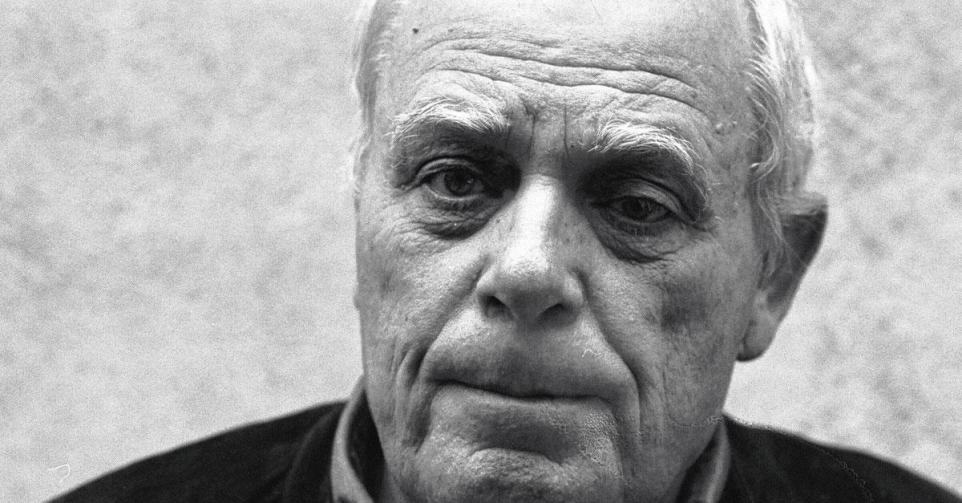Dans La Dernière Porte avant la nuit, Lobo Antunes fait expier à cinq acolytes le meurtre d’un chef d’entreprise et leur passé troué d’obsessions.
Ils sont cinq partners in crime (littéralement) à avoir commis l’irréparable: enlever un chef d’entreprise fortuné sur un parking, l’emmener en fourgonnette en laissant derrière eux sa petite fille (il les a suppliés de l’épargner), l’étrangler, se débarrasser du corps et de toute preuve. Malgré la violence des faits et leur complicité avérée surnage la certitude de s’en sortir si aucun d’entre eux ne se met à table. Mais leur inconscient ne leur laissera aucun répit: les voix du meneur de bande, appelé “le patron” (plein de rancœur personnelle envers l’homme qu’il fomente d’assassiner), de son frère (toujours dans l’ombre, fantasmant sur l’image des jeunes filles éternelles, comme la sœur du mort), de l’herboriste (qui, malgré son assurance de façade, se révèle physiquement impuissant entre les lignes), du collecteur du billard (poursuivi par ses actes à chaque partie) et du second collecteur (abandonné par son père un jour d’anniversaire) vont alterner en 25 chapitres, comme autant d’années de peine qu’ils peuvent encourir.
Corps-à-corps avec la langue
Si “sans corps, il n’y pas de crime” devient le leitmotiv avec lequel chacun des coupables se rassure, persuadé de passer entre les mailles du filet, c’est qu’en tant que personnages, ils ne sont pas conscients que chez le grand romancier Lobo Antunes, c’est avant tout la langue elle-même qui fait office de tronc. C’est un organisme révélateur qui sue, hoquette, trébuche, génère des plaques d’eczéma à force de ritournelles de pensées monomaniaques chez chacun des suspects. Comme la chair de la victime, la structure de la phrase (parfois jusqu’au mot, scindé en plein élan) se dissout à chaque chapitre dans un bain d’acide massif. C’est celui d’enfances marquées au fer rouge, grevées par la peur du noir ou d’être enlevé par les gitans, par la solitude ou la violence intrafamiliale, celui aussi de rêves monstrueux comme ceux qui agitent le collecteur du billard (“Me rendormir avec les mâles à cinq pattes […] et pas seulement cinq pattes, au moins trois cents dents chacun”). Si ces hommes, “incapable[s] de se redresser”, sont englués dans leurs souvenirs et leur crime, leur bassesse (envers les femmes auxquelles “[ils] n’entrave[nt] que pouic”, envers les étrangers, envers eux-mêmes) et leurs failles sont des cicatrices rouvertes mais aussi transcendées par la mécanique même du texte, par le flux rythmique que prend leur bile amère. Saluons ici à juste titre le travail d’horloger de Dominique Nédellec (traducteur de l’écrivain portugais depuis Mon nom est légion en 2011) pour rendre la puissance d’uppercut des effets en français. On connaît décidément bien peu d’auteurs qui mettent de façon aussi magistrale le lecteur au tapis et ce, à chaque round.