Echantillonnant critique radicale et langage de la street, Fabrice Pliskin ausculte les métamorphoses contradictoires d’une société qui se radicalise.
Le Fou de Bourdieude Fabrice Pliskin
Le Cherche Midi, 496 p.
La cote de Focus: 4,5/5
Après avoir tué accidentellement un des braqueurs de sa bijouterie, Antonin Firmin écope de huit ans de prison et devient un symbole de l’autodéfense. Au milieu des forces obscures, l’assassin de Chamseddine découvre la sociologie. C’est une révélation! Assis au bout de son lit, Pierre Bourdieu semble vouloir l’absoudre: «Ne dites jamais: c’est ma faute. Dites: c’est la faute aux forces systémiques.» Ayant purgé sa peine, celui qui se fait désormais appeler Suburre prend sous son aile un «garçon tragique venu de l’autre côté du périphérique». Sondant une humanité tragique et boiteuse, Pliskin dynamite les rouages du livre-enquête dans une épopée hallucinée à l’ironie féroce. Abasourdi, le lecteur assiste à la radicalisation d’un daron au physique de mannequin senior, prônant un «Bataclan contre les dominants». Une «bête d’ubiquité», adepte d’un voguing verbal, oscillant entre le Jean Carmet de Comment réussir quand on est con et pleurnichard et la faconde d’un Jean-Pierre Marielle dans Les Galettes de Pont-Aven. Dynamitant les niveaux de langage, ce brûlot sauce samouraï bastonne entre Fight Club et le Houellebecq d’Extension du domaine de la lutte. Stupéfiant!
Dans Le Fou de Bourdieu, Fabrice Pliskin essore l’air du temps et croque une époque en pleine grève du sens. Après avoir découvert la sociologie en prison, un bijoutier de province prend sous son aile un jeune dealer qu’il veut affranchir du joug des dominants. Le nez dans Bourdieu et une montagne de coke, le ventriloque usurpateur fonce tête baissée pour déboulonner «la fable enchanteresse de la méritocratie»… Les compères deviendront les criminels les plus recherchés de France.
Toxicité des réseaux, radicalisation, explosion de la drogue, masculinité en berne, déterminisme social…, c’est toute une France miniature qui se fait tailler un costard XXL. A travers la figure d’un daron mi-prophète mi-diva, emboutissant tout sur son passage, ce roman-bélier à l’humour retors signe la rencontre improbable et jouissive entre Flaubert et Fight Club. «Moi aussi, j’ai fait du sale.»
Blessant mortellement un des braqueurs de sa bijouterie, votre héros devient une icône de l’autodéfense sur les réseaux. Une façon de donner un ancrage réaliste au livre?
C’est inspiré d’une histoire vraie. Il y a une dizaine d’années, un bijoutier a tué un de ses assaillants; tout de suite, l’extrême droite l’a porté aux nues, créant un site pour le soutenir. Dans Une histoire trop française (Fayard, 2017), je m’étais inspiré du scandale des implants mammaires toxiques… Je le vois comme un effet de réalité. Si je cite l’émission Chroniques criminelles, c’est parce que l’aspect burlesque est par ailleurs très présent. Il faut «bétonner» le contexte du monde où vit le héros. J’aime beaucoup le détail: dans un roman, on se souvient moins d’une idée que d’un parfum.
«Désespérer mon lecteur, ça me plaît bien… Et le divertir, aussi, j’espère.»
En prison, Suburre découvre la sociologie de Bourdieu, s’en empare… alors même qu’il n’y comprend pas grand-chose. Est-il une incarnation de l’homme-capharnaüm qui dérive dans son époque?
C’est ce que j’appelle «la grève du sens». Ce n’est pas un roman à thèse, plutôt un roman dont le héros a une idée fixe. Ce n’est pas tant Bourdieu qui m’intéresse que l’usage social de sa pensée, notamment sa simplification, sa zombification à travers le ping-pong dominants-dominés. Suburre, qui est peut-être le plus mauvais disciple de Bourdieu, voudra passer à l’action. Cela m’amusait de faire à la fois un roman d’éducation et d’action. La quadrature du cercle, c’est comment rendre ce personnage attachant. Il faut prendre un type, au sens littéraire du terme: le méchant, le naïf, et mettre de sa chair et du sang là-dedans.
A la manière de Flaubert ou du dessinateur Daniel Goossens, vous confrontez absurde et sérieux pour faire jaillir un humour de la confusion.
Flaubert disait que «Bouvard et Pécuchet avait la prétention d’être une comédie». Pour moi, la «littérature» commence quand je prête mes pensées à un personnage ridicule. J’ai besoin de passer par un certain comique pour accéder, sinon à la vérité, disons à une certaine humanité. Flaubert et Proust sont «mes» grands comiques. Chez tous nos grands maîtres, il y a toujours de la drôlerie. En BD, la lecture de Pilote a été décisive, puis Gotlib, le dieu de mon enfance. Il y a un côté héroï-comique chez Suburre. Un peu comme les bonshommes de Sempé: tout petits sur la page blanche, en train de dire des choses définitives alors que rien ne se passe. Le burlesque est profondément humain, peut-être plus que la souffrance qui a pour elle la légitimité de la noblesse.
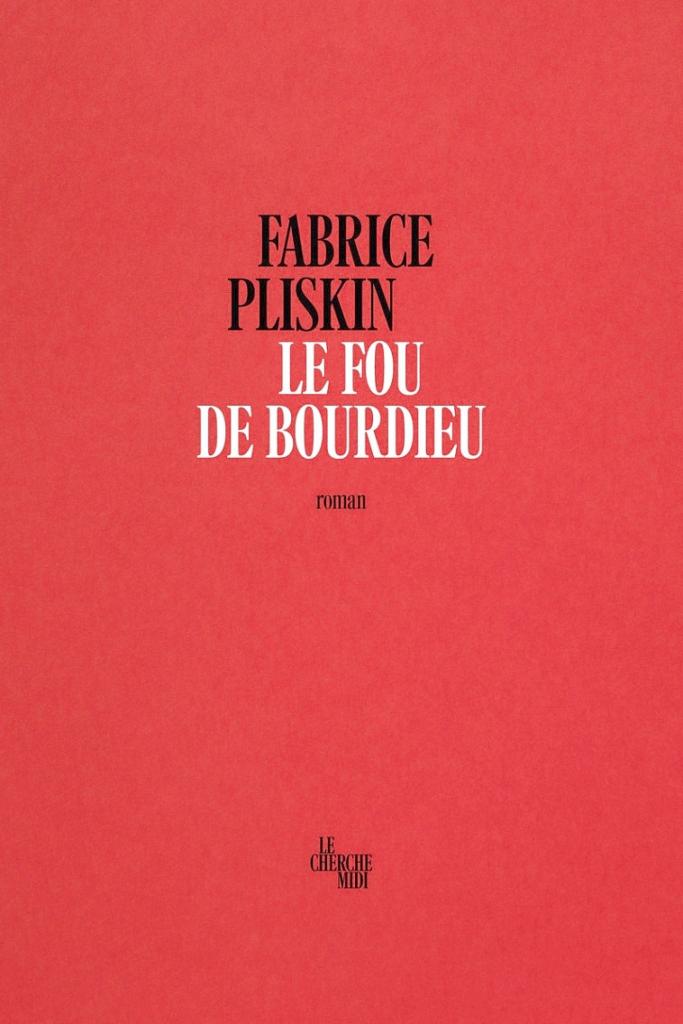
Souhaitant soustraire son pupille Chamseddine au joug des dominants, Suburre se radicalise… Qu’est-ce qui le pousse dans cette voie?
Suburre veut devenir une meilleure personne parce qu’il a commis l’irréparable: il a tué quelqu’un. En Chamseddine, il veut trouver le fils qu’il n’a pas eu. En même temps, il en joue avec une certaine coquetterie. L’esprit de système lui est venu à travers ses lectures… Comme il cultive une haine du dilettantisme, il y va «à donf». Il faut essayer de suivre son personnage jusqu’au bout. Je n’aime pas être en accord complet avec le héros d’un roman. C’est ce que Tchekhov appelait «l’équilibre des plus et des moins». Il a beaucoup de moins, Suburre… (sourire)
Suburre et son voisin journaliste sont tiraillés par des questions liées à la masculinité… Peut-on dire que vous passez à la broche la France d’aujourd’hui?
Un roman, ça dit merde à tout le monde. C’est très sain et très heuristique, si j’ose dire (sourire). C’est aussi un roman sur la masculinité, notamment au travers d’un stage de sensibilisation. L’homme, c’est la «nouvelle blonde», comme on disait stupidement au sujet des femmes blondes. Sur la représentation de l’homme, la visibilité des minorités, etc., j’ai mis beaucoup de paroles ou de gestes de femmes dans les personnages masculins et vice versa. Je trouve très intéressant que l’homme soit devenu ce personnage déchu, toxique, burlesque… Pour un romancier, c’est du caviar. Le roman médicament n’est pas ce que je recherche. Désespérer mon lecteur, ça me plaît bien… Et le divertir, aussi, j’espère.
Votre échantillonnage des registres de langage, notamment de la rue, crée un effet détonant. Une mise en abîme du déterminisme social?
J’ai deux sources. La littérature classique, notamment russe, et l’air du temps. Je lis beaucoup La Fontaine mais aussi les commentaires sur les réseaux sociaux. Je n’y trouve pas le même plaisir, mais quand on prend une douche chaude, il faut prendre une douche froide. La rue est un ruisseau plutôt qu’une source, mais j’y reprends des phrases entendues. L’académisme me déprime. Il ne faut pas fermer les frontières de sa prose. Ce qui me passionne, c’est de mettre des choses personnelles et d’autres qui ne sont pas de moi dans le même personnage. C’est la littérature «Ziggy Stardust» ou le masque des Daft Punk. Suburre est un mimétique qui tente de s’adapter à son jeune public. Il veut plaire à une certaine jeunesse prolétaire et démunie par souci de rédemption. C’est intéressant d’essayer de se saisir du Narcisse en nous-même. Ne serait-ce que pour le ridiculiser, mais aussi pour savoir qu’il habite là.
