Des actes manqués, des moments de bascule, Comédies françaises, le nouveau roman d’Eric Reinhardt en est plein. Le romancier y traite autant de l’invention ratée par la France d’Internet que le destin d’un jeune contemporain. Ironique et élégant à la fois.
C’est l’histoire d’un « ratage français », explique d’entrée de jeu Eric Reinhardt. Quand au coeur des seventies, la France de Valéry Giscard d’Estaing, assoiffée de renouveau, mettait un terme aux délicates années d’après-guerre et se tournait vers l’avenir. Quand Louis Pouzin, ingénieur en informatique, mettait au point le datagramme, invention qui devait aboutir plus tard à la création d’Internet, création cette fois américaine. Son idée de base: la commutation par paquets, à savoir l’envoi de données via un réseau informatique et leur regroupement grâce à des informations utiles à leur agencement à la réception. A cette idée de génie, l’Hexagone a préféré une autre, la commutation de circuits, plus simple mais qui monopolise un circuit entier pour permettre le transfert de ces données. C’est le principe du Minitel, gloire des télécoms françaises, un succès… pour un temps et une relégation aujourd’hui dans les vitrines des musées des technologies.
Qu’est-ce qui a poussé la France à laisser filer l’invention du siècle dans ses laboratoires? La faute à qui? « Les industriels français ont manqué de vision, de flair. Les Américains, eux, ont pressenti qu’il y avait quelque chose », résume l’auteur de Comédies françaises (1). « Le monde des télécoms n’a pas vu le potentiel de cette innovation venue du monde de l’informatique, considérant les informaticiens comme des concurrents. Ambroise Roux, qui était le président de la CGE (Compagnie générale d’électricité), avait entrepris de combattre le secteur de l’informatique pour nuire à l’un de ses concurrents principaux, Paul Richard, président de Thomson. Il va convaincre le président Valéry Giscard d’Estaing de mettre un terme au plan Calcul de la délégation générale de l’informatique et de fermer Iria, le laboratoire où travaillait Louis Pouzin. »

L’histoire fascine Eric Reinhardt autant que Dimitri, le jeune journaliste à l’AFP protagoniste du roman. A l’instar de son créateur, ce jeune homme bien de son époque – on y reviendra – se lance sur les ressorts de cette histoire et y voit la marque d’un certain esprit français, « le capitalisme d’influence, celui de pouvoir naviguer dans le monde de la politique, pour s’attirer les bonnes grâces politiques et obtenir de la sorte des marchés, rappelle-t-il. Il y avait quelque chose à la fois de paresseux et de très confortable chez ces grands patrons très conservateurs, qui ne se remettaient jamais en question, pensant que jamais rien de funeste ne pouvait leur arriver. »
On a l’impression qu’il n’y a plus de possibilité de liberté, de fantaisie.
A l’opposé, on retrouve l’opportunisme pragmatique américain, cette capacité à pouvoir se saisir de la science, de savoir qu’en faire, « ce qui pousse les Américains à penser ce qui pourrait être utile à nos contemporains et lucratif ». Cet acte manqué ne sera pas le dernier dans l’histoire de l’informatique européenne. Récemment, une excellente enquête aux allures de roman à suspense, écrite par le journaliste Quentin Jardon, remontait la trace de Robert Cailliau, ingénieur belge au Cern de Genève à l’origine, avec le Britannique Tim Berners-Lee, du World Wide Web, création majeure elle aussi reprise lucrativement par les Américains (2). « Dans le fond, il y avait quelque chose de beau chez les scientifiques européens de vouloir mettre à la disposition de tous cette invention, ajoute Eric Reinhardt, alors que les Américains, avec cet esprit qui les caractérise, se sont plutôt demandé s’il n’y avait pas de l’argent à se faire. » Un péché d’idéalisme, donc.
Nouveau monde
Interpellé par cet épisode malheureux de l’histoire industrielle française, Dimitri est un « pur produit de la méritocratie républicaine ». Issu d’une famille ancrée à gauche qui le pousse à faire Sciences Po, il est engagé presque par hasard par un grand cabinet de lobbying parisien. D’abord indifférent au grand écart idéologique auquel le contraint sa fonction, il va finalement démissionner sans plan précis, si ce n’est celui de devenir écrivain. Il sera finalement journaliste. Eric Reinhardt, à travers ce personnage, traite d’une classe moyenne qu’il regrette absente de la littérature française actuelle. « Aujourd’hui, beaucoup de jeunes diplômés ont fait des études très poussées, ont une soif de connaissance énorme. Dès qu’ils arrivent dans la vie professionnelle, ils s’ennuient très vite de la platitude des tâches à faire. Dans les entreprises, les décisions viennent d’en haut, les process sont très verticaux, les directions mondialisées. On a l’impression qu’il n’y a plus de possibilité de liberté, de fantaisie. Le système plein de petits hommes gris nous accule à devenir son propre petit homme gris. » « On se « petit-homme-grise » », analyse Eric Reinhardt, qui n’a pas son pareil pour brosser le portrait d’une génération – Le Moral des ménages (2002) dépeignait déjà de manière caustique la middle class – qui préfère sacrifier un poste lucratif pour une fonction dans la culture ou l’humanitaire, plus en phase avec ses idéaux, et faisant le deuil d’une vie paisible, mais ennuyeuse, toute tracée.
Le système plein de petits hommes gris nous accule à devenir son propre petit homme gris.
« Le jeune individu occidental avait répondu à la contrainte de discontinuité par un désir de discontinuité », résume dans son livre un romancier qui appuie patiemment et justement sur ce trait de ses jeunes contemporains aux parcours professionnel et sentimental éclatés que Dimitri partage avec sa copine Alexandra. Reinhardt a ce don du dialogue dans ces scènes de bar ou de restaurant que l’on dirait extraites d’un film – une comédie française en l’occurrence -, des pages à la fois légères et profondes. Dimitri lui confie ses obsessions, notamment pour cette jeune femme que le hasard a mise par trois fois sur sa route. « De nature à se laisser capturer par le détail », Dimitri y voit le signe d’un amour promis par le destin, bercé par un romantisme presque naïf, par ce détail capable « d’entraîner très loin dans une passion momentanée son imaginaire captivé ».
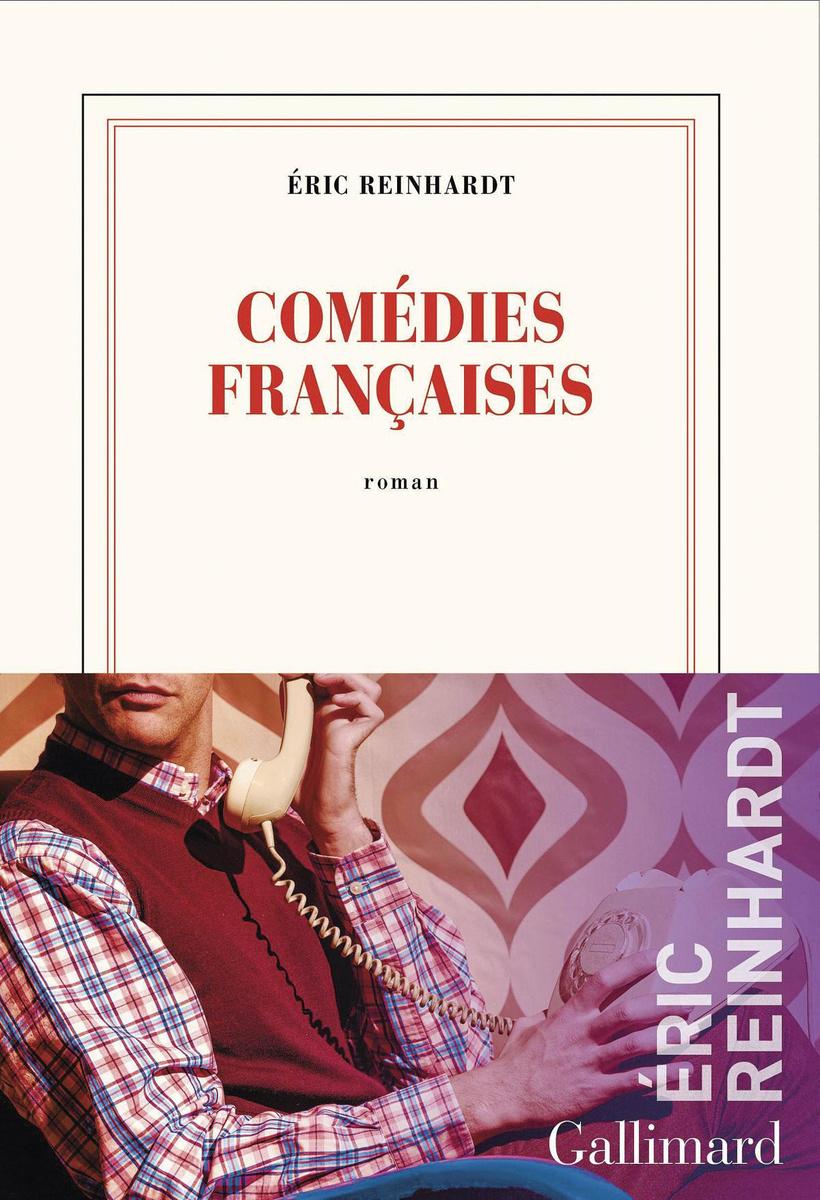
Variant les rythmes, osant l’esthétique, l’élégant Eric Reinhardt ajoute dans de passionnantes pages un autre instant fantasmé par Dimitri, ce moment par lequel Max Ernst aurait inspiré l’art du dripping à Jackson Pollock, donnant ainsi naissance à l’expressionnisme abstrait. Ici encore, le déplacement, à travers un corps européen, de l’épicentre de l’art mondial de Paris vers New York. Et la CIA cette fois de s’en mêler. Comédies françaises met en perspective ces points de basculement historiques où l’esprit de conquête a manqué et nous présente une génération qui ne demande qu’à s’en saisir. Avec ironie, humour et amour de l’art.
(1) Comédies françaises, par Eric Reinhardt, Gallimard, 480 p.
(2) Alexandria. Les pionniers oubliés du Web, par Quentin Jardon, Gallimard, 256 p.
