Catherine Meurisse était, comme Luz, en retard à la réunion de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Un traumatisme dont la laideur ne pouvait être combattue que par la beauté. Et par La Légèreté, son formidable album.
Le dernier album de Catherine Meurisse, outre son absolue réussite, n’est décidément pas comme les autres: même à elle, surtout à elle, on a du mal à dire qu’il est « formidable » ou « génial », au vu des circonstances qui l’ont fait naître. Le 7 janvier 2015, Catherine Meurisse n’a fait qu’entendre les coups de kalach’ des frères Kouachi, mais elle y a perdu plus que huit collègues, amis ou mentors; elle y a aussi perdu « la mémoire, les émotions et le dessin« . Un traumatisme et un état de dissociation qui la mènent aux bords de l’abîme, et sur un océan de laideur dont elle sent instinctivement que la beauté y sera sa seule bouée de secours. La Légèreté raconte non pas les attentats, mais bien ce lent et douloureux processus, plus universel, et qui, des couchers de soleil aux statues de la Villa Médicis à Rome, va l’emmener lentement d’un silence de mort vers un silence de vie. Un silence et une légèreté encore fragiles, qui ne se résoudront pas, comme chez son ami Luz, en un ou deux albums. Mais qui révèlent aujourd’hui une artiste et dessinatrice majeure, capable malgré elle de faire pousser des fleurs sur un tas de fumier. De l’art comme thérapie réparatrice et de la beauté comme réflexe sécuritaire, il y a tout ça, et bien d’autres choses y compris beaucoup d’humour, dans sa magnifique Légèreté née d’un poids insoutenable.
Vous n’en avez pas marre, qu’on vous demande comment ça va? La formule est chargée, vous concernant…
(Elle rit, comme elle le fera beaucoup durant cet entretien). Je réponds que ça va mieux grâce à la réalisation de ce livre. Je savais aussi qu’il faudrait que j’en parle ensuite, mais ça me permet de continuer à préciser ma pensée. J’ai fait ce livre pour me prouver que je n’étais pas morte, que je pouvais retrouver le dessin et la parole -les deux sont liés. Et puis, la répétition est de bon aloi: l’année passée, j’avais tout oublié, là j’ai bien conscience que je rabâche un peu!
Sauf erreur, l’album Catharsis de votre ami Luz a été le déclencheur de cette Légèreté…

Oui. Après l’attentat, nous sommes restés un groupe, nous avions besoin d’être ensemble pour nous sentir vivants. Mais Luz, qui a été mon phare dans les ténèbres après le 7 janvier, a brisé ce « nous » en se lançant dans Catharsis. J’ai très vite compris qu’il ne me lâchait pas, au contraire. Il me montrait une voie pertinente: il fallait que je dise « je » à mon tour pour pouvoir me reconstruire. J’avais continué de dessiner des strips dans Charlie, mais c’était une pulsion, un dessin appauvri, de l’ordre du réflexe. En commençant à dessiner La Légèreté, je prenais conscience que le dessin n’était pas mort, que je devais chercher à le nourrir à nouveau, en allant à Rome, en cherchant la beauté. En revanche je n’aurais pas utilisé le terme de « catharsis », et Luz non plus n’est pas dupe: son livre est un hurlement et il a bien fait de l’extérioriser, mais on aura besoin tous les deux de faire d’autres livres pour retrouver l’apaisement, pour diluer un peu de ce chagrin qui nous est tombé sur la gueule.
Vos manières de l’exprimer sont de toute façon très différentes: Luz est encore dans la colère, la souffrance pure…
Avec Catharsis, Luz racontait un état, là où je raconte un processus, c’est déjà une grande différence. Et lui est capable de dessiner dans le chaos, quand j’ai besoin d’un peu de calme. Mais il y a ce même recours à l’art pour pousser un cri d’effroi, et briser ce silence que nous ont imposé les terroristes. Avec son nouveau livre (voir ci-dessous), Luz avait besoin de passer par un autre, par Albert Cohen, pour se raconter -il en avait marre de sa personne, de son image renvoyée par les médias. Pour moi, c’est le contraire: je n’ai cessé dans mes albums précédents de passer par d’autres corps, de « dé-panthéoniser » les grands peintres et les grands écrivains, de mêler nos vies à la leur. Dans La Légèreté, je n’éprouve pas le besoin de passer par un auteur, mais bien celui de livrer ma voix.
On sent que votre rapport au temps a, lui aussi, beaucoup changé depuis les attentats…
Oui, c’est évident, le temps s’est arrêté le 7 janvier. Aujourd’hui, je ressens l’urgence d’être dans la lenteur, ne plus être dans le temps des médias et de l’actualité, mais dans celui de la littérature, de la bande dessinée. Un temps qui a de la matière, du sens. Charlie, j’y produis encore un strip chaque semaine, mais il n’a plus rien de politique, il est générationnel, parle de libido, d’amour, de plaisir, de frustration… Je ne vais plus au journal, je ne participe plus aux réunions. Luz avoue que la contrainte du dessin hebdomadaire lui manque. Pour l’instant, elle ne me manque pas; je me passe très bien de la nervosité qu’exige le dessin de presse et de la laideur de l’actualité.
Un tel attrait pour la beauté semble rare chez les caricaturistes, effectivement plus habitués à chasser la laideur…
Surtout chez Charlie! Cabu, par exemple, ne se lassait pas de la laideur, des beaufs, il savait vraiment transformer le plomb en or. La quête de beauté a été pour moi une intuition. Il ne me restait plus que ça, l’intuition, ainsi que la perception. Le choc avait annihilé ma mémoire, ma concentration, mes facultés intellectuelles, ce qui m’a vraiment terrifiée. Je me suis retrouvée dans un état d’hypersensibilité face aux paysages, à l’art, à la beauté. Je sentais bien que cette sensibilité était anormale, et j’ai essayé de retranscrire cet état transcendant dans la séquence qui ouvre l’album. Il m’a fallu m’enfoncer dans une bulle de solitude et être attentive à tout ce que je ressentais pour retrouver la rêverie, nécessaire pour créer de nouveau. En résidence à la Villa Médicis, les massacres me hantaient, je les voyais partout dans les musées ou sur les murs de Rome; la violence, omniprésente dans l’art, m’est revenue en plein dans la figure. Il a fallu que je dessine ces moments de face-à-face avec la beauté intemporelle pour refaire surface.

Question délicate ou compliquée: votre album ou ceux de Luz prouvent que la beauté naît aussi de la tragédie. Force est de constater que ce drame a fait naître de grands livres…
Oui, c’est un constat amer. Je n’en reviens toujours pas, et ça me fait mal au coeur de le penser, de le théoriser. C’est très troublant. J’ai fait ce livre à l’instinct et, vraiment, avec les moyens du bord et du moment. Il est né d’une béance. Il y a aussi une idée de revanche et de fidélité à Charlie: dans La Légèreté, je dis merci à beaucoup de monde, je sais ce que je dois à tous mes amis assassinés; j’ai grandi à leurs côtés, j’ai acquis auprès d’eux une gymnastique intellectuelle qui ne me quittera pas.
De fait, l’art est toujours lié à une forme de violence, comme dans le Guernica de Picasso…
L’art permet de sublimer les pulsions, entre autres de mort. Quand on est spectateur, face à la beauté, notre conflit intérieur s’apaise, la beauté a cela d’utile qu’en vous enveloppant, elle vous fait cesser un moment de penser, pour ensuite vous faire penser autrement. Je suis retournée, depuis, à la Villa Médicis: devant les Niobides (un ensemble de statues grecques qui en occupe les jardins, NDLR), je ne vois plus du tout les massacres comme ce fut le cas lors de mon premier séjour, comme je le raconte dans l’album. L’état d’hypersensibilité m’a quittée – ce qui signifie que je vais mieux. Mais je reste attentive encore aujourd’hui à toutes les formes de beauté. L’amitié en est une.
L’art comme thérapie? Difficile à faire entendre dans le climat sécuritaire d’aujourd’hui…
« Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité« , dit Nietzsche. Je vois l’art comme une protection, une sécurité. Il me permet de m’approcher du brasier sans me brûler: la « vérité », pour moi, après le 7 janvier, c’était la haine, les attentats, la mort. J’ai toujours considéré l’art comme un voile qui nous fait supporter la réalité et la voir de manière différente, plus riche, plus claire. L’art est mon plan Vigipirate à moi.
LA LÉGÈRETÉ DE CATHERINE MEURISSE, ÉDITIONS DARGAUD, 136 PAGES. *****
Catherine Meurisse, de Reiser à Brétecher
Catherine Meurisse, née en 1980, participe -et gagne- un concours de dessin de presse à l’âge de 21 ans. Dans le jury figuraient Jul, Honoré et Tignous, qui l’invitent à venir travailler à Charlie Hebdo. Elle y entre définitivement quatre ans plus tard, en 2005, après avoir fini ses études en arts graphiques et en arts décoratifs. Outre ses dessins de presse pour Charlie Hebdo et d’autres titres de presse, et de nombreuses illustrations jeunesse, elle signe plusieurs bandes dessinées dont Mes hommes de lettres et Le Pont des arts chez Sarbacane, Drôles de femmes chez Dargaud avec Julie Birmant, ou Moderne Olympia chez Futuropolis. Délaissant depuis les attentats le dessin de presse politique, Catherine Meurisse entend aujourd’hui reprendre un projet entamé puis abandonné avec les attentats de Charlie Hebdo: il y sera question de paysages et, à nouveau, de beauté.
Luz n’en a pas fini avec les attentats de Charlie. Il publie l’adaptation très personnelle et douloureuse d’un récit d’Albert Cohen sur la découverte de l’antisémitisme et, surtout, la perte de l’innocence.
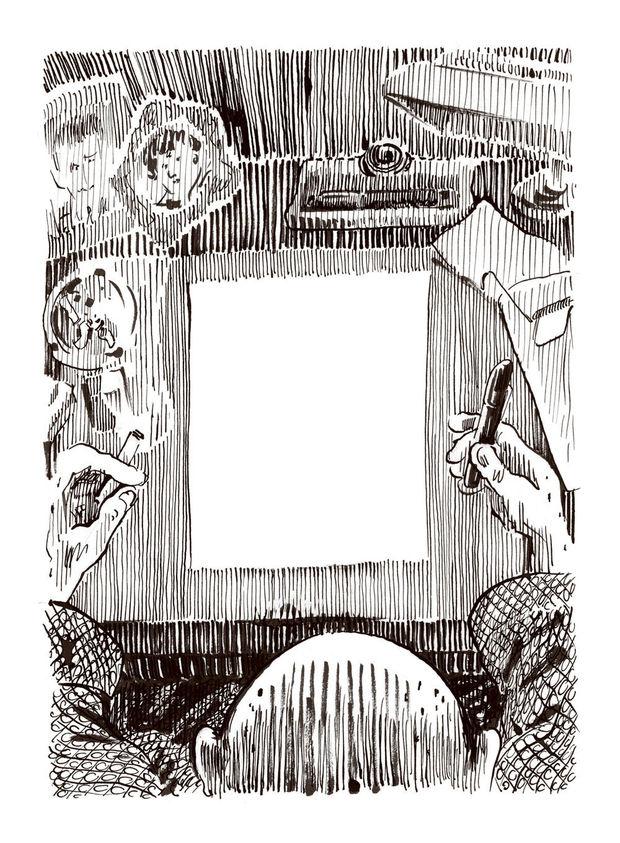
Il y a un an, Catharsis fut un cri. Celui du dessinateur Luz, qui avait échappé aux attentats du 7 janvier, mais qui y a perdu, comme Catherine Meurisse, beaucoup d’amis et l’envie de dessiner. Un récit bouleversant très personnel et coup-de-poing, dessiné à la rage, sur les jours qui ont suivi l’innommable: son quotidien, ses sentiments, ses larmes, sa colère. Son humour aussi, ultime politesse, c’est bien connu, du désespoir. Un livre qui devait lui permettre, si pas de se relever, d’au moins avancer. Un an plus tard, Luz revient avec un album tout aussi poignant, mais cette fois paradoxal: l’auteur a choisi d’adapter le récit intime d’Albert Cohen, Ô vous, frères humains, dans lequel l’écrivain, alors âgé de 77 ans, racontait son traumatisme originel. Le jour de son dixième anniversaire, un camelot de rue l’alpague et l’invective, à coups de « sale youpin! » sous les yeux d’une foule partagée entre l’hilarité et l’indifférence. Une découverte de l’antisémitisme qui va bouleverser le petit garçon qu’il est, et qu’il n’oubliera jamais. Un an après Catharsis donc, Luz adapte ce récit -à nouveau un cri. Qui résonne à chaque page, à chaque trait de plume, de sa propre souffrance et de son propre désespoir.
« Ne voyez-vous pas que je vous aime? »

Cette perte de l’innocence habite Luz depuis les attentats, et explique à elle seule le pourquoi de cette adaptation, brillante mais douloureuse de bout en bout. D’une incroyable maîtrise graphique et narrative, Luz se concentre sur ce moment fondateur et sur les affres intérieures qui désormais minent le petit Albert (et le grand Luz), soit plus de cent pages presque toujours muettes, où le texte, rare mais saisissant, devient un véritable personnage, organique: il envahit la tête du petit Albert, le hante, l’abîme. Une souffrance née de la rencontre avec « la haine imbécile » que Luz transforme en cri d’effroi mais aussi d’amour: « Ne voyez-vous pas que je vous aime? », se dit ainsi Albert (et évidemment Luz). « Ne voyez-vous pas que je ne peux pas vivre sans vous? » Et d’achever son récit d’une rare puissance visuelle par les dernières pages, cette fois in extenso, du récit de Cohen: « En vérité, je vous le dis, par pitié et fraternité de pitié et humble bonté de pitié, ne pas haïr importe plus que l’illusoire amour du prochain (…). » Rarement adaptation aura autant parlé de son adaptateur.
Ô VOUS, FRÈRES HUMAINS, DE LUZ, D’APRÈS L’OEUVRE D’ALBERT COHEN, ÉDITIONS FUTUROPOLIS, 136 PAGES. ****

