Ce long week-end de Pâques, faute de chasse aux oeufs dans les bois, ce Crash Test S05E30 est parti à la recherche des pièces les plus douteuses bien qu’adorées de sa collection personnelle. Cinéma, bandes dessinées, littérature et musique: vivent les gros plaisirs coupables, plus que jamais!
CINÉMA
Bad Influence, film de Curtis Hanson, avec Rob Lowe et James Spader (MGM, 1990)
La dernière fois que j’ai revu ce film, je l’ai trouvé plutôt nul, à peine un cran au-dessus d’un bon vieux Hollywood Night de TF1. Bien entendu, Commando avec Schwarzie et les idioties de tueur mexicain avec Banderas sont aussi nulles mais au moins est-ce drôle, alors que ce Bad Influence se prend quand même pas mal au sérieux. Aucun second degré ici, en effet: c’est fabriqué par une équipe compétente, avec des acteurs compétents, sur un scénario pondu par David Koepp, un type notoirement (très) compétent. Bref, beaucoup de compétences au service d’une production au message franchement chelou puisque Bad Influence fait partie de cette branlée de films américains du début des années 1990 qui insinue que toute tête qui dépasse est forcément suspecte. Yes, folks, pour vivre heureux, traversez dans les clous, ne blaguez pas avec des inconnus dans les bars, épousez des pimbêches névrosées et concentrez-vous sur votre carrière ploutocrate. Ce que James Spader ne fait évidemment pas dans le film, entraîné par Rob Lowe d’abord dans la gentille déconne, ensuite dans la luxure et, enfin, dans le crime pur et simple.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Bref, une histoire cousue de fil blanc, dont le pitch tient d’ailleurs dans le titre. 30 ans après l’avoir vu au cinéma, deux fois la même semaine, je ne sais d’ailleurs toujours pas pourquoi je voue à Bad Influence un culte certain, certes un peu honteux. Ce n’est même plus qu’un simple plaisir coupable, c’est carrément devenu une très grosse pièce à conviction à verser au dossier cherchant à percer le mystère que représente la personne que j’étais à 20 ans pour le quinqua que je suis aujourd’hui. Qu’est-ce que j’ai aimé dans cette daube? Comment est-ce possible que j’aie pu trouver incroyable l’appartement où habite Rob Lowe dans le film alors que je n’en voudrais pas aujourd’hui pour ranger ma planche à repasser? Pourquoi cette scène ridicule de fête à Los Angeles où le DJ passe Orane des Négresses Vertes m’a marqué à ce point? Pourquoi j’ai acheté ce DVD, surtout? AU PRIX PLEIN!!!
BANDE DESSINÉE
Stray Toasters de Bill Sienkiewicz (Epic Comics, 1988)
Parce que j’étais alors dans une école d’art graphique et que c’était visuellement intéressant, pas joli du tout, sombre, torturé et différent de tout le reste, j’ai acheté à leur sortie les 4 tomes en version originale de cette oeuvre un peu maudite de Bill Sienkiewicz, un type surtout connu pour avoir dessiné des romans graphiques « décalés » de super-héros Marvel et des pochettes pour groupes à grosses guitares aujourd’hui oubliés, du genre Corrosion of Conformity. My english was quite shitty à l’époque et je n’ai donc rien compris à cette histoire qui mélange Satan en vadrouille, traumatismes familiaux, perversions sexuelles et grille-pain tueur… Enfin, je crois. Parce que même si my english is frankly much better now, je ne comprends toujours rien à Stray Toasters. Comme à chaque coup devant Lost Highway de Lynch, je m’accroche, je crois tenir, cela fait sens et puis, zbam, vient toujours un moment, jamais le même, où tout s’embrouille, où ça décroche, où j’ai l’impression que l’on me retire la carpette de sous les petons. Et comme je ne suis pas de ceux que ce genre de procédé fascine et fait hurler au génie, je suis alors généralement très fâché et fort frustré. Sauf avec Sienkiewicz. Parce que tout abscons et prétentieux soient ces bouquins, je suis quand même bien content de les avoir et d’en avoir été imprégné d’une façon ou d’une autre. Après, faut pas pousser. Pas me demander de les résumer. Et encore moins me demander si je les aime vraiment, au fond.
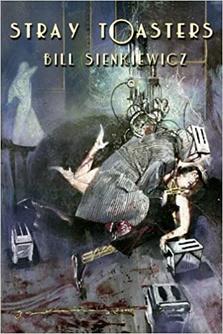
LITTÉRATURE
Pitou et autres récits de Henri de Meeûs (Marque Belge, 2017)
La littérature francophone belge en général, okay. J’aime beaucoup Georges Rodenbach, j’aime beaucoup les meilleurs Simenon (Lettre à mon Juge, Chez Krull, Le Bourgmestre de Furnes…). J’aime Un Mâle de Camille Lemonnier, ce western entre Sambre et Meuse. J’aime l’histoire du culte antoiniste par Robert Vivier. J’ai aimé Jean Ray, Thomas Owen et Henri Vernes. La littérature francophone belge au XXIe siècle, en revanche, rien que de l’écrire, je suis plié.
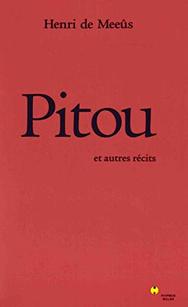
Une exception: Pitou, étrange recueil de nouvelles reçu dans le cadre du boulot, il y a trois ans. Un livre composé de 15 nouvelles assez inégales, bizarres, pas toujours bien menées, ayant pour cadre des homes de vieux à Ixelles et la déprime existentielle hors-saison à La Panne. Mais ce qui m’a surtout frappé dans Pitou, c’est que d’une histoire à l’autre, dès qu’il a moyen de renvoyer une femme à ses casseroles et un « basané » à la suspicion de vol de poules, c’est à chaque coup carnaval. À force d’accumulations et de systématisme, on en vient donc forcément à se demander si c’est là un procédé littéraire pour accentuer le côté méprisable et « petit belche » des personnages ou alors, des opinions personnelles mal filtrées dans la fiction. Je n’accuse personne. Je ne suis pas un Social Justice Warrior. Au contraire, ça me fait plutôt grand plaisir d’être secoué et déstabilisé dans un livre par un vocabulaire on va dire « inopportun ». C’est aussi toujours plus intéressant quand le doute s’installe quant à ce qui sépare réellement l’auteur de ses personnages. Une opinion de moins en moins populaire, je sais! Mais certains l’aiment trouble!
MUSIQUE
Big Audio Dynamite: This is Big Audio Dynamite (CBS, 1985)
DJ Hell: Munich Machine (V2, 1998)
The Little Rabbits: Yeah! (Rosebud, 1998)
Voilà trois albums de musique qui sont au mieux assez douteux, au pire carrément bourrins. Je les aime pourtant d’amour vrai depuis la première écoute. Peu importe qu’ils râpent pas mal les oreilles, sentent la mayonnaise tournée et sont souvent inscrits dans les marges du genre musical qu’ils représentent. Leur principal problème: pas assez mauvais pour être considérés comme géniaux au second degré et par snobisme. Pas assez bons, ni influents, pour être réhabilités. Bref, du vrai crétin, du pas bon du tout. Ce qui n’enlève rien à la grosse patate ressentie à chaque fois que je les écoute. Osons carrément le scandale: qu’est-ce que j’en ai à foutre de Combat Rock? Pour moi, le premier Big Audio Dynamite, deuxième groupe de Mick Jones après The Clash, est l’album qu’ils auraient du sortir tous ensemble après Sandinista! La carte funk, rap, sampling et synthés chelou à fond. Évidemment, 35 ans plus tard, ça sonne maintenant encore plus ringard que S’Express, mais bon… C’est pas Pop Will Eat Itself non plus, quand même. Et de toutes façons moins grave que Munich Machine de DJ Hell.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Gros dossier, celui-là. Il faut en effet bien se mettre dans la tête qu’idéalement, en 1998, la techno, ça restait le futur, Blade Runner, du dub contemplatif pour rouler la nuit sur les autoroutes allemandes, Jeff Mills fringué par un couturier design. La classe totale… Or là, schnitzel muzak sur toute la ligne (de coke). Tonton Helmut nous fait des reprises oumpapa de classiques new-wave (Suicide Commando, Warm Leatherette…), pompe allègrement une cover disco culte du For Your Love des Yardbirds et joue avec le Copacabana de Barry Manilow. Bref, ce n’est plus Blade Runner du tout, c’est farandole à l’Oktoberfest. Flemmard, roublard, escroc, nawak: un sommet, peut-être bien indépassable!
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Troisième bourre de ce tiercé perdant ou gagnant, je n’ai toujours pas décidé: les Little Rabbits, jeanfoutres vendéens le temps de cet album parachutés à Tucson, Arizona, pour y enregistrer avec Jim Waters, producteur alors ultra hype responsable du son du Jon Spencer Blues Explosion. Résultat des courses: quelque chose de vraisemblablement tout aussi improbable que ce qui serait sorti de Abbey Road si on y avait calé Plastic Bertrand avec Georges Martin ou fait rencontrer RZA et Benny B à New York. Accent plouc quand ça chante en anglais, paroles débilosses, (« what does it mean, dindon?« ), compositions approximatives sous forte influence Gainsbarre/Colombier mais en rock feignasse, indolence généralisée et sans aucun doute largement alcoolisée… C’est vraiment n’importe quoi! N’importe quoi mais aussi une BO assez parfaite pour un confinement en appartement alors qu’il fait 25 degrés dehors! « Dans la piscine de tes parents, qu’est-ce qu’on s’emmerde… » Attendez les gars, bande de cloches: me parlez surtout pas de piscine, OKAY?
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

