Menacée de cécité, la présentatrice de l’émission 28 minutes sur Arte raconte son combat contre la maladie au fil d’un récit plein d’esprit et d’humour qui oppose au désespoir les bienfaits de la nature, de la culture et du surnaturel.
« L’état de mes yeux est stationnaire, avec une possible dégradation, nous dit-elle sur ce ton badin qui est à la fois son bouclier et son glaive. A vérifier dans un mois. Je dois normalement faire des contrôles tous les quatre mois mais comme je suis paranoïaque, je dis aux ophtalmologues plutôt tous les trois mois. Le plus, le mieux. Sans trop rapprocher les rendez-vous non plus, sinon on ne vit plus que pour ça. » Elisabeth Quin a appris, il y a dix ans, qu’elle souffrait d’un double glaucome qui pourrait à terme la rendre aveugle. « La vue va de soi, écrit-elle dans La Nuit se lève, jusqu’au jour où quelque chose se détraque dans ce petit cosmos conjonctif et moléculaire de sept grammes, objet parfait et miraculeux, nécessitant si peu d’entretien qu’on le néglige. » Depuis, elle rumine, interpelle, implore, insulte, sonde cette maladie qui grignote chaque jour un peu de son champ de vision. Avec ce mélange d’espièglerie, de profondeur et d’auto-dérision – un cocktail qu’elle sert tous les soirs dans son émission d’info sur Arte -, l’auteur de Tu n’es pas la fille de ta mère compile dans une espèce de journal de bord les fragments de réflexions, d’anecdotes, de souvenirs, de punchlines – « Malvoyante et femme à barbe? La double peine » -, glanés au fil de ses nuits d’angoisse, de ses lectures, des consultations médicales, de ses pèlerinages et de ses rencontres avec d’autres aveugles plus ou moins célèbres. Un bouquet garni de sensations au parfum raffiné et cruel qui met le corps et la condition humaine à l’épreuve d’un questionnement érudit et roublard. Pas de place pour l’autoapitoiement. C’est la dignité en bandoulière que cette jeune femme de 55 ans aiguise ses autres sens au contact de la nature, de la culture et même de l’invisible. « Je sais aujourd’hui, peut-on lire, qu’il faut pardonner à sa pieuvre, pardonner à son corps, à tout ce qui s’autodétruit à l’intérieur de soi, pardonner à ce qui vous veut du mal. Il faut pardonner en bloc. Pour s’alléger. » On l’a rencontrée pour y voir plus clair…
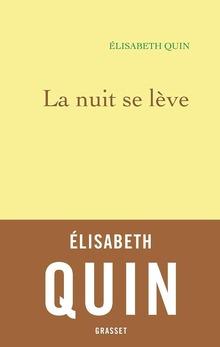
Pourquoi avoir choisi la forme autobiographique et pas, par exemple, le roman?
Je n’ai aucune imagination. J’aimerais infiniment écrire des romans épiques, des épopées, de la science-fiction, mais je n’ai aucune imagination. Donc je suis mon pauvre et très circonscrit matériau.
Paradoxal pour quelqu’un qui se dit timide, non?
Vous savez, les êtres humains sont ambivalents, très duels. On est multiples. La timidité, ou la hantise de se montrer ou d’être vu, ne m’a pas empêché, et explique même, que j’ai commencé à faire de la radio puis de la télévision. Ou que, comme ici, je me livre en tout cas je livre ce que je veux bien livrer, dans un récit autobiographique. Et puis, quand vous allez dans l’honnêteté crue jusqu’au bout, ça vous permet de mesurer votre capacité à avoir un petit peu d’autodérision. C’est intéressant comme exercice.
Vous pratiquez abondamment l’humour, surtout à vos dépens. Pour dédramatiser la situation?
Si je vous fais le coup de l’humour est la politesse du désespoir, vous me direz que la formule est un peu éculée. De toute façon, ce n’est pas ça. On n’a pas le choix. Soit on sombre dans l’angoisse, le pathos, le stoïcisme, on abandonne tout et on laisse faire la maladie qui vous engloutit comme une vague. Soit il faut de la tenue. On la doit à son entourage, on la doit éventuellement à ses médecins, en tout cas les bons. On la doit à soi-même car c’est quand même dégoûtant de se répandre, même s’il peut y avoir de la tristesse, de la peur. Passer la maladie au tamis d’un léger humour et de l’autodérision c’est pas mal, et puis ça aide à tenir le coup.
Un reste de vos racines anglo-saxonnes?
Peut-être. Vous savez, quand votre propre père a fait sienne la devise « never complain, never explain » (« ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer »), ça laisse des traces. Il a été aveugle d’un oeil et je l’ai appris des années après que la cécité s’est déclarée, peu de temps avant qu’il ne meure. Il avait aussi la maladie d’Alzheimer et ma mère me disait qu’il faisait tout pour qu’on ne le sache pas. Ses dernières forces cognitives, il les concentrait dans cet acte d’élégance, cette dignité. C’était son droit, c’était sa liberté.
Vous n’êtes pas tendre avec le milieu médical…
Dans un parcours de dix ans comme le mien, qui plus est erratique avec beaucoup de changements de médecins, j’ai rencontré quatre ordures et une bonne dizaine de praticiens formidables. Mais ce sont ceux-là qui vous font du mal. Ça vous marque. Ça déclenche une défiance, une colère, une tristesse aussi.
Comment expliquez-vous cette attitude parfois brutale du monde médical ? Un sentiment de supériorité masculine?
Les médecins vous diront « mais pas du tout, vous plaquez un schéma de domination patriarcal, de lutte des classes, de gens qui se cooptent, etc. », et les médecins humains qui ont lu le récit m’ont dit: « Ce n’est peut-être pas ça, il y a aussi des femmes qui sont des peaux de vache. » Oui, sans doute, mais il y a une part de réalité derrière quand même. Je ne suis pas la seule à m’en émouvoir. Martin Winckler a aussi écrit sur la brutalité des hommes en blanc.
On aurait pu penser que votre notoriété vous protègerait de cette maltraitance…
Non. Parce que le privilège peut se retourner contre vous. Des gens peuvent se dire « cette conne de la télé, en plus de ça, il faudrait bien la traiter », et peuvent prendre justement le contrepied, pour des raisons qui m’échappent. Mais c’est vrai que s’il y a infime privilège – je ne suis pas Barack Obama non plus -, les autres n’ont pas cette chance. Je suis soignée à l’hôpital, comme tout le monde. Il n’y a pas de passe-droits.
Le surnaturel affleure régulièrement dans votre récit. Une conséquence de la maladie?
C’est quelque chose qui s’est confirmé avec la maladie. C’était présent. La pensée magique ne m’était pas complètement étrangère. L’idée que la nature est quand même un peu plus que la nature, qu’il y a des esprits, des forces à l’oeuvre. Que les morts peuvent vous visiter pendant vos rêves. Qu’il y a juste une membrane entre la vie et la mort et qu’on peut la déchirer parfois un tout petit peu. Tout ça était présent. C’est ce qui me rend sensible à certains écrivains, à certaines cultures, notamment japonaise, où les esprits sont partout. Ça s’est développé en cours de route parce que j’ai cultivé cette attirance, je l’ai travaillée comme un muscle. Avec plus ou moins de crédulité. Quand je parle de Lisieux où je me rends, je m’amuse de moi-même. Cela participe d’une foi dans le merveilleux, dans l’invisible, dans les ressources cachées dans les plis du réel. On ne peut pas s’arrêter à notre réalité biologique qui fait qu’une cellule vit et meurt. Il ne peut pas y avoir que ça sinon autant se taper tout de suite la tête dans le mur.
Après ce cheminement, vous sentez-vous la force d’accepter la cécité si elle devait arriver?
Je vois toujours. C’est un glaucome très avancé, comme me disent les médecins avec gourmandise. « Il est agonique, il est très – très – avancé. » Les médecins ont au moins cette vertu: ils sont honnêtes. J’espère avoir trente ans de vue devant moi mais peut-être pas. Auquel cas je vais être confrontée à cette idée cruciale: l’acceptation de la perte. La perte de la vision partielle ou totale c’est une chose, mais on est tous confrontés à cette idée qui est consubstantielle à la condition humaine. C’est la perte qui est au coeur de l’art, qui donne envie de s’élever. Et cette question nous concerne tous. Je perds de la vision, je vais compenser, dépasser ça. Je n’ai pas le choix sinon je me suicide. Il y a peu d’aveugles qui se suicident. Beaucoup traversent des états dépressifs et puis tout d’un coup, derrière, après, il y a l’accession à une forme de réalité augmentée, non pas au sens des transhumanistes, qui est dégueulasse. Les aveugles vous racontent percevoir la réalité avec tout leur corps, toute leur âme, toutes leurs vibrations.
A croire que la vue étouffe les autres sens…
Comment fait-on sans le regard? Hier, je déjeunais avec un aveugle. C’est un chercheur au CNRS, il a la soixantaine, il est aveugle depuis qu’il a 25 ans. On ne se connaissait pas. C’était euphorisant. Je lui décrivais le restaurant, il était enchanté. J’étais fasciné par sa mémoire spatiale, il savait exactement où tout se trouvait sur la table. J’avais l’impression d’être avec un extraterrestre humain comme moi. Ce n’est donc pas complètement déprimant.
En tant que femme de télévision, vous êtes scrutée mais vous ne voyez pas qui vous regarde, comme les aveugles. La symbolique est assez troublante, non?
Il y a une mise en abyme étonnante. Je regarde un oeil noir cyclopéen qui est l’objectif de la caméra. On dirait un miroir sans tain. Derrière, il y a des regards qui ont l’impression de me regarder dans les yeux. Mais nous sommes séparés par une vitre. C’est sans doute pour ça que la télévision est un médium fascinant. Je parle de jeu de dupes parce que ce médium crée l’illusion de la proximité.

La culture est votre autre bouffée d’oxygène. Vous citez des romanciers, des poètes et en tant qu’ancienne critique de cinéma, beaucoup de films aussi.
Et pourtant, le cinéma m’attire de moins en moins. La nature de plus en plus, la lecture et le spectacle vivant aussi. Je n’ai pas d’explication. J’ai les films en tête mais je vais moins au cinéma. Je lis par contre, si c’est possible, encore plus qu’avant. Des romans mais plus de récits aussi. Ça doit être un effet de l’âge.
Chacun a une image-limite, dites-vous. La vôtre, c’est la fameuse scène de l’oeil tranché dans le Chien andalou de Luis Buñuel. Pourquoi?
C’est l’image absolue. A la fois symbole sexuel, du patriarcat, et c’est l’image chirurgicale, qui moi me hante évidemment. Elle réveille de vieilles phobies. Elle incarne le tranchant sur la vulnérabilité. Quelque chose de sadien. L’effet tient aussi à la beauté horrifique de la scène.
Et la télé, vous la regardez?
Non. On me dit que je ne dois pas le dire, ça fait snob. Mais comme je le dis depuis vingt ans, je commence à être crédible. Donc je gagne du temps pour autre chose. Quand vous savez que la perte de la vue vous pend au nez, on se concentre. Dans tous les sens du terme. On se concentre sur ce qui compte. On élimine, on décante, on tamise. Comme si on se fixait sur ce qui fait du bien à soi, et donc aussi sans doute aux autres, car vous saurez comment communiquer ce bien qu’un livre vous fait, ou qu’un tableau vous procure.
Professionnellement pourtant, il est devenu difficile d’échapper aux réseaux sociaux et à l’obsession du « tout, tout de suite »…
J’ai la chance d’avoir 55 ans, de ne pas être un poulet de printemps. Je peux encore faire sans les réseaux sociaux sans que ce soit un problème. L’écran fait barrage à l’expérience directe de la réalité. J’ai la chance d’avoir connu un monde ante-réseaux sociaux. Ma fille ne l’a pas connu. Je la plains. Les jeunes sont coincés par un dispositif qui les aliène. Et il faut une énorme volonté pour y échapper. C’est pour ça que je suis fasciné par ces jeunes qui se mobilisent pour le climat. Malgré le numérique, ils se sont dit à un moment: la nature, c’est beau, il faut la sauver. On peut même aller plus loin et espérer que la jeunesse prenne conscience à cette occasion qu’il serait temps de faire un pas de côté par rapport au numérique.

