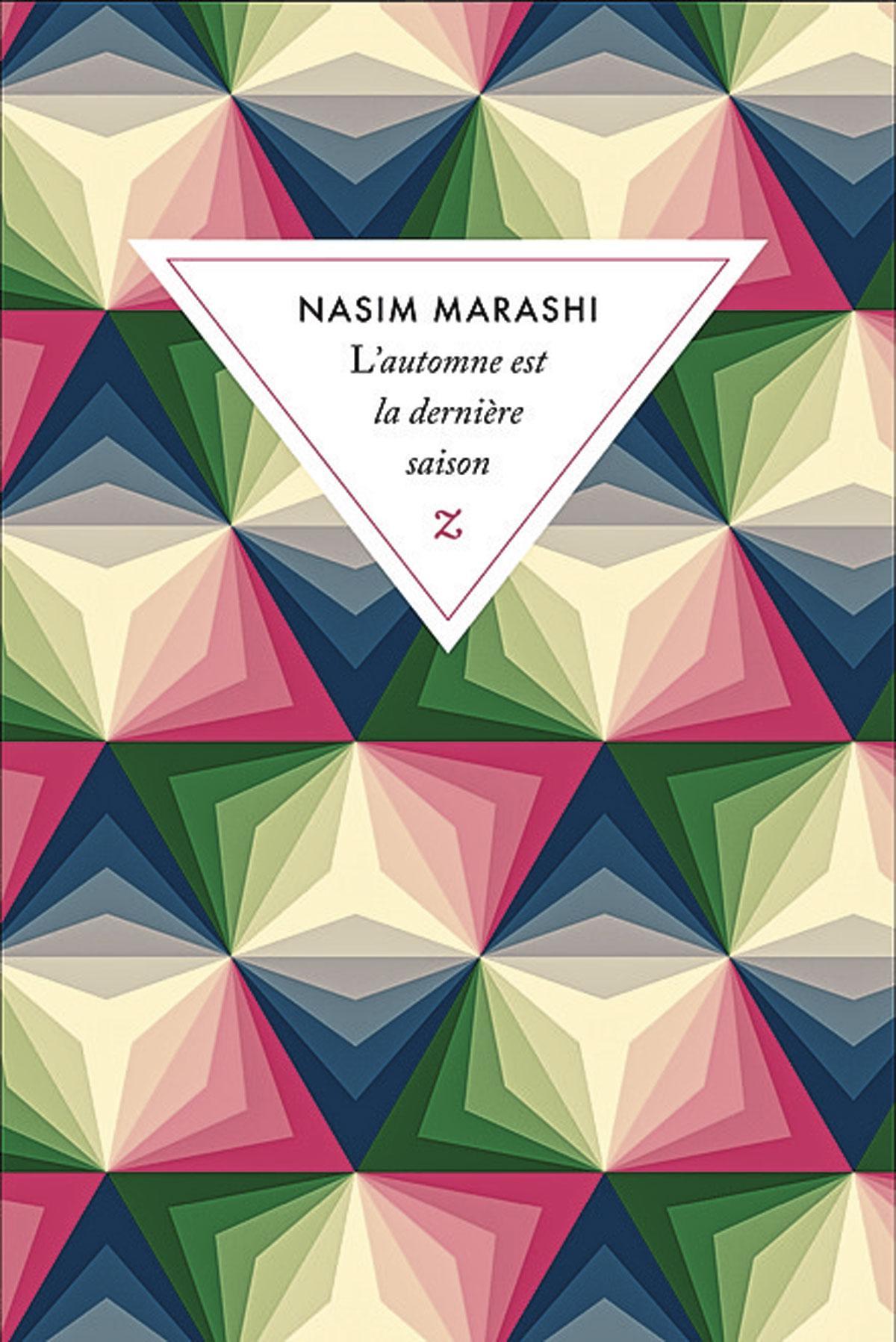Avec L’automne est la dernière saison, Nasim Marashi livre une fugue sur le même thème, celui du départ et de l’exil, qui hante un trio de jeunes Iraniennes peinant à trouver leur place.
“Je ne suis ni ici ni là-bas. Je reste suspendue en l’air.” Rodja rêve de partir. Elle fait même plus qu’en rêver, elle se débat avec la complexité administrative qui empêche son destin, et se voit déjà à Toulouse. Alors qu’elle se projette dans l’exil, ses amies, Leyla et Shabaneh, sont elles aussi hantées par le spectre du départ, celui d’un proche, ou encore le poids que l’on porte quand on a fait le choix de rester. Dans L’automne est la dernière saison, le motif de l’exil plane sur les monologues intérieurs des trois héroïnes, trois figures sensibles et complexes de la place des jeunes femmes dans la société iranienne. Cette question est aussi celle de son autrice, Nasim Marashi: “L’exil est une question que je me suis toujours posée et que je me pose encore. Les gens qui m’entourent se la posent aussi. Plus la situation en Iran se détériore, plus la question de l’exil prend de la place. À chaque fois, des gens nous exhortent à rester, à combattre, à contribuer à la reconstruction du pays, mais il y a encore plus de gens qui décident de partir.”
Nasim Marashi, elle, reste dans l’hésitation, la tension du départ. Elle vit encore en Iran, mais multiplie les résidences comme autant de bulles d’air. Elle sait le besoin d’ailleurs mais connaît aussi le quotidien des jeunes Iraniens. C’est une véritable plongée dans celui-ci que l’on expérimente dans son premier roman, polyphonique, au plus près de la vie à Téhéran, ses embouteillages, ses bureaux, les files au consulat. Mais ce que l’on ressent aussi avec précision, c’est la pression subie par ces jeunes femmes, qui appartiennent à une génération intermédiaire. “On est des sortes de monstres, Shabaneh”, confie Rodja. “On n’est plus du même monde que nos mères mais on n’est pas encore de celui de nos filles. Notre cœur penche vers le passé et notre esprit vers le futur. Le corps et l’esprit nous tirent chacun de son côté, on est écartelées.” La romancière connaît bien ces doutes: “La génération représentée dans ce roman, on l’appelle la décennie des 60 -ce qui correspond au calendrier persan- soit les gens nés dans les années 80. Les femmes surtout vivent une période de transition. Nos mères étaient plutôt femmes au foyer. Mais nous, pour la plupart, nous travaillons. Nous avons hérité de certains devoirs traditionnels de nos mères mais nous devons aussi performer dans la vie active. Nous subissons une double pression, on a envie d’être parfaite dans ces deux rôles, ce qui est illusoire.” Comme si Leyla, Shabaneh et Rodja marchaient dans le vide, cherchaient en vain une place qui n’existe pas.
Une vision kaléidoscopique
Le recours au flux de conscience nous embarque dans la psyché complexe des personnages, nous invite aussi à revisiter leur passé, marqué par la guerre et souvent par les conflits familiaux. Pour ces jeunes filles, la famille n’est pas un havre de paix, les conflits intergénérationnels sont trop grands pour qu’elles puissent y trouver écoute ou apaisement. L’amitié, le fil qui les unit, est vécue “comme un refuge, un phare, un socle aussi sur lequel s’appuyer”, résume Nasim Marashi.
Lire aussi | Holy Spider, un serial Killer en Iran
En permettant au lecteur de pénétrer, en deux temps, les monologues intérieurs de ses trois héroïnes, l’autrice revient sur cette difficulté d’habiter le monde. Et elle joue d’une subtile ironie dramatique, quand des événements déjà abordés par un personnage sont ré-évoqués sous un autre prisme par un autre. La construction savante qui assemble les différents éléments du récit permet aussi de multiplier les regards sur ces situations. “Je crois que ce dédale ou ce puzzle narratif doit venir de ma formation en ingénierie mécanique, plaisante l’écrivaine. J’ai beaucoup aimé utiliser ces changements de focalisation, qui me permettaient aussi de mettre en valeur les non-dits, les sous-entendus.” Comme si cette vision kaléidoscopique à travers trois destins particuliers était aussi une façon d’offrir une vision plus globale de la jeunesse iranienne.
À l’origine, le projet était d’ailleurs plutôt documentaire: “En 2009, après le mouvement vert et les événements politiques qui ont bousculé le pays, j’étais journaliste, et je souhaitais écrire un long reportage sur ce qui nous arrivait, le fait que de nombreux jeunes Iraniens étaient en train de voir leurs rêves s’envoler.” Effectivement, ce premier roman de Nasim Marashi, s’il n’est traduit qu’aujourd’hui en français, date de 2014. Pourtant, il résonne encore comme si c’était hier, ce qui n’est pas forcément pour réjouir son autrice: “Mon idée quand j’ai commencé à écrire ce livre, c’était que je voulais faire en sorte que les gens n’oublient pas ce qu’ils avaient vécu, et le prix qu’ils ont payé pour la liberté. J’espérais qu’on reviendrait sur ce récit quelques années plus tard, en se disant: c’est dingue tout ce qu’on a vécu. Mais la situation a évolué de telle manière en Iran que les choses ont en fait dégénéré, se sont détériorées. ça n’a fait qu’empirer. Je me sens extrêmement frustrée finalement, car je pensais que dix ans plus tard, les jeunes Iraniens ne pourraient plus s’identifier à mes personnages ou, en tous cas, y trouver un écho à leur propre situation. J’aurais souhaité que le texte appartienne au passé, quitte à ce qu’on ne le comprenne plus! C’est paradoxal, car aujourd’hui je reçois des messages de lecteurs et lectrices, beaucoup plus jeunes que moi, qui me disent avoir lu le livre, et s’y être retrouvés. Et d’une certaine façon, ça m’attriste.”
L’automne est la dernière saison ****, de Nasim Marashi, éditions Zulma, traduit du persan (Iran) par Christophe Balaÿ, 272 pages.