Longtemps classé tricard, le rap est aujourd’hui partout, et à tout le monde. Quitte à perdre un peu de son identité? Dans un essai stimulant, le journaliste Mehdi Maïzi revient sur tout ce que le genre a gagné ces dix dernières années. Et ce que cela a pu lui coûter…
En 2015, Mehdi Maïzi publiait un premier livre –Rap français, une exploration en 100 albums (éd. Le mot et le reste). Dix ans plus tard, celui qui est désormais le «head of hip-hop» d’Apple Music France s’est remis à l’écriture et sort l’essai Le Rap a gagné. A quel prix?. Bilan d’une décennie exceptionnelle, il revient sur l’explosion d’un genre, longtemps resté coincé dans les marges de la pop culture. Un boum qui – on l’a souvent écrit – a aussi accompagné celui du streaming.
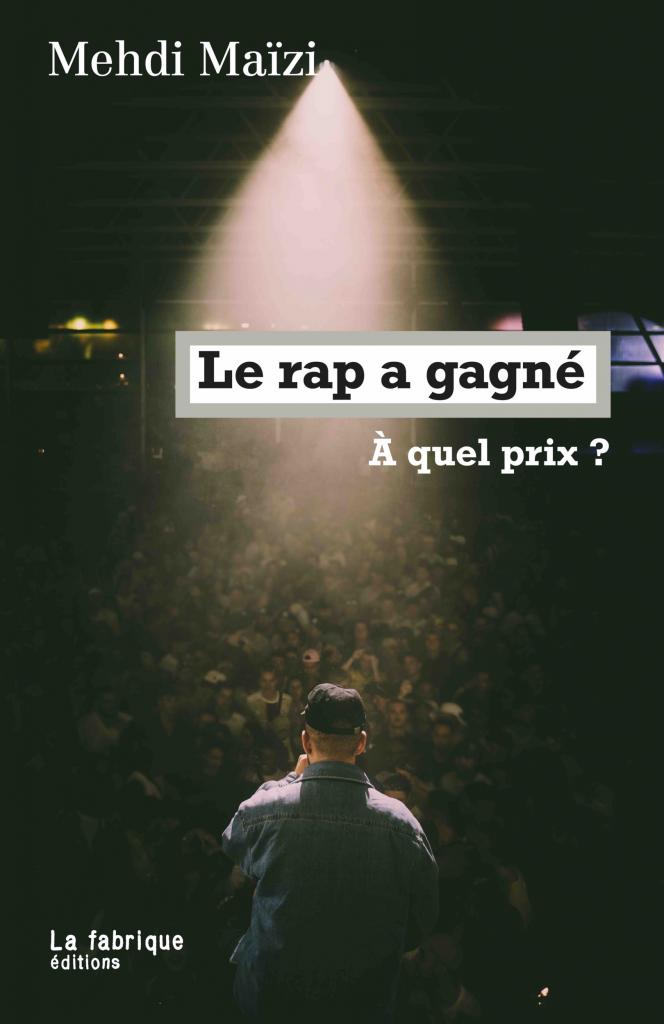
Il y a tout juste 10 ans, l’industrie musicale poussait en effet un grand ouf de soulagement. Pour la première fois depuis le chaos provoqué par le téléchargement illégal, elle reprenait des couleurs. Après plusieurs années de dégringolade, son chiffres d’affaires annuel repartait à la hausse (+ 3,2% selon l’Ifpi, la Fédération internationale de l’industrie phonographique). Dans le rôle du bon Samaritain: le streaming. Cette année-là, même les Beatles faisaient le pas et balançaient leur catalogue sur les plateformes…
Ceux qui en profiteront le plus seront cependant les rappeurs. Boosté par la nouvelle donne, le rap va en effet chambouler le paysage musical. A partir de 2015, il basculera même dans ce que certains baptiseront un «second âge d’or». Drake devient l’artiste le plus streamé au sur Spotify; Kendrick Lamar obtient le prix Pulitzer; Jay-Z pose au Louvre et prend le contrôle de la mi-temps du Super Bowl. De la même manière, le rap francophone s’impose, bousculant les repères. Quand les classements de vente français intègrent les chiffres du streaming, les rappeurs déboulonnent les stars habituelles de la chanson. Une vraie révolution.
Nouvelles frontières
A l’époque, Mehdi Maïzi est aux premières loges. «Début 2015, cela fait déjà presque un an et demi que je bosse comme journaliste musical au sein de l’Abcdr du son (NDLR: site Web français dédié au rap). Je passe mon temps dans les studios de Dailymotion, à préparer des émissions, apprendre à faire du montage. C’est le moment où sort l’album Que la famille de PNL. Pour être honnête, je ne l’écoute pas tout de suite, mais je me souviens que tout le monde en parlait.» Sent-il alors les frémissements d’une nouvelle ère pour le rap français? «Ce serait un peu facile de l’affirmer maintenant. Et je ne suis pas forcément le meilleur observateur de l’industrie. En revanche, ce qui est certain, c’est qu’on sentait une forme d’excitation et d’enthousiasme pour cette musique-là. Avec une nouvelle génération qui était en train de prendre le pouvoir, l’arrivée de nouvelles esthétiques, etc.»
Lire aussi | Mehdi Maïzi, premier visage français d’Apple Music
«Les gens ne se sont pas mis à écouter du rap grâce au streaming, mais les plateformes ont rendu légales des écoutes qui ne l’étaient pas. Avant cela, le public écoutait les albums, il les connaissait. Mais il les téléchargeait. En d’autres termes, cela ne se concrétisait pas dans des chiffres de vente. Le streaming a changé ça, et a permis de visibiliser cette audience. Il a rendu ces écoutes tangibles. Quelque part, on peut même penser qu’il les a surpondérées, dans le sens où il s’agit d’auditeurs souvent très jeunes, qui ont tendance à écouter les albums en boucle. Cela grossit l’effet de domination. Bref. Je me rappelle qu’un jour, Benjamin Chulvanij (NDLR: ponte de l’industrie rap française) m’avait dit que le streaming avait sauvé le rap. Je préfère dire qu’il l’a sauvé commercialement. Parce qu’avant cela, des artistes comme Sexion d’assaut avaient déjà lancé les prémices d’un rap pop, Kaaris avait ramené la trap en France, etc.»
En toute indépendance
Si le rap a triomphé, ce n’est donc pas seulement grâce au streaming. Après tout, «tous les genres ont pu en bénéficier». Même si «c’est vrai qu’il y a eu une forme d’adéquation particulière entre ce nouveau modèle de consommation musicale et le rap, de par la manière dont il est produit, dont les gens l’écoutent.» Au-delà de cette concordance, le rap a aussi réussi à toucher le mainstream en mettant en avant des artistes à la fois charismatiques (le mauvais génie Booba) et novateurs (PNL défrayant la chronique jusque dans les médias anglo-saxons), ambitieux (SCH et sa trilogie Jvlivs) et populaire (le phénomène Jul). Et qui ne se limitent plus à l’Hexagone –le boom du rap belge, avec Damso, Hamza, Shay, Roméo Elvis, Caballero & JeanJass, etc.
Longtemps snobés, les rappeurs sont alors tout à coup invités partout: dans les débats télé ou les matinales radio, jouent en tête d’affiche des festivals, ont droit à des expositions… Cela n’empêche pas certains clichés ou malentendus de persister. «Quand un rappeur est invité par un média grand public, à quelques exceptions près, cela reste compliqué. Même quand il y a de la bienveillance, il y a aussi souvent beaucoup de méconnaissance. Je pense à quelqu’un comme Léa Salamé, par exemple, qui fait régulièrement des interviews d’artistes issus du rap. En même temps, je peux comprendre, elle a plein d’autres sujets d’actualité à couvrir…»
Débordés par les réseaux sociaux et les plateformes comme YouTube, les «anciens médias» sont à la recherche de figures qui pourraient rajeunir leurs audiences: comme l’a avoué un jour Laurent Delahousse recevant Aya Nakamura sur le plateau du JT de France 2, «c’est nous, les médias, qui avons aujourd’hui besoin de vous», bien davantage que l’inverse. «Ce qu’a gagné le rap, c’est qu’il s’est justement affranchi de tout ce qui l’empêchait d’être reconnu, poursuit Mehdi Maïzi. Auparavant, il fallait être diffusé sur Skyrock ou passer dans telle émission. Ses artistes ne boudent pas forcément ces endroits, ils les recherchent même encore parfois, mais disons qu’ils ont gagné une certaine indépendance. Ils n’ont plus besoin des mêmes validations.»
Ecosystème
Ils ont même fini par créer leur propre version des Victoires de la musique. «Aujourd’hui, on a par exemple une cérémonie comme Les Flammes , précise le journaliste musical. Au départ, l’idée était vraiment de dire « ok, on n’est pas correctement représentés, arrêtons de nous plaindre, et faisons-le nous-mêmes ».»
Désormais mainstream, les têtes d’affiche ont également entraîné dans leur foulée une série de propositions plus alternatives. Elles ont créé un écosystème qui bénéficie au rap tout entier. «Il n’y a pas juste les stars du game, et puis tous les autres qui galèrent derrière. Aujourd’hui, on peut trouver différents profils de rappeurs qui mènent de vraies carrières et vivent de leur musique. Dans le rap, il y a de la place aussi bien pour des gens comme Winnterzuko que Théodora, La Fève, etc. La scène est beaucoup plus diversifiée.»
Aujourd’hui, Jul peut donc porter la flamme olympique et Damso écrire l’hymne du Sidaction (et convier sur un seul et même titre Juliette Armanet et Youssoupha, Charlotte Gainsbourg et Médine, Pomme et Kalash Criminel…). Un temps considéré comme paria, brocardé par les associations féministes qui n’avaient pas digéré les paroles de son morceau Sale pute, Orelsan est joué dans toutes les fêtes de mariage…
Lissage pop
Le rap a obtenu une nouvelle respectabilité. Parce qu’il a su également faire son propre examen de conscience sur certaines de ses outrances? «Je pense que le rap a encore du travail à faire, notamment par rapport à certaines phrases misogynes ou homophobes. La différence est qu’aujourd’hui, elles font débat au sein même de la communauté rap. Comme elle s’est agrandie, une partie de ce nouveau public est beaucoup plus sensible à ces questions.»
Aujourd’hui, certains artistes se comportent en effet comme des pop stars avec tout ce que cela peut impliquer d’un peu convenu.
Cette nouvelle popularité a obligé les rappeurs à revoir certaines postures qui pouvaient choquer au-delà de leur auditoire de base. Quitte à passer parfois d’un extrême à l’autre et adopter un discours par trop policé? Le Rap a gagné. A quel prix?, se demande Mehdi Maïzi. Celui d’un discours devenu aujourd’hui trop convenu? «Je pense qu’avec le succès, le rap a intégré des codes de la pop. Aujourd’hui, certains artistes se comportent en effet comme des pop stars avec tout ce que cela peut impliquer d’un peu convenu. On fait attention à ce qu’on dit. C’est toujours un peu la même histoire, celle que le rock a bien connue. Lui aussi a pu passer pour subversif avant de devenir à son tour le système dominant. Pour le rap mainstream, c’est pareil. A cet égard, ce qui s’est passé lors des dernières législatives en France a été très frappant. Je n’attends pas des rappeurs qu’ils donnent des consignes de vote. Mais quand le RN est aux portes du pouvoir, on aurait pu s’attendre à ce que les rappeurs les plus influents se mobilisent. Surtout qu’historiquement, le rap français a toujours été très clair sur la question de l’extrême droite. Pourtant, excepté le morceau No Pasarán qui n’a pas vraiment eu d’impact, le silence a été assez assourdissant.»
La fête est finie
En s’imposant dans les hit-parades, le rap a donc aussi dilué son message contestataire et sa capacité à déranger. «Tout le monde écoute du rap aujourd’hui, même les gens qui s’en foutent. C’est comme le cinéma: tout le monde regarde des films, sans être forcément cinéphile.» Ces deux dernières années, le genre a d’ailleurs marqué le pas. «Je suis dans ma bulle», rappait PNL sur son iconique Le Monde ou rien. D’aucuns disent aujourd’hui que cette bulle rap est en train d’exploser. A cause de l’assiette du streaming qui s’est élargie à de nouveaux publics (plus âgés). Mais aussi suite à un certain essoufflement, les cadors du genre préférant se reposer sur des recettes désormais éculées. «La fête est finie», écrit même Mehdi Maïzi. «Dans le rap, on en est un peu à la scène finale du Truman Show: on se heurte à un mur, on arrive au bout d’une illusion; on réalise qu’on a évolué dans un univers quelque peu artificiel.»
Les rappeurs sont devenus des pop stars presque comme les autres, dans un monde où celles-ci font précisément de moins en moins l’unanimité. «Quelqu’un comme Ninho est l’un des plus gros vendeurs de disques en France. Mais demandez aux gens dans la rue de citer l’un de ses morceaux ou même de situer qui il est, et je ne suis pas certain que vous obtiendrez beaucoup de réponses. Cela étant dit, c’est un peu la même chose avec les autres superstars du moment. D’une certaine manière, on n’a plus de figures comme Michael Jackson, qui était partout et que tout le monde identifiait. Aujourd’hui, vous pouvez avoir des immenses stars comme Taylor Swift, Drake ou Bad Bunny mais dont la plupart des gens ne peuvent fredonner un seul titre.»
Dix ans après avoir enfin percé son plafond de verre, le rap n’en est pas à retourner dans son «ghetto», loin de là. Mais son hégémonie sur la planète pop a probablement vécu, l’obligeant à se remettre en question. Ce qui, après tout, n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle…
Mehdi Maïzi, Le Rap a gagné. A quel prix?, La Fabrique éditions, 190 p. 4/5
Mehdi Maïzi sera l’invité d’un Rap book club, organisé le 15 avril, par l’agence CLNK, à l’Espace Magh, à Bruxelles.

