Grand spécialiste du cinéma américain, le Français Jean-Baptiste Thoret consacre un essai monographique d’une vertigineuse érudition à l’oeuvre de Michael Mann (Heat, Collateral, Miami Vice): Mirages du contemporain.
On lui doit notamment des livres sur John Carpenter, Tobe Hooper, Michael Cimino ou Peter Bogdanovich… Depuis plus de 20 ans, à travers ses articles au long cours ou ses essais éclairés, il est hanté par cette question-programme, qui travaille son regard en filigrane, le conditionne et le modèle: « À quoi pense le cinéma américain? » Aujourd’hui, Jean-Baptiste Thoret, « le dernier des cinéphiles« , attaque en solitaire l’oeuvre-montagne d’un réalisateur qui le fascine depuis un quart de siècle: Michael Mann, grand architecte de l’ultrasophistication à qui l’on doit ces inépuisables films-cathédrales que sont Heat, Collateral ou Miami Vice. Parmi d’autres. En résulte un ouvrage d’une folle érudition qui puise aux champs de réflexion les plus divers (esthétique, économie, politique, anthropologie…) matière à décrypter les thèmes et obsessions phares d’un immense cinéaste chez qui la mise en scène traduit une véritable vision du contemporain. Parce que, nous dit magnifiquement Thoret, il y a chez Michael Mann « une croyance en la capacité de la forme à révéler le monde« .

Il y a trois ans, votre livre sur Peter Bogdanovich prenait la forme de conversations au long cours. Ici, vous choisissez au contraire de ne pas interviewer Michael Mann, que vous connaissez pourtant, puisqu’il intervenait notamment dans votre documentaire, We Blew It, sur la fin des utopies…
Je n’ai jamais vraiment aimé, pour être tout à fait honnête, ces livres qui se présentent comme des essais mais qui comprennent aussi des entretiens. C’est un truc un peu facile, un peu feignant, de journaliste. Pour moi, Mann est dans ses films. Donc je n’ai pas besoin de lui demander ce qu’il a voulu dire. J’ai souvent parlé avec lui. Quand j’allais à Los Angeles, j’allais le voir. Récemment encore, il m’a appelé. Et je lui avais déjà annoncé il y a six ou sept ans, de façon très courtoise, que j’étais occupé à écrire un livre sur lui en toute liberté. Ça l’avait un peu titillé. Il m’avait alors proposé un entretien en bonne et due forme, mais j’avais refusé. Pour moi, soit on fait un essai soit on fait un bouquin d’entretiens. C’est l’un ou l’autre. Pas besoin d’une espèce d’adoubement en fin d’ouvrage, ça ne sert à rien.
Le projet de ce livre est vieux d’un quart de siècle. En 1996, en effet, vous découvrez Heat au cinéma. Vous le voyez deux fois d’affilée puis quittez la salle en vous disant: « Un jour, j’aimerais écrire un livre sur Michael Mann ». Qu’est-ce qui vous parle à ce point à ce moment-là?
C’est une question très compliquée puisque c’est rétrospectivement qu’on identifie les raisons. Mais disons qu’il y a une intuition. À l’époque, je n’ai pas encore écrit, ou à peine quelques articles. Je suis encore en études de cinéma, et même le nom de Mann n’est pas vraiment identifié pour moi. J’avais bien vu son Manhunter, mais que j’associe alors au cinéma de genre des années 80, quelque part entre Craven, Dante, Romero et Cronenberg. Bref, je vais voir Heat à l’époque, comme tout le monde, essentiellement parce que c’est un polar qui est vendu comme la rencontre entre deux acteurs hyper importants, De Niro et Pacino. Et là, je rentre dans un monde dans lequel je pourrais rester des heures et des heures, avec le sentiment tenace de me trouver face à un film en état de grâce. C’est-à-dire que tout est à sa place, toutes les planètes sont alignées: le jeu des acteurs, la mise en scène, le récit, la musique, le tempo, l’humeur… J’en sors avec la conviction profonde que je viens de voir un très grand film. Et là je me dis, comme un ado qui se dit qu’un jour il ira sur la Lune: « Un jour, je ferai un livre sur le type qui a fait ce film. »

À partir de là, Mann rentre sur vos radars. Et vous allez suivre son parcours en attendant impatiemment chacun de ses films…
Oui, et c’est intéressant parce que Heat boucle en fait la première partie de sa carrière. C’est-à-dire qu’il s’agit là d’un film-terminal qui résout, enterre et règle une fois pour toutes la question du polar américain. C’est un film-tombeau. Et Mann, qui est quelqu’un qui ne s’installe jamais dans le moindre confort, qui est toujours obsédé par l’idée d’être dans une forme d’adhérence avec son époque, comprend que, stylistiquement, il est arrivé là à un point de non-retour. C’est un cinéaste toujours à l’heure, donc en avance. Dès lors, il ne reconduit pas cette forme post-classique qui suppose toujours, quelque part, une forme d’harmonie entre l’individu et le monde. Le monde capitaliste ne supporte plus une mise en scène comme celle-là. Et il va par la suite davantage en découdre avec une forme d’instabilité qui n’a plus rien à voir avec le classicisme. D’un seul coup, il se met à filmer des personnages qui sont en retard sur le monde. Ce qui se traduit par des plans beaucoup plus courts, beaucoup plus flottants, une forme d’impressionnisme de la mise en scène qui va trouver sa plénitude avec l’arrivée des caméras numériques, dont il fait un usage prodigieux puisqu’il en fait véritablement un outil au service d’une vision artistique.
Le livre insiste beaucoup sur les tensions qui traversent son cinéma. Tensions entre classicisme et modernité, mais aussi entre l’homme et le monde, entre la marge et le centre, entre l’indépendance et l’asservissement, entre la vie et la mort… Toutes tensions synthétisées en quelque sorte dans une distinction que vous empruntez à un philosophe américain entre programme vital et programme existentiel…
Ce qui m’intéresse chez Michael Mann, et que je retrouve chez beaucoup de réalisateurs que j’aime, comme Michael Cimino, Luchino Visconti, Sam Peckinpah ou le John Ford tardif, c’est que c’est un cinéaste qui est doublement extérieur à son temps. Il appartient biographiquement au Nouvel Hollywood, mais il manque pour plein de raisons cette décennie-là. Il aurait dû faire des films dans les années 70 et, néanmoins, il arrive quand tout est fini. Mais il est aussi extérieur aux années 80, qui en constituent en quelque sorte la négation, parce qu’il les aborde avec un ancrage antérieur, esthétiquement comme politiquement puisqu’il y a chez lui un vrai fond marxiste propre à la gauche radicale des seventies. Donc Mann est toujours entre deux eaux, et doublement anachronique. Et ses personnages le sont toujours aussi, entre deux eaux, pris qu’ils sont notamment à la fois entre la loi et la justice, mais aussi entre le programme vital et le programme existentiel. Le programme vital correspond à la compétence qu’ont toujours valorisée l’Amérique et le cinéma américain. C’est-à-dire, en gros, qu’un individu est ce qu’il fait, et donc doit être le meilleur dans ce qu’il fait. En atteignant une maîtrise totale de son savoir-faire, l’individu va ainsi pouvoir réaliser son accord avec le monde. Ça, c’est la vision du classicisme américain. Et cette vision, Mann va la questionner sur le mode de la crise. Il va y trouver matière à inquiétude. Et si la réalisation du programme vital ne permettait pas l’accomplissement du programme existentiel? Étant entendu que le programme existentiel ne correspond plus à une compétence, une action, mais à ce que l’individu voudrait être, ses aspirations, ses rêves. Chez Mann, le programme vital est complètement inféodé à une logique capitaliste, qui est une logique économique, et cette dernière finit forcément par provoquer une crise existentielle. C’est pour ça qu’il faut faire en sorte que le programme vital, même de façon illusoire, occupe tout l’espace. Chez Michael Mann, quand on s’arrête de surfer, on coule. Quand on se questionne sur son avenir, on est mort.

Le motif du mirage joue un rôle déterminant dans cette tension entre programme vital et programme existentiel…
Oui, c’est un concept qui m’intéresse beaucoup. Le mirage, ce n’est pas un fantasme. C’est quelque chose après quoi on court, qu’on croit avoir vu, qui n’existe peut-être pas… Mais on va mettre en branle toute une série d’actions pour l’atteindre malgré tout. Que le mirage soit vrai ou faux, on s’en fout, c’est sa poursuite qui compte, ce qu’on est prêt à accomplir au nom de ce mirage, de cet horizon. Chez Mann, ce concept s’articule au contemporain, vis-à-vis duquel il se situe constamment dans un double rapport, de critique et de fascination. C’est le mirage du capitalisme, de l’accélération, de la performance… Le système capitaliste est entièrement fondé sur l’idée que l’on va courir après un truc que l’on n’aura jamais. Et chez Mann, une éventuelle émancipation ne peut avoir lieu que si on s’éveille à la compréhension du système économique qui sous-tend le monde. Il est intéressant de noter, d’ailleurs, qu’il ne fait pas vraiment de distinction entre comprendre l’autre, soi-même et le monde. En ce sens, il faudrait montrer ses films dans les écoles de commerce. Collateral, par exemple, dit le monde bien mieux que bon nombre d’essais d’économie ou d’Histoire du capitalisme.
Formellement et techniquement, on a l’impression que, chez lui, tous les outils propres au médium cinéma sont convoqués pour communiquer quelque chose. Vous soulignez, par exemple, qu’il a compris, comme Antonioni avant lui, que les couleurs pouvaient être signifiantes…
Il faut savoir que Mann a toujours été fasciné par Kubrick. Et comme lui, il est un cinéaste-monde. Il considère le cinéma comme une espèce d’art total. Chez lui, chaque élément formel est extrêmement important. En cela, il appartient à l’école expressionniste. Il a d’ailleurs été très marqué par le cinéma de Pabst et Murnau. Pour révéler la vérité du réel, il faut en passer par le style. Et ce n’est jamais le style pour le style, le style dans une optique publicitaire. La stylisation chez Mann renvoie par exemple à ce que Deleuze appelait » l’étrange subjectivité des choses« . Les premiers plans de The Insider sur Russell Crowe, c’est ça. Mann cherche une position de caméra à cheval entre ce qu’on voit et la subjectivité du personnage, entre ce qui est et ce que lui voit. Cette espèce de position intermédiaire, c’est une pure recherche stylistique.
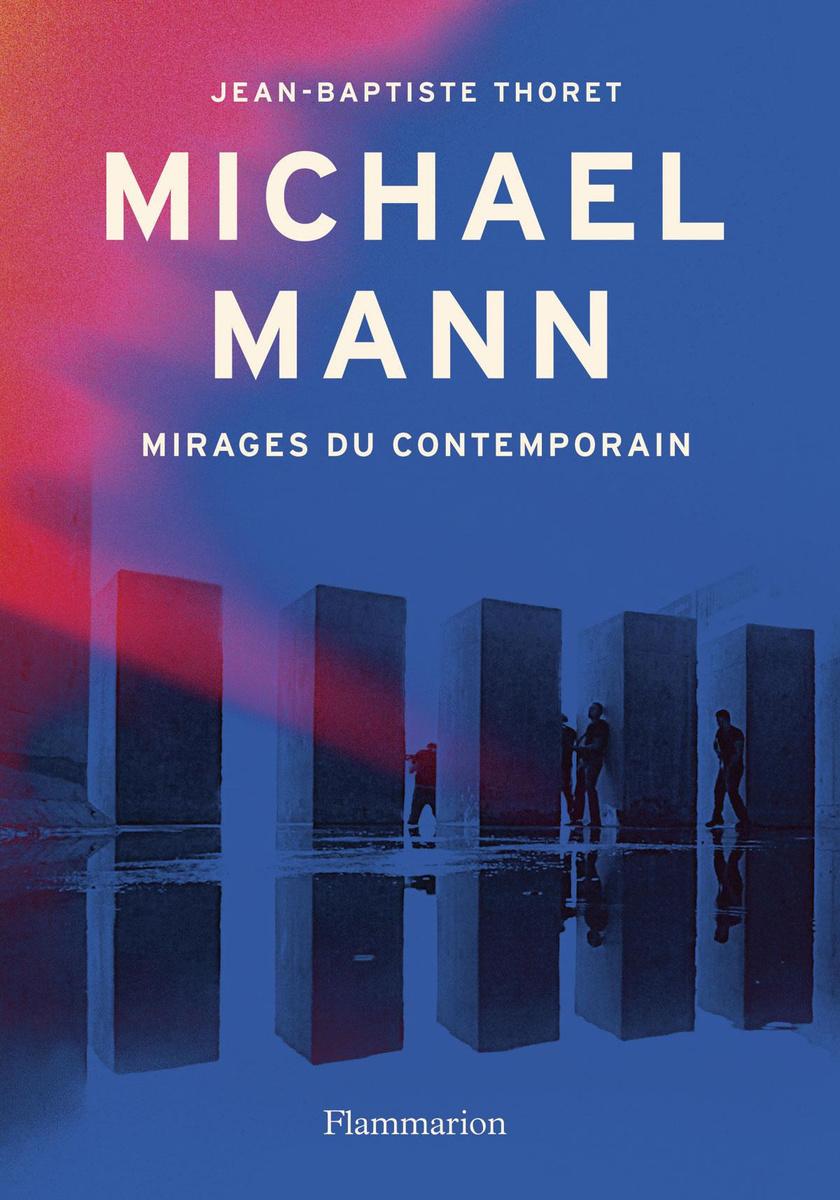
Le livre pose également Michael Mann en cinéaste-cheval de Troie, à la fois très pointu et très populaire. En un sens, et à la suite encore une fois d’un Kubrick, n’annonce-t-il pas, à travers ses films, ce qu’on appelle aujourd’hui, peut-être un peu abusivement, le blockbuster d’auteur, tel qu’incarné par le cinéma d’un Christopher Nolan ou d’un Denis Villeneuve?
C’est compliqué parce que le blockbuster d’auteur existe pour ainsi dire depuis la consolidation du blockbuster en tant que genre en soi à la fin des années 70. Dans les années 80, en effet, certains blockbusters sont encore réalisés par des auteurs. Il suffit de penser à un film comme Scarface de Brian De Palma, par exemple. Par ailleurs, Mann n’a jamais véritablement réalisé de blockbuster. Il est trop perfectionniste et exigeant pour ça. Il a besoin de beaucoup trop de temps de recherche et de préparation. Chez lui, c’est le film avant tout. Commercialement, il a toujours été sur le fil du rasoir. Le Dernier des Mohicans a été un succès. Collateral aussi. Heat dans une certaine mesure. Mais c’est à peu près tout. Par contre, il est indiscutablement le plus grand cinéaste américain de ces 40 dernières années. Donc si on regarde aujourd’hui les films de Nolan ou de Villeneuve en comparaison, eh bien je pense que ça en dit long sur ce qu’est devenu le cinéma américain. Parce que oui, en un sens, il est juste de dire que Nolan et Villeneuve occupent aujourd’hui dans le paysage cinématographique la place que Michael Mann occupait il y a quinze ans. Et bon là, tout est dit. C’est-à-dire que, d’un côté, on a un cinéaste avec une vraie vision d’auteur, un cinéaste avec lequel on apprend le monde, et puis de l’autre, on a deux réalisateurs que l’industrie a propulsés comme auteurs mais qui ne sont, peu ou prou, que des montagnes qui accouchent de souris. Où est l’auteurisme chez Nolan et Villeneuve? La réponse est dans la question…
Michael Mann – Mirages du contemporain: de Jean-Baptiste Thoret, éditions Flammarion, 352 pages. ****(*)
