En adoptant le point de vue de l’esclave des Aventures de Huckleberry Finn, Percival Everett montre le vrai visage du racisme. Et signe un petit bijou de roman moraliste.
James de Percival Everett
Editions de l’Olivier, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Anne-Laure Tissut, 288 pages.
La cote de Focus: 4,5/5
Dans Toutes les époques sont dégueulasses (Verdier), formidable petit essai paru en mai sur le traitement à réserver aux classiques entachés de propos –racistes, sexistes…– qui ne passent plus aujourd’hui, l’historienne Laure Murat invite à les «réécrire» plutôt qu’à les «récrire». Autrement dit, à créer des œuvres qui s’en inspirent mais les détournent plutôt qu’à nettoyer le texte original.
Message reçu cinq sur cinq par Percival Everett, qui propose avec James une relecture impitoyable d’un monument de la littérature américaine, Les Aventures de Huckleberry Finn, en adoptant le point de vue non plus du jeune Huck mais de l’esclave Jim, qui l’accompagne. Même s’il pointait les tares et la violence de la société américaine du XIXe siècle, le roman de Mark Twain cultivait une vision ambiguë, teintée de paternalisme, de l’esclavage. Le simple décalage de subjectivité qu’entreprend ici Everett change tout. Et met au jour de manière éclatante l’absurdité autant que la cruauté implacable d’un système dont les bénéficiaires étaient prêts à tout, y compris à invoquer les cieux, pour perpétuer leur domination. «La religion n’est qu’un instrument de pouvoir dont ils se servent et auquel ils adhèrent quand ça les arrange», constate Jim/James, qui est ici un homme lettré, docile quand il le faut mais bien décidé à se battre pour sa dignité et pour retrouver sa femme et sa fille après avoir été contraint de fuir alors qu’il allait être revendu.
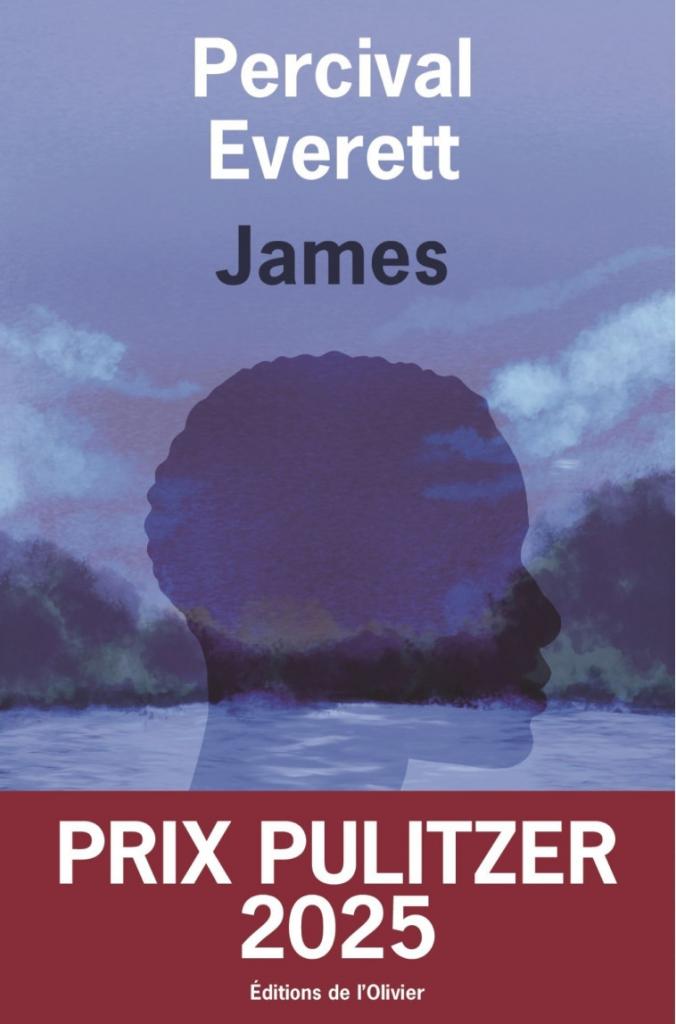
Percival Everett, qui a décroché la timbale du Pulitzer 2025, multiplie les niveaux de lecture pour éclairer et ridiculiser par l’humour l’architecture de l’esclavage. Le récit d’aventure haletant serpentant le long du Mississippi, ce «grand bourbier», sert de couverture à d’autres genres littéraires plus politiques. La farce burlesque notamment, les Noirs prenant sciemment un accent caricatural quand un Blanc est dans les parages alors qu’entre eux, ils s’expriment normalement. James dispense même des cours de «parler petit nègre» aux enfants pour passer pour plus stupides qu’ils ne sont et ainsi flatter le sentiment de supériorité de leurs propriétaires, car «mieux ils se sentent, plus on est tranquilles».
Un petit côté Ubu roi par-ci, une touche de Petit Prince par-là. En particulier dans les questions naïves mais limpides que pose au fugitif son jeune compagnon de route, dont la morale pas encore corrompue refuse de cautionner les injustices flagrantes dont les Noirs sont victimes. Une lueur d’humanité dans les ténèbres, de plus en plus suffocantes à mesure que le duo chemine et croise la route d’une belle brochette de salopards, tels ces deux charlatans qui tentent de revendre James plusieurs fois, ou ce leader d’une troupe de théâtre itinérant qui se prétend abolitionniste mais se grime tous les soirs en «blackface» et n’entend pas affranchir sa nouvelle acquisition. Ce qui fait dire à James: «Un homme qui refusait de posséder des esclaves mais n’était pas opposé à ce que d’autres en possèdent restait un esclavagiste à mes yeux.»
Subtil et malicieux, l’auteur du Châtiment n’épargne pas non plus ceux qui prétendaient combattre l’idéologie raciste. Dans ses rêves, son héros, qui est un grand amoureux des livres, débat ainsi avec Voltaire et d’autres philosophes des Lumières, pointant les contradictions de leur prétendu humanisme. Tous complices ou presque!
A la fois conte philosophique, roman picaresque, satire incisive, road trip initiatique, ce remake brillant coche toutes les cases du… classique.
Laurent Raphaël
La Bonne Mère
Roman de Mathilda Di Matteo. Editions L’Iconoclaste, 368 pages.
La cote de Focus: 3/5
Voilà cinq ans, Clara a quitté Marseille pour gagner la capitale et Sciences Po. Au grand dam de la mère qui se languit de sa «minotte»: «Comme si Marseille était pas assez bien pour elle. Pas assez grand.» Le père, Italien au sang chaud, rumine dans son coin. Coup de grâce, la Parisienne, amoureuse comme jamais, leur ramène un fils de bonne famille qu’on croise à la messe, chef de cabinet par-dessus le marché, «un mètre quatre-vingt-dix de cul pincé». Peuchère! Et si, derrière la fuite en avant, couvant dans la reproduction des schémas, grondait le silence des violences «consenties»?
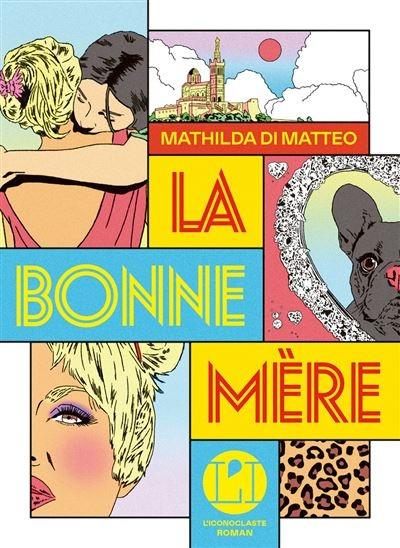
S’il aborde la question du choc des classes au travers des efforts fournis par Clara pour gommer son accent, effacer ses origines sociales, singer les avis et finir par y croire, le livre surnage d’abord sous un tsunami de paillettes. Débordant de gouaille fleurie, sapé en léopard, le style est à l’image de sa «bonne mère»: aussi discret qu’un ultra avant le Classico. Dans un second temps, lorsqu’elle empoigne plus frontalement la prise de conscience des violences ordinaires et extraordinaires subies au sein du couple, l’autrice gagne en intensité ce qu’elle perd en folklore et superlatifs ostentatoires.
F.DE.
La Collision
Récit de Paul Gasnier. Editions Gallimard, 176 pages.
La cote de Focus: 4/5
«J’aurais pu m’approprier leur « ça suffit ». Mon passé m’y autorise.» La Collision débute in media res dans un meeting d’Eric Zemmour. L’auteur, Paul Gasnier, également journaliste, y couvre l’événement comme une fatalité, cette «normalisation» de la pensée d’extrême droite qui transforme «la colère en conviction et le ressentiment en intransigeance». Cette colère, Gasnier la connaît, elle l’habite depuis la mort de sa mère, dix ans plus tôt, dans une rue de la Croix-Rousse à Lyon, percutée par Saïd, un délinquant récidiviste juché sur une moto-cross. On pourrait réduire les protagonistes de ce fait divers aux archétypes qu’ils représenteraient sur les plateaux des chaînes d’info, le «jeune en roue arrière» contre la prof de yoga, symbole de la gentrification. On pourrait faire du fait divers un fait de société, du courroux un bulletin de vote. Mais on peut aussi en faire un geste littéraire, afin de «réinjecter de l’humain dans des histoires manichéennes».
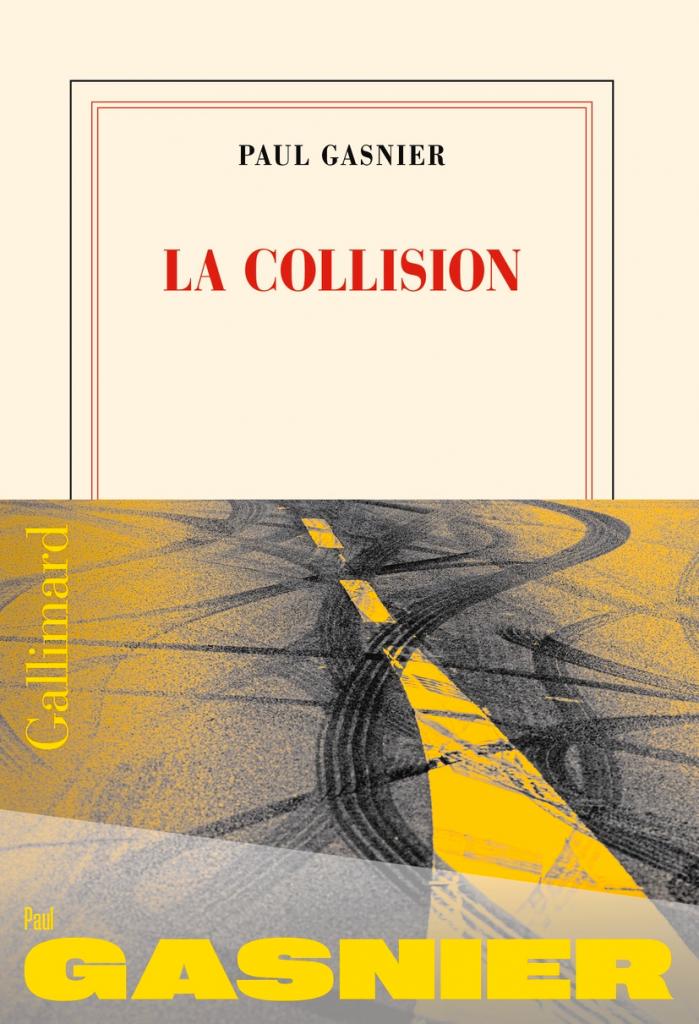
C’est ce que s’emploie à explorer Paul Gasnier, cherchant à comprendre sans pour autant excuser, non pour trouver une morale à l’histoire mais pour identifier pourquoi cette histoire parle de sa famille mais aussi de son pays, pourquoi «une vie comme celle de Saïd nous raconte». C’est toute une généalogie de la violence qui apparaît quand on lève le voile sur le passé de Saïd, quand on tente de mettre à jour les déterminismes et les circonstances qui mènent au geste fatal. A l’instar de tout un pan de la littérature nourrie de l’art de la non-fiction anglo-saxonne, une écriture à la première personne qui sans pour autant être autobiographique pense le rapport du «je» au monde pour mieux le décrire dans son époque, La Collision offre un puissant récit contemporain où l’accident du titre figure une forme de faillite collective.
A.E.
