L’Islandais Arnaldur Indridason, l’Irlandais Colin Barrett, l’Américain spécialiste des romans policiers Chris Offutt ou encore Dave Eggers figurent parmi les auteurs mis en avant dans nos choix de romans.
1. Fils prodigues
De Colin Barrett.
Editions Rivages. Traduit de l’anglais (Irlande) par Charles Bonnot, 156 pages.
La cote de Focus: 3,5/5
Colin Barrett a attiré l’attention il y a quelques années avec un recueil de nouvelles, Jeunes loups, sentant déjà bon la débâcle, traversé qu’il était d’un bout à l’autre de gamins et d’ados englués dans une Irlande rurale, paumée, violente et désabusée. «Déjà», parce que son premier roman, sorti le 5 mars, ne respire pas plus le bonheur et les grandes espérances. Un bled du comté de Mayo –bout de terre qui a les pieds dans l’Atlantique– est le théâtre d’une aventure criminelle dont la noirceur est tempérée par une bonne dose d’amateurisme des protagonistes. Et notamment des frères Ferdia, deux petites frappes du coin qui ont kidnappé le jeune frère d’un dealer de second rang, Cillian English, qui a eu la mauvaise idée de filouter le patron des frangins. Ils cachent la victime, que tente de sauver par tous les moyens sa copine Nicky, dans la ferme isolée de Dev, géant solitaire et sensible mal à l’aise dans son costume de geôlier désigné.
Tout ce petit monde, par ailleurs abonné à la débrouille, aux «bullshit jobs», à la monotonie et aux soirées alcool-joints-conversations molles étirant le temps, se connaît, ce qui accentue le sentiment de claustrophobie, comme si les vies étaient piégées dans un scénario écrit d’avance. Celles des hommes plus que des femmes d’ailleurs, qui résistent au déterminisme. S’appuyant sur les ressorts du thriller –le récit, assemblage d’instantanés de ce monde clos, épluche l’intrigue comme un oignon– autant que du drame social à la Ken Loach –grisaille, élans d’amour et de solidarité compris–, le prometteur romancier capte l’âme d’une génération aux ailes rognées, bien aidé par un sens affûté et délicat du dialogue. Et prouve, après Claire Keegan ou Paul Lynch, qu’en Irlande l’herbe littéraire est un peu plus verte.
L.R.
2. La Loi des collines
De Chris Offutt.
Editions Gallmeister. Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Anatole Pons-Reumaux. 288 pages.
La cote de Focus: 4/5
Mick Hardin aurait dû s’en douter: à chaque fois qu’il revient dans sa petite ville natale de Rocksalt, Kentucky, au pied des Appalaches (plus communément appelées «collines»), les choses tournent mal et les cadavres s’additionnent. Ce fut déjà le cas dans Les Gens des collines, puis dans Les Fils de Shifty, parus chez Gallmeister également. Mais ce militaire du CID, la division des enquêtes criminelles de l’armée US, ne revient pas cette fois pour divorcer ou se remettre d’une blessure. A 39 ans et après 20 ans de service, il compte bien profiter de sa jeune retraite, embrasser son shérif de sœur et filer se la couler douce en Corse. Mais «les collines étaient comme un nœud coulant– plus on se débattait, plus elles se resserraient».

L’assassinat d’un mécanicien de stock-cars puis d’un éleveur de coqs de combat –les deux activités typiques du coin– et surtout la blessure par balle de sa frangine, vont l’obliger à revoir ses plans et replonger dans la fange de Rocksalt, où tout se sait très vite –«Tu éternues en ville et les postillons arrivent à la maison avant toi»– et dans la violence de ses collines, hantées par la pauvreté, les haines familiales et une conception singulière de la justice, plus proche de la Bible et de l’œil pour œil, dent pour dent que de la loi. Des décors et une ambiance de western qui ont leur conséquences: «A l’âge de 30 ans, tout le monde connaissait plusieurs personnes au cimetière. Il songea que c’était pour ça que les gens des collines vénéraient les morts. Ils étaient très nombreux pour une si petite population.»
Savant mélange atypique et involontaire entre le Jack Reacher de Lee Child et le shérif Walt Longmire de Craig Johnson, l’ex-militaire Mick Hardin «qui n’a rien appris sur les femmes, à part être gentil, écouter et porter des choses lourdes», n’a que trois serials à son compteur mais fait déjà partie des bons, entre humour, mélancolie et brutalité (parfois) calculée.
O.V.V.
3. Train de nuit
De Martin Amis.
Editions Calmann-Levy, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Frédéric Morin, 160 pages.
La cote de Focus: 4/5
Expert en satires sociales radicales (Money, Money, L’Information…), Martin Amis (1949-2023) s’est aussi illustré en parodiant des genres dont il détournait les codes pour en extraire le suc métaphysique. Ainsi du récit de guerre, métamorphosé en puissante réflexion sur le mal dans La Zone d’intérêt (2014), magistralement adapté à l’écran par Jonathan Glazer il y a deux ans. Ou du polar américain, passé à la moulinette de son ironie acérée et de ses questionnements tortueux dans Train de nuit.
Publié en 1990, ce petit bijou était épuisé depuis belle lurette. Sa réédition est l’occasion de (re)savourer le charme vénéneux d’une intrigue qui remue la vase des évidences et interroge les choix de (fin de) vie. Un peu comme le meurtre de Laura Palmer dans Twin Peaks ouvrait une porte dérobée dans l’inconscient d’une communauté.

Fille de flic, belle, lumineuse, brillante astrophysicienne, mariée à l’homme parfait, Jennifer Rockwell avait toutes les cartes du bonheur dans sa manche. Elle s’est pourtant suicidée un dimanche soir. Un choc. Et une énigme pour tous. Car rien ne colle: pudique, la jeune femme était nue. Et comment fait-on pour se tirer trois balles dans la tête? Inconsolable, le commissaire Rockwell charge Mike Hoolihan de refaire l’enquête. Une femme, contrairement à ce que laisse penser son nom. Ex de la crim’, respectée, cette policière désabusée ne peut refuser ce service. Parce qu’elle connaît bien la victime et parce que le gradé l’a aidée à s’arracher des griffes de l’alcool quelques années plus tôt. Une affaire pas comme les autres qui va l’emmener, et nous avec elle, dans une zone floue où la rationalité ordinaire se heurte à des forces souterraines.
Maniant le montage cut et le langage cash, Martin Amis déploie son labyrinthe de faux-semblants. Mike creuse différentes pistes, rassemble des bouts d’indices qui épaississent le mystère plus qu’il ne le lève. Pourquoi avait-elle des traces de lithium dans le sang? Pourquoi Trader a-t-il été aperçu sortant de chez eux «l’air affolé» juste avant le drame? Le fantôme de Jennifer la met à l’épreuve, réveille ses démons, elle qui traîne son trauma de petite fille abusée par son père et qui a l’art de s’acoquiner avec des tocards. Un dialogue post-mortem s’ébauche, saupoudré de digressions sur la taille du cosmos, de statistiques sur les suicidés et d’une petite épistémologie du mobile.
«Le suicide est le train de nuit qui vous expédie dans les ténèbres», note l’inspectrice. On ne regrette pourtant pas le voyage…
L.R.
4. Le Tout
De Dave Eggers.
Editions Gallimard, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Juliette Bourdin, 640 pages.
La cote de Focus: 4,5/5
Il y a dix ans sortait Le Cercle, dystopie cinglante sur l’ère du digital, qui postulait l’émergence d’un superacteur numérique, un ex-fournisseur d’accès Internet qui avait absorbé aussi bien le réseau que ce qu’on en faisait, mails, transactions bancaires et, surtout, les réseaux sociaux, pour œuvrer à l’avènement de la Transparence.
Comme il a toujours un coup d’avance, Dave Eggers revient avec Le Tout, hypersociété qui aurait avalé Google, Apple, Meta, Amazon et plus si affinités, comme si les Gafam n’avaient plus besoin d’un acronyme puisqu’ils ne seraient plus qu’une entité unique. Face à la surabondance de choix engendrée par la société capitaliste, le Tout se propose d’aider le citoyen consommateur à réguler non seulement ses besoins mais aussi ses envies pour rien moins que sauver le monde. Qui pourrait vouloir dire non à un si vertueux projet? Il y a bien Delaney Wells, en tous cas. Enfant du tout-numérique, elle se rêve lanceuse d’alerte et décide de semer les graines de la révolte depuis l’intérieur en se faisant embaucher par le Tout… Mais l’humanité est-elle vraiment prête à se battre pour conserver son libre arbitre?

L’univers inventé par Eggers est vertigineux. Il y décrit avec une méticulosité virtuose un monde si proche du nôtre que l’on finit par se perdre quand il s’agit de démêler le faux de la fiction du vrai de nos addictions technonumériques. Il n’est pas impossible que le romancier américain possède le don de visualiser le futur. Pas le futur du siècle prochain mais celui de demain ou après-demain, déjà en germe dans le présent. Le Tout sonne comme un ultime avertissement avant la sortie de route. C’est drôle et effrayant à la fois, comme une comédie horrifique où la peur l’emporterait largement sur l’humour, à bien y réfléchir.
A.E.
5. Les Lendemains qui chantent
D’Arnaldur Indridason.
Editions Métailié, traduit de l’islandais par Eric Boury, 336 pages.
La cote de Focus: 4/5
En quelques pages –pas de temps à perdre–, Arnaldur Indridason lance ses cannes pour ramener du lourd de ses eaux islandaises, poisseuses mais toujours riches: un teinturier sans histoire qui disparaît, un cadavre retrouvé sur la rive du lac Hafravatn, un autre dans les fondations d’un chantier (celui d’un homme que l’on pensait noyé), et comme toujours chez lui, des histoires du passé qui modèlent le présent, tel ce trafic de Lada entre Islandais et marins soviétiques, à l’époque où l’île accueillait une base militaire américaine et où Konrad était un jeune flic, pas encore à la retraite, abîmé et très mélancolique.
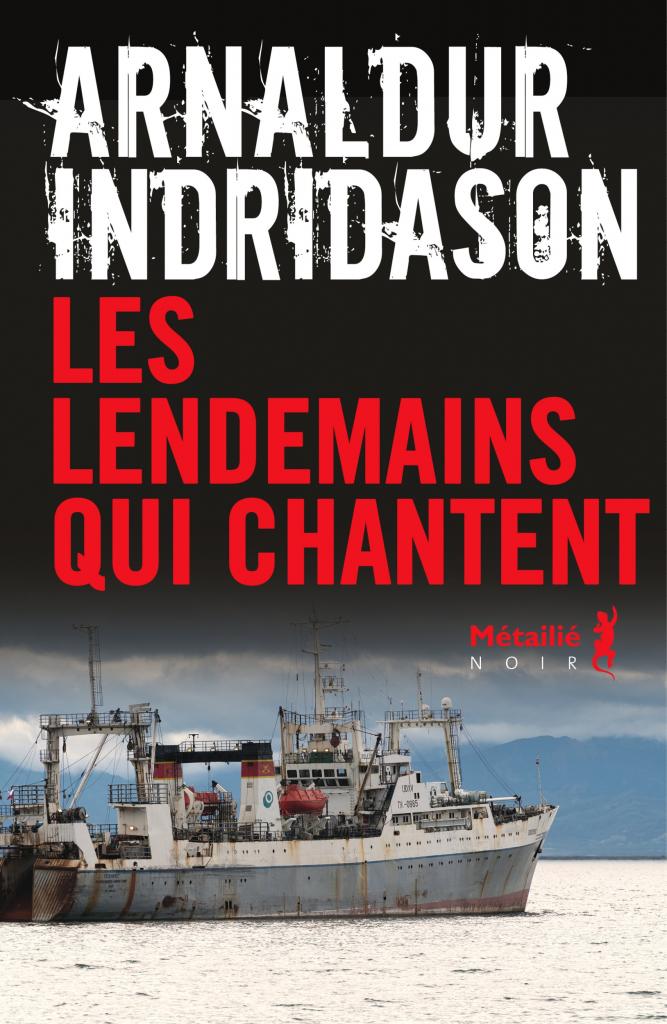
Car oui, qu’on ne s’y trompe pas, cet Indridason-ci fait partie de son serial Konrad, encore plus noir et triste que ses polars consacrés au commissaire Erlendur. Du pur noir scandinave, digne de Sjöwall et Wahlöö, mâtiné de Simenon.
O.V.V.
6. Quatre couleurs
Avec les cinq euros chipés à sa mère, Obi s’achète un trésor, le Bic quatre couleurs qui fera bisquer toute la classe. Indifférent aux enfants qui piaillent, Monsieur V. rempile pour une journée de trop et voudrait disparaître. Les idéaux encore intacts, Madame E., remplaçante en français, flaire le danger de la salle des profs, où même les ordis ont rendu l’âme. Invisible, Jocelyne, en charge de l’entretien, pousse son charriot en maugréant contre cette machine à bouillir qui rend stériles «les jolies choses par quoi s’arracher aux puissances».

© Jérôme Panconi
Croisant les monologues intérieurs, Thomas Terraqué polit un regard aigu et empathique sur un collège en zone d’éducation prioritaire. Ramassé sur une unité de temps et de lieu, le court roman égrène la journée comme un compte à rebours. Passion, courage, public spécifique, laïcité… Vidés de leur substance, les mots s’entrechoquent, ajoutent au désarroi. Tous portent sur l’école, cette cocotte-minute, un regard abasourdi. Le plus réussi: la petite voix d’Obi, livré à lui-même, un peu chelou, qui scrute et désarme… Poétique et engagé, avec le phrasé d’aujourd’hui tel un boomerang. «Mais qu’est-ce tu racontes frère? Vas-y bouge.»
F.DE.
