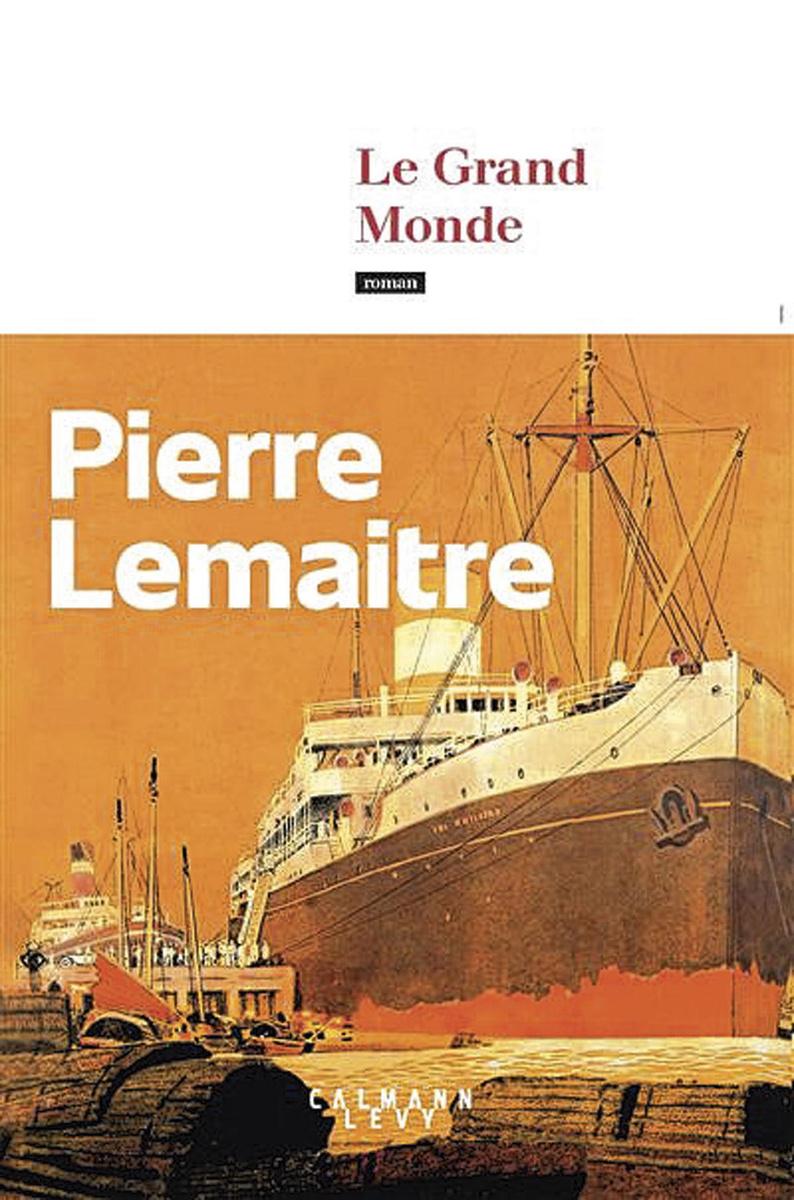Au sommet de son art, l’écrivain signe un roman d’aventure jubilatoire qui se double d’un portrait ravageur de la France de l’immédiat après-guerre. Un tour de force littéraire qui redonne ses lettres de noblesse au roman populaire.
Pierre Lemaitre en a fini avec la trilogie « Les Enfants du désastre », qui se déroulait dans l’entre-deux-guerres, mais pas avec le XXe siècle. Le Grand Monde (1), roman d’aventure addictif caracolant entre Beyrouth, Saigon et Paris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (lire l’encadré ci-dessous), ouvre un nouveau cycle ayant pour décor les Trente Glorieuses et pour acteurs les membres d’une famille presque ordinaire, les Pelletier. A la croisée du roman picaresque, du roman social et du polar, le Goncourt 2013 (pour le formidable Au revoir là-haut) confirme qu’il est bien le grand écrivain populaire français des années 2000, de la trempe d’un Dumas ou d’un Zola. Rencontre sans chichi mais pas sans chaleur humaine ni froide colère.
Auriez-vous aimé vivre à l’époque que vous décrivez?
Pas spécialement. On a l’impression que la guerre se poursuit sous d’autres formes. Ce n’est plus une guerre militaire, une guerre d’occupation ou de résistance, c’est une guerre économique dont tout le monde est victime. En fait, les Trente Glorieuses sont vingt. Il y a d’abord eu dix années piteuses.
Un scandale politico-financier est au coeur du roman. Comme souvent depuis le début de la saga. Pourquoi?
Des malversations financières, il devait déjà y en avoir sous les pharaons. Dès qu’il y a de l’argent, il y a du profit. Dès qu’il y a du profit, il y a de la concussion. C’est éternel, ce truc-là. Et ça continue, bien sûr.
Votre vision de l’Indochine est assez apocalyptique. On nage en pleine décadence…
C’est un monde décadent dans la mesure où il ne vit plus dans le présent mais dans un fantasme d’empire colonial français qui n’a rien à voir avec la réalité. Saigon est une ville-monde dans laquelle les colons se bercent encore de l’illusion d’un pouvoir colonial alors que la ville est littéralement assiégée par le Viêt-Minh et les forces prochinoises. La France n’est plus capable de gagner militairement, elle le sait. Elle essaie donc d’acheter le pays, notamment en surévaluant la monnaie locale. C’est une approche très désespérée.
Plus je vieillis, plus je me radicalise. Il faudra m’abattre pour me calmer.
Dans les prochains volumes, vous aborderez des périodes que vous avez vécues. Comment comptez-vous vous y prendre?
Plus je m’approche de la période que j’ai connue, plus ça me pose problème. Parce que je vais devoir confronter les souvenirs que j’en ai à la réalité historique et je ne suis pas sûr que ça fera bon ménage. Quand je parle des années 1930, personne ne s’en souvient. J’ai un boulevard. Il n’y a que quelques historiens pour éventuellement me contredire.
Plus que l’exactitude, c’est la vérité qui vous intéresse, dites-vous…
Je ne suis pas un historien. Mais je m’interroge quand même sur la responsabilité de l’écrivain par rapport à ce qu’il dit. L’exactitude, je m’en fiche. Une dame m’a écrit un mot gentil pour me préciser qu’il était impossible qu’Hélène commande un magret de canard, invention plus tardive. Je dois vous dire que je n’ai pas beaucoup souffert d’avoir commis un anachronisme. En revanche, j’ai de jeunes lecteurs qui me suivent depuis Au revoir là-haut, qui a été souvent au programme des lycées. Je me mets à la place d’un jeune lecteur qui ne connaîtra peut-être jamais de l’Indochine que ce que j’en dis. Si j’écris n’importe quoi parce que je suis romancier et que je me fous de l’histoire, je vais commettre une faute morale. Mon curseur, il est moral.

Quelle est la recette pour rendre le récit si jubilatoire?
En écrivant, j’essaie de retrouver la jubilation du lecteur que j’étais quand je lisais Les Pardaillan de Michel Zévaco, Les Misérables ou Les Trois Mousquetaires. Assez mécaniquement, cette jubilation passe chez un certain nombre de lecteurs qui ressentent ce que je ressentais, cinquante ans plus tôt.
On a parfois l’impression que vous brossez un portrait en creux de l’époque actuelle. Même agitation politique, mêmes scandales, etc. Est-ce délibéré?
Je n’intègre pas dans le récit des sujets parce qu’ils posent aujourd’hui un problème, mais quand je les rencontre dans la destinée de mon personnage, je m’interroge pour savoir comment je vais les traiter pour qu’effectivement, le lecteur, s’il le souhaite, puisse faire la résonance. Je vous donne un exemple: en 1947-1948, la tension sociale est très vive, et je découvre lors de mes recherches que le 11 novembre 1948, qui est exactement dans le timing de mon roman, une manifestation organisée par les partis communistes se retrouve sur les Champs-Elysées et que la police frappe fort. Des journaux de l’époque parlent de violence policière. Quand je vois ça, je pense forcément aux gilets jaunes, je pense à la police d’Emmanuel Macron qui éborgne les manifestants et essaie de les intimider pour qu’ils renoncent à leur droit constitutionnel à manifester. Je me suis dit: je vais utiliser l’événement mais je ne vais pas avancer masqué. Donc, mon journaliste, il écrit un éditorial qui pourrait être un éditorial d’aujourd’hui.
Je ne suis pas un historien. Mais je m’interroge sur la responsabilité de l’écrivain par rapport à ce qu’il dit.
Les scènes de foule reviennent régulièrement dans vos livres. Un péché mignon?
J’aime ces scènes parce qu’elles donnent de l’ampleur romanesque au sujet. Et puis, ce sont des morceaux de bravoure. C’est compliqué, il faut donner du mouvement. Je relis Aragon, Dumas, Zola, je regarde comment ils ont fait. Ça me fait saliver. Puis je me lance, je me trompe, je déplace l’oeil de la caméra et, finalement, ça fonctionne. Je sais aussi que c’est un rendez-vous avec les lecteurs, car quand je lis ça moi-même dans les romans d’aventure, je suis complètement pris.
Le complexe de légitimité qui vous a longtemps travaillé s’estompe- t-il avec le succès?
Ça va mieux docteur, merci. Je recommande le Goncourt pour se soigner. Certains font de la psychanalyse mais un Goncourt, c’est pas mal aussi.
La colère a toujours été un des moteurs de votre travail. Contre l’injustice, notamment. Ce sentiment s’émousse-t-il avec l’âge?
Non. Il se radicalise. Je pensais l’autre jour à Anatole France qui était un grand bourgeois installé et qui a fini sa vie au parti communiste. D’habitude, c’est l’inverse. Les gens qui commencent à l’extrême gauche finissent macronistes. Moi, plus je vieillis, plus je me radicalise. Il faudra m’abattre pour me calmer.
Justement, quel regard portez- vous sur l’élection présidentielle française?
Je me dis que le néolibéralisme qui est actuellement au pouvoir est condamné à moyen terme parce qu’il se fracassera sur la crise éco- logique qui nous attend. Mais je suis quand même sidéré que, hormis quelques rares candidats qui mettent ce sujet au coeur de leur problématique, pour le reste, on est dans un déni spectaculaire. On a l’impression d’être dans des temps normaux. J’ai habité près d’ Avignon, qui est à l’épicentre des dégâts que provoquera le réchauffement climatique en France d’ici à 2050. Il ne s’agit pas que de la température qui sera celle de Marrakech, mais aussi de tornades, de vent, d’accès à l’eau, etc. Et là-bas, les gens continuent à acheter des maisons comme si ça n’existait pas. On choisit de ne pas croire ce que l’on voit.
N’y a-t-il pas un optimisme démesuré dans les nouvelles technologies pour trouver des solutions?
Vous avez raison. C’est une déclinaison très néolibérale. Quand on regarde les propositions de Macron, il va résoudre les problèmes éco- logiques par la technologie. Alors que c’est la technologie qui nous a conduits à la catastrophe, il pense qu’elle sera le remède aux maux de la technologie. Ce qui est une vision obsessionnelle de la technologie qui va bien avec le caractère néolibéral de ces gens-là. Moi, je n’y crois pas. La technologie doit nous fournir des outils mais ce n’est pas la solution. La seule solution, c’est de changer notre mode de vie. Or, ce sont de mauvaises nouvelles. Et peu de politiques ont le courage de le dire…
(1) Le Grand Monde, par Pierre Lemaitre, Calmann-Lévy, 594 p.
L’aventure, c’est l’aventure
Du souffle, du suspense, de l’émotion, des dialogues qui claquent, des personnages gratinés… Il ne manque rien dans ce premier volet jouissif du nouveau cycle que Pierre Lemaitre consacre aux Trente Glorieuses après avoir arpenté l’entre-deux-guerres. Dans une France essorée entretenant l’illusion de sa splendeur coloniale en cette année 1948, il raconte d’une plume alerte et virevoltante les (més)aventures des Pelletier, dont les parents ont transformé à Beyrouth une modeste savonnerie en activité florissante. Des notables qui voient leurs enfants s’exiler les uns après les autres: Jean, le benêt de la bande, est parti à Paris avec son excentrique Geneviève pour fuir l’échec de la reprise de l’usine ; François, le plus rusé, a suivi le même chemin mais pour se faire un nom dans le grand journal populaire de l’époque ; Etienne, l’idéaliste, s’envole vers Saigon pour y retrouver son amant légionnaire dont il est sans nouvelles ; Hélène, la cadette délurée, attend son heure dans le lit de son prof de mathématiques. Dans un feu d’artifice de couleurs, d’odeurs et d’intrigues secondaires, dont certaines rappellent qu’il est entré en littérature par la porte du polar, Pierre Lemaitre régale le lecteur et livre un portrait tragi-comique d’une époque vérolée – déjà – par les scandales, les remous politiques et la démagogie. Epatant.