Jonathan Coe, maître notamment ès fresques romanesques qui sondent l’histoire contemporaine de son cher pays, revient avec une exploration plus ludique mais toujours aussi urgente de l’installation au pouvoir des populistes, et de notre drôle de rapport à la réalité, à l’ère de la post-vérité. Les Preuves de mon innocence est un murder mystery méta sur fond de luttes de pouvoir à l’université, chez les intellectuels et dans la classe politique, où l’enquête est menée en parallèle par deux générations de femmes (Prudence l’inspectrice, Rash et Phyl, les «héritières»). Un texte –comme toujours chez lui– nostalgique, mais qui pourtant saisit l’air du temps.
Les Preuves de mon innocence
Roman de Jonathan Coe. Gallimard, traduit de l’anglais par Marguerite Capelle , 480 p.
La cote de Focus: 4/5
Que peuvent bien avoir en commun un boomerang aborigène, un écrivain qui chante dans son sommeil, une inspectrice à la veille de la retraite et un épisode de Friends? Tous se retrouvent dans Les Preuves de mon innocence, exploration ludique de la droitisation des esprits en Grande-Bretagne et ailleurs, et de l’avènement de l’ère de la post-vérité. Dans un texte foisonnant, Coe pastiche tour à tour le cosy crime, le roman universitaire et l’autofiction. Avec une ironie certaine, sans complaisance mais sans cruauté non plus, il poursuit son étude fictionnelle de l’histoire récente de son pays entamée au début des années 1990 avec son troisième roman Testament à l’anglaise, dont il fait réapparaitre l’un des personnages secondaires, comme pour préserver une continuité mise à mal dans la vraie vie, mais encore possible en littérature. La boucle est bouclée.
Peut-on commencer par parler de la forme du roman? Vous vous amusez à pasticher, en particulier le cosy crime.
Jonathan Coe: J’ai découvert l’existence du cosy crime dans une librairie du sud de la France, et ça me semblait coller parfaitement à l’intrigue que j’avais en tête, un meurtre dans une convention de conservateurs, dans une belle demeure. Ça me permettait également d’explorer enfin un personnage d’écrivain frustré que j’avais en tête depuis longtemps. Comme une partie de l’intrigue devait se dérouler dans les années 1980, ça m’a ramené à ma situation d’étudiant à Cambridge à l’époque. D’où l’idée de la Dark Academia, un peu comme dans Le Maître des illusions de Donna Tartt. Maintenant que j’ai atteint la soixantaine, je me rends bien compte que certains jeunes auteurs peuvent penser que ma façon d’écrire, au passé, et à la troisième personne, est un peu démodée. Je suis loin de l’autofiction, donc j’ai voulu m’y coller dans la dernière partie. Mes deux narratrices s’opposent, Rash écrit au présent, dans une sorte d’immédiateté, et Phyl au passé. Phyl croit au pouvoir de la fiction, Rash pense que l’on ne devrait dire que la vérité. Il y a un dialogue à propos de ces deux esthétiques, alors même qu’elles s’emploient à résoudre le crime. Ce que j’aime avec le fait d’écrire un pastiche, c’est que même s’il y a certaines conventions qui doivent être respectées, c’est étrangement très libérateur. On a les ingrédients, on n’a plus qu’à trouver les variations dans la recette.
Lire aussi | Donna Tartt, l’oiseau rare
La question de la vérité est au cœur du livre, à travers l’enquête bien sûr, mais aussi dans l’air du temps. Celui-ci se déroule durant la brève période où Liz Truss (ancienne Première ministre au Royaume-Uni) est au pouvoir, et vous dites: «Fini la réalité, bonjour les fables.» Liz Truss symbolise-t-elle cette ère de la post-vérité?
Jonathan Coe: A vrai dire, je crois que la post-vérité a commencé en Grande-Bretagne en 2016, avec le Brexit. La campagne a été menée essentiellement sur la base de sentiments, et pas des faits. Mais l’accession au pouvoir de Liz Truss a encore approfondi cela. Pendant quelques semaines, nous avons eu à la tête de l’Etat quelqu’un qui était animé par une pureté idéologique très forte, pas par la réalité économique du pays. Elle a pris très vite des décisions radicales, qui ont eu des conséquences désastreuses sur l’économie. C’était une période assez irréelle, ou surréaliste. Et puis son arrivée au pouvoir a coïncidé avec la mort d’Elizabeth II, deux jours seulement après que Liz Truss se soit installée à Downing Street. Quoi qu’on pense de la monarchie, la Reine représentait une forme de continuité symbolique. Cela a peut-être même signé la mort d’une certaine Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne d’après-guerre.
Phyl et Rashida dialoguent à propos de la fiction. L’une dit «on va essayer de vous raconter la vérité»; l’autre dit «notre vérité». Comment peut-on se mettre d’accord sur la vérité si nous avons chacun la nôtre?
Jonathan Coe: Quand je lis un article, ou même un livre de non-fiction, je me demande si je peux avoir confiance en l’auteur. Est-ce que c’est la vérité, ou sa vérité? Quelles sont ses intentions? Le seul moment où je ne me pose pas cette question, c’est quand je lis de la fiction, car par principe rien n’y est «vrai». Il y a une honnêteté à cet endroit, dans ce pacte avec le lecteur. Ça rend l’écriture et la lecture de fiction de plus en plus importantes, et même précieuses à mes yeux.
Est-ce que cela fait de la fiction un bon outil pour écrire l’histoire, récente notamment?
Jonathan Coe: Je pense que oui, parce que tout aujourd’hui est subjectif, tout dépend d’une perception individuelle, d’un point de vue personnel. Or, un roman historique ne vous raconte pas seulement ce qui est arrivé, mais aussi ce que ça fait de vivre ce qui est arrivé.
Liz Truss représente également la droitisation de la politique britannique, mais vous situez les racines du phénomène dans les années 1980.
Jonathan Coe: Que ce soit en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, on a le sentiment que la droitisation s’accélère fortement en ce moment. Il y a Trump, bien sûr. Et puis, le centre-droit a peu ou prou disparu en Grande-Bretagne quand Boris Johnson a accédé au pouvoir. L’extrême droite est devenue beaucoup plus influente. De nombreux membres du Parti conservateur l’ont quitté pour rejoindre Reform, le parti de Nigel Farage. Les graines de tout cela ont été semées dans les années 1980 par Thatcher et Reagan. Les penseurs conservateurs des deux côtés de l’Atlantique ont débuté dans ces années-là un dialogue soutenu, comme on a d’ailleurs pu le voir récemment à Londres, où Elon Musk lui-même a pris la parole lors d’une manifestation d’extrême droite anti-immigration.
C’est une guerre culturelle. Il ne faut peut-être pas prendre le mot à la légère, mais vous posez cependant un œil très caustique sur tout ça.
Jonathan Coe: Tout cela est lié une fois encore à l’idée qu’il est difficile de trouver la vérité, et de conserver notre emprise sur la réalité empirique. L’un des outils pour le faire, c’est le langage, mais c’est à double tranchant. Le mot «woke» par exemple, à l’origine, était lié au combat des Noirs américains. Aujourd’hui, pour la droite, c’est un mot qui englobe tout ce qu’elle considère comme des abus. Il y a encore quelque temps, les gens se décrivaient volontiers comme woke, mais aujourd’hui ils sont presque embarrassés de l’admettre. Ça montre où réside vraiment l’influence.
Pour moi, la comédie est une merveilleuse façon de réunir les gens.
Il y a une forme d’autovictimisation de cette droite, qui passe son temps à dire qu’elle ne peut plus rien dire, ce que vous soulignez aussi.
Jonathan Coe: Oui, en Grande-Bretagne, l’une des notions fondamentales, c’est celle de la liberté d’expression. Qui aurait donc disparu. Mais pour vous donner un exemple que je n’aurais même pas osé mettre dans mon livre tellement il est énorme, le Daily Mail a publié en une un article la semaine dernière disant que la Grande-Bretagne était devenue l’équivalent de la Corée du Nord. Comme s’ils avaient pu publier ça en Corée du Nord! Un autre mot clé, c’est celui des «élites», qu’utilisent à tort et à travers les politiciens populistes. Elles sont accusées de tous les maux, sans qu’on sache jamais très bien qui elles sont, d’autant que des gens comme Trump ou Farage, malgré leur fortune et leur sphère d’influence, se définissent comme anti-élite.
Le livre questionne aussi une figure un peu particulière: celle de l’écrivain de droite.
Jonathan Coe: L’un de mes auteurs favoris, Evelyn Waugh, était tout ce qu’il y a de plus conservateur sur le plan politique. Mais c’est vrai qu’il y a sûrement plus de gens de gauche que de droite dans le monde littéraire. Pour moi, l’acte d’écrire vient d’un sentiment qu’il y a fondamentalement quelque chose qui ne va pas dans le monde tel qu’il est, et l’écrivain ressent le besoin de décrire cette réalité, à la fois pour en dresser un portrait fidèle, mais peut-être aussi pour le rendre plus supportable. Cela dit, les conservateurs peuvent aussi ne pas se satisfaire de la réalité…
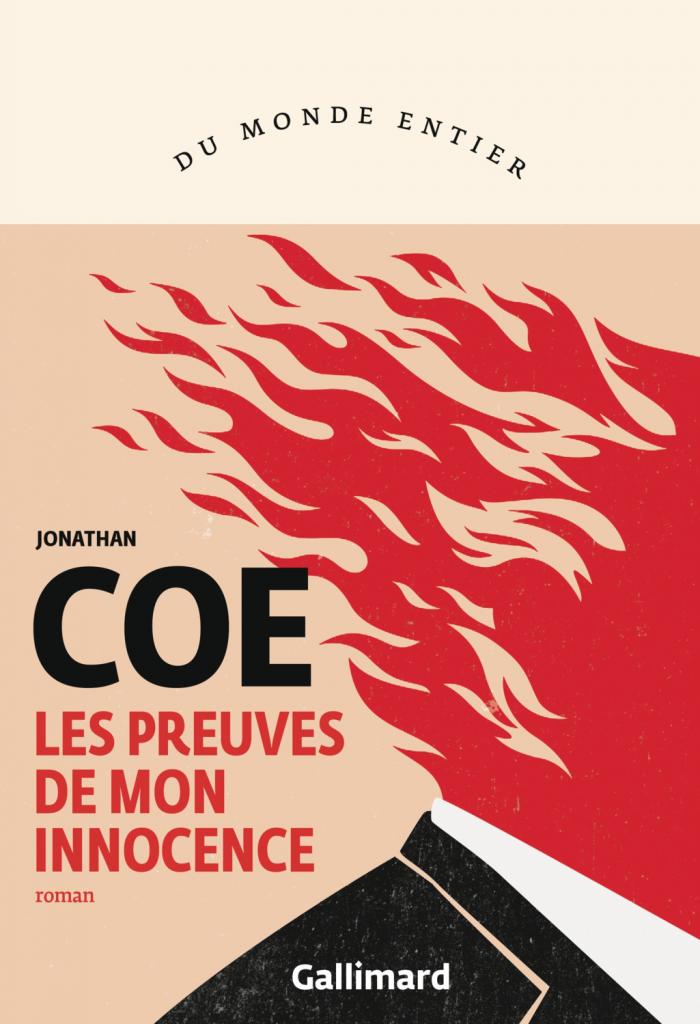
Malgré la dangerosité de ces idées, le ton général du roman est celui de la comédie. Qu’est-ce que celle-ci vous permet?
Jonathan Coe: Nous vivons des moments difficiles, et je voulais écrire quelque chose qui me fasse plaisir, et qui fasse plaisir au lecteur. Je pense de toute façon que l’on a tendance à prendre la littérature un peu trop au sérieux parfois. Pour moi, la comédie est une merveilleuse façon de réunir les gens, d’offrir une sorte de territoire émotionnel à partager, où l’on rit ensemble de la même chose. La comédie abolit les frontières, abat les murs qui nous séparent. On est tous comme enfermés dans notre propre réalité, dans notre façon très subjective de voir le monde, et je pense que les blagues, même les blagues idiotes, peuvent lutter contre ça.
Dans le livre, il y a un objet comique qui rassemble les générations, c’est la série Friends, comme un refuge, rassurant, un pont entre parents et enfants.
Jonathan Coe: Nombre de mes livres posent la question de la nostalgie. Pour celui-ci, je suis tombé sur un mot fabuleux, «anemoia», qui désigne la nostalgie d’une époque que l’on n’a pas vécue. Et c’est vrai aussi que des comédies comme Friends permettent de rassembler les générations malgré ce qui les sépare. Par ailleurs, c’est ce que j’appellerais de la cosy comedy. Ce n’est pas une forme qui va remettre en question votre vision du monde, comme certaines peuvent le faire. Je pense que le grand art devrait nous faire penser le monde d’une nouvelle façon. Mais je crois aussi qu’il y a de la place pour une forme d’art plus simple peut-être, qui offre une forme de thérapie, comme du baume au cœur, qui soigne nos angoisses. Un endroit où se réfugier occasionnellement quand le monde devient un peu trop âpre.
