« La fiction, par sa forme même, est démocratique ». C’est la théorie d’Azar Nafisi, et c’est pour cette raison qu’il lui a semblé plus pertinent que jamais de partager, près de 20 ans après Lire Lolita à Téhéran, ode au pouvoir irréductible de la littérature, cinq lettres adressées à son père, qui reviennent sur la situation intellectuelle de la société américaine, balafrée par le mandat Trump.
Dans Lire dangereusement, elle évoque, en citant quelques-uns des auteurs de son panthéon personnel (Toni Morrison, James Baldwin, Platon, Ta-Nehisi Coates, Elias Khoury) le pouvoir de la littérature quand il s’agit de penser hors des préjugés et des stéréotypes, de multiplier les points de vue, et peut-être, surtout, de susciter et nourrir notre capacité à l’empathie.
Était-il urgent pour vous d’écrire ce livre?
La majorité des gens pense qu’une démocratie ne peut pas faire machine arrière pour devenir une dictature, mais c’est exactement ce que j’ai vu advenir en Iran. Le fait que les gens ne soient pas conscients de la gravité de la situation rend les choses particulièrement urgentes pour moi.
Vous soulignez cette dichotomie: en Iran, on torture et emprisonne les poètes, aux États-Unis on les ignore, ce sont finalement deux faces d’une même pièce.
Tant que les livres étaient autorisés en Iran, on ne s’en préoccupait pas vraiment, pensant que ce serait toujours le cas. Mais la démocratie, il faut l’entretenir, la soigner. En Amérique, les gens ont trop de confort, ils ne veulent pas être dérangés, alors ils restent coincés dans une idéologie simpliste. Je suis souvent confrontée à des étudiants qui me disent: « Je ne peux pas lire ça car ça me met mal à l’aise, je trouve ça dérangeant ». Et j’ai envie de leur dire: « Mais la vie est dérangeante!« Si on ne peut pas tolérer les mots de quelqu’un d’autre, comment pourrait-on tolérer sa réalité, voire son existence? Si on ne peut pas regarder quelqu’un en lui disant: « Je suis opposée à toi, mais je sais que tu existes », on va devenir un État totalitaire, qui veut éliminer l’opposant. En démocratie, on n’élimine pas l’autre, on échange avec lui.
En parlant de livres qui dérangent, vous évoquez Margaret Atwood et La Servante écarlate. Vous expliquez que la fiction d’Atwood ressemblait fort à votre réalité… On en vient à l’universalité de l’expérience de la fiction.
C’est ce qui rend la fiction si grande. On l’écrit d’un endroit spécifique, mais elle est universelle. Bien sûr, le roman d’Atwood est une dystopie, mais d’une certaine façon, je l’ai vécue. Quand mes amies iraniennes me disaient ne pas vouloir en parler car elles avaient le sentiment de vivre cette situation, je leur disais que c’était justement pour ça que l’on devait en parler. Que c’est pour ça qu’Atwood est importante. Elle porte le message des victimes du totalitarisme auprès d’autres pays qui ne sont pas (encore) totalitaires.
Le livre aborde également la question du backlash, le fait que nos droits ne sont pas un dû mais un privilège.
On le vit en ce moment-même, ce backlash. Je dis souvent à mes étudiants que leurs droits ne leur ont pas été donnés par la grâce de Dieu, que des gens sont morts pour qu’ils puissent en jouir. Et ça m’agace toujours de voir à quel point les gens vivant dans des sociétés démocratiques n’ont aucune conscience du fait que les droits dont ils disposent peuvent leur être enlevés à tout moment. Les gens comme Trump aujourd’hui ont nos droits dans leur ligne de mire.
Vous citez Ray Bradbury, ou Salman Rushdie, qui dit comment la littérature dit le vrai, quand l’État a besoin du faux.
L’écrivain révèle la vérité au monde. Or quand on connaît la vérité, on ne peut pas rester silencieux, sans quoi on devient complice des crimes qui sont commis. La beauté de ça, c’est qu’il n’y a pas que les écrivains qui sont impliqués dans la vérité. Les lecteurs le sont aussi. La vérité est si dangereuse, que la première chose que font les systèmes totalitaires, c’est d’attaquer les porteurs de la vérité, les femmes, les minorités, et celles et ceux qui œuvrent dans le domaine de l’imagination et des idées. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont peur. Le fait qu’ils utilisent leurs armes n’est pas un signe de force. La force, elle est du côté de ces jeunes Iraniennes qui enlèvent leur voile et descendent dans les rues. Le régime n’est pas puissant. Il est violent, mais pas puissant.
Vous évoquez aussi des écrivains du Moyen-Orient comme David Grossman. Ils parlent de guerre, et pour eux, l’écriture est une arme de paix, en poussant à connaître l’ennemi, à appréhender son humanité.
C’est la chose la plus difficile dans la vie, regarder son ennemi comme un être humain. C’est tellement facile de se laisser posséder par la haine. Comprendre son ennemi, c’est refuser d’aller sur son terrain, pour l’amener sur le nôtre. Écrire est un acte d’amour. On peut détester, en écrivant, mais les meilleures écritures sont des actes de révélation. À soi-même et aux autres. On écrit pour être lu. On se rapproche de gens qui ne sont pas comme soi, ce qui amène l’empathie.
Votre père disait que le monde entier sait beaucoup sur l’Amérique, mais que l’Amérique ne sait pas grand-chose sur le monde. On en revient à la curiosité.
Oui, mon père était obsédé par l’Amérique, il la regardait comme un phénomène qu’il voulait comprendre. Pour lui, ce qui mettait l’Amérique en danger, c’était l’ignorance. Ne pas connaître le monde, mais poser quand même un jugement sur le monde. Mon père m’a transmis le goût des livres et, grâce à eux, j’ai visité de nombreux pays avant même d’y mettre les pieds. J’appelle ça mon « monde portable », et ça, personne ne peut me l’enlever. Là maintenant aux États-Unis, on est au cœur d’un ouragan. Cet ouragan peut vous prendre tout ce que vous possédez. Mais ni lui ni personne ne pourra jamais me prendre mon monde imaginaire.
Vous citez l’exemple d’une jeune étudiante, Razieh, « amoureuse » de Henry James, au point d’en parler jusqu’à ses dernières heures, enfermée dans une geôle iranienne. Cela montre aussi comment la littérature voyage dans l’espace et le temps.
Oui, la littérature transcende tous les obstacles que la réalité met sur notre chemin. Elle transcende la nationalité, le genre, la race, la religion. Elle nous emmène dans une république de l’imagination où tout le monde est le bienvenu. C’est la démocratie ultime. Je dis toujours toujours que les bibliothèques sont les endroits les plus démocratiques au monde.
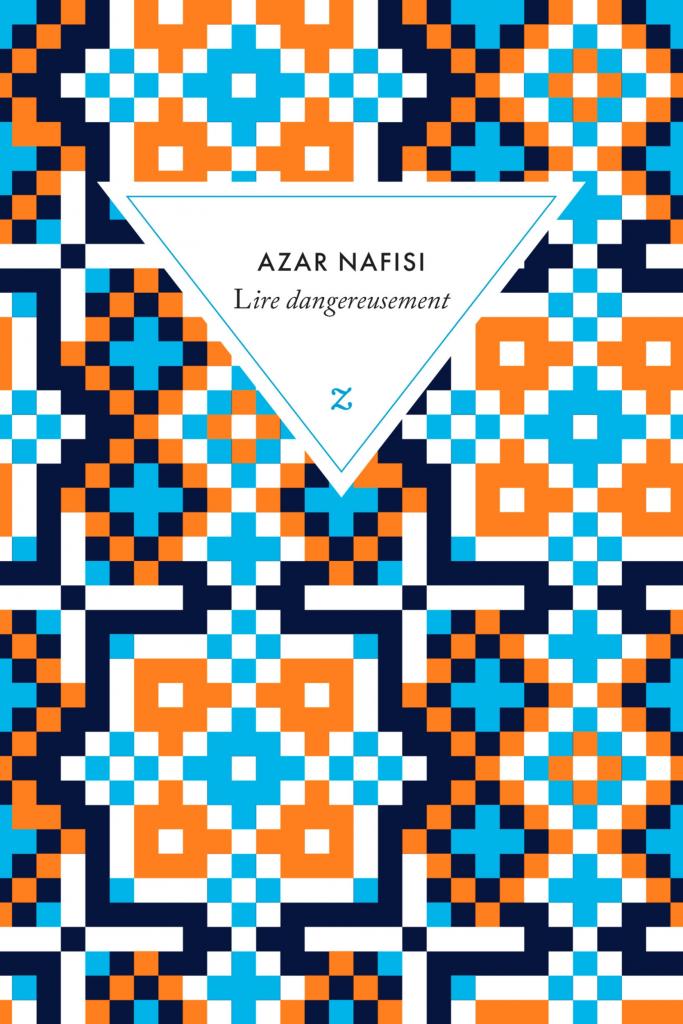
Azar Nafisi
1955 Naissance à Téhéran
1997 Exil à Washington
2004 Sortie du best-seller Lire Lolita à Téhéran aux éditions Zulma
2024 Sortie de Lire dangereusement chez le même éditeur
