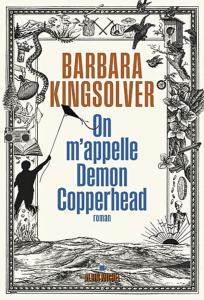Dans On m’appelle Demon Copperhead, roman d’apprentissage dense et attachant, Barbara Kingsolver met un gamin des Appalaches face à la crise des opioïdes et dans les pas de David Copperfield.
Depuis la publication française de L’Arbre aux haricots en 1996, Barbara Kingsolver (que rien au départ ne destinait à une carrière dans l’écriture) n’a de cesse de tenter d’élargir notre capacité de compassion. De nous donner à lire plutôt les vulnérables que les puissants. Frondeuse et choisissant ses combats, elle a fait de l’écologie une de ses priorités, au point de mettre l’autonomie alimentaire en pratique dans Un jardin dans les Appalaches en 2009. On m’appelle Demon Copperhead (corécipiendaire, entre autres, du prix Pulitzer 2023) transpose les personnages, l’intrigue et la pauvreté systémique du David Copperfield de Charles Dickens dans le contexte américain de la crise tragique des opioïdes et dans le comté de Lee, en Virginie. Né d’une mère adolescente souvent en rehab, Demon Copperhead (tignasse rousse, colère à fleur de peau) devra tracer sa route, survivre à des familles d’accueil toxiques et à des deuils douloureux. S’efforcer de rester debout même quand une prescription faussement anodine vient enrayer sa trajectoire enfin tachetée d’un peu de lumière. Envers et contre tout, il est de ces personnages qui, ni super-héros ni super-méchants, se déposent en vous et dont, à coup sûr, vous ne voudrez pas vous sevrer.
D’après votre site internet, chaque nouveau projet d’écriture commence pour vous par une grande question. Quelle était celle d’On m’appelle Demon Copperhead?
Barbara Kingsolver: C’était très simple, cette fois: comment diable vais-je bien pouvoir raconter cette histoire? (rires) Je voulais écrire le “grand roman des Appalaches”. Nous sommes une partie invisible de l’Amérique. Les gens n’ont aucune idée de qui nous sommes ou bien ils nous regardent avec mépris. Ils nous considèrent comme des arriérés, des péquenauds. On ne retient de nous que la drogue, la violence. Or, j’adore véritablement le coin où je vis (précisément dans le comté de Washington, en Virginie, NDLR). C’est mon endroit préféré au monde et je voulais façonner une histoire qui raconte comment nous sommes devenus ce que nous sommes et ce qui est précieux à notre sujet.
Parce qu’il y avait beaucoup de traumas à exposer et à dépasser et que la façon de le faire devait être nuancée, j’imagine?
Barbara Kingsolver: Quelque chose de vraiment particulier au sujet de la région à pointer, c’est qu’elle a été exploitée pendant 200 ans par des sociétés extérieures, venues pour s’emparer de notre bois, de notre charbon, du tabac et finalement pour récolter notre douleur avec ces drogues catapultées en masse ici. C’est vraiment une histoire de dépossession et de maintien en captivité. Les industriels qui sont venus jusqu’ici voulaient garder la mainmise sur le territoire, ils ne permettaient pas à d’autres usines ou moulins de s’installer dans la région. Ils cherchaient à préserver leur main-d’œuvre juste pour eux. Ils s’efforçaient à dessein de maintenir une forme d’archaïsme dans le système scolaire. Après de nombreuses générations, vous n’avez d’autre choix que d’accepter ce type d’existence rétrécie. Vous renoncez à partir voir si ça se passe autrement ailleurs. Vous ne vous attendez pas à trouver une meilleure vie parce que personne ne vous a jamais appris que c’était possible.

On sent cependant, à travers notamment les Peggot, les voisins de Demon et de sa mère très bienveillants, qu’il existe un maillage fort. Comment expliquez-vous cela?
Barbara Kingsolver: Une chose qui arrive, selon moi, quand les gens sont à ce point opprimés à travers plusieurs générations, c’est que la solidarité augmente. Ici, on a à cœur de prendre soin les uns des autres, dans une vision un peu élargie de ceux qu’on considère comme la famille. L’autre retombée, quand on ne vous accorde pas grand-chose, c’est que vous devenez ingénieux. Demon aussi est contraint d’acquérir une sagesse très réactive face à toute situation nouvelle. Contrairement à ce que les gens pensent parfois, on est une région de débrouillards. Demon dit dans le roman: “Les gens que je connais ont presque toujours les mains occupées”. Les femmes sont toujours en train de faire trois choses à la fois, de coiffer le petit dernier tout en préparant le souper ou en cousant un patchwork. Les hommes réparent tout ce qui peut l’être. Et pour faire de la musique, on n’a pas besoin de studio, on la joue spontanément devant la maison, sur le porche. Nous sommes aussi des raconteurs, gardiens des histoires -parfois épiques- de nos voisins.
Était-ce facile pour vous de trouver le ton juste pour Demon? Nous sommes à ses côtés pendant 600 pages, le pacte est très fort.
Barbara Kingsolver: Le fait que le livre fonctionne repose entièrement sur l’attachement du lectorat à ce protagoniste. Quand j’ai décidé d’utiliser David Copperfield comme canevas, j’avais une intrigue qui tenait la route, j’avais des personnages solides, j’avais confiance dans l’arc narratif mais le fait de donner corps à ce gamin qui vous embarque dans l’histoire reposait totalement sur mes épaules. J’ai passé trois ans à l’écouter, la façonner, la raffiner. Mais au final cette tonalité est venue très naturellement à moi parce que la façon de s’exprimer de Demon est ma première langue. J’ai grandi dans le Kentucky, à causer exactement comme lui.
Quelle était votre relation à Charles Dickens et à son œuvre avant que vous ne décidiez d’écrire votre propre version appalachienne de son David Copperfield où chaque personnage a son équivalent d’un roman à l’autre?
Barbara Kingsolver: Je pense avoir lu tous ses livres. Ma première plongée dans son œuvre c’était Un chant de Noël quand j’étais enfant, probablement vers 11-12 ans. C’est un livre sur la façon dont on peut changer. Le symbolisme paraît assez évident mais c’est aussi très divertissant, et c’est ce qu’on aime avec Dickens, non? Et c’était déjà une histoire de gens pauvres, de patron détestable et de travailleurs à la peine -autant de choses que j’étais en mesure de bien comprendre, même si jeune, vu l’endroit où je vivais. Je n’ai pas suivi de cours d’écriture créative, je n’imaginais pas pouvoir devenir autrice en grandissant. Mais j’ai toujours appris en lisant, en conscientisant le fait que je pouvais tirer des leçons des écrivains. Je place Dickens dans une catégorie similaire à Steinbeck: j’admire la portée de ses histoires, la tendresse qu’il distille. Avant, Dickens faisait juste partie du cercle de mes connaissances… Maintenant, c’est mon meilleur ami et une sorte de mentor fantomatique! (rires) Pendant trois ans, il n’a cessé d’être là alors que, page par page, j’étudiais sa méthode.
Votre roman est situé dans les années 1990 et 2000. Était-ce essentiel pour vous de revenir aux origines de la crise des opioïdes sachant que c’est encore une réalité tragique aujourd’hui?
Barbara Kingsolver: Ce médicament a été introduit par Purdue Pharma (la compagnie de la famille Sackler, NDLR) dans le comté de Lee (Virginie) en 1996. Dès le départ de mon processus, je savais que ça serait un passage-clé du livre. Qu’il me faudrait ensuite exposer les effets à long terme. Aujourd’hui, aux États-Unis, ces drogues tuent encore pas moins de 150 personnes par jour, alors que depuis tout ce temps, nous sommes supposés avoir résolu le problème! Les dommages que l’addiction a créés dans le maillage de nos communautés sont comparables à l’impact d’une guerre qui n’aurait pas encore connu de cessez-le-feu. ça vous amène à agir de façon totalement désespérée, comme Dori, la petite amie de Demon: mentir à vos amis ou les voler, vendre votre ferme, votre business ou votre maison. Il est essentiel de comprendre que la grosse majorité de ces cas d’addiction ont commencé par une prescription légale. C’est le crime de Purdue Pharma: ils ont choisi délibérément de cibler cette région et ses habitants.
Quelles étaient les raisons de leur ciblage?
Barbara Kingsolver: Ils ont consulté leurs données et ont vu l’opportunité de se faire un paquet d’argent dans la région. Déjà parce que le système de soins médicaux est très vulnérable. Aujourd’hui encore, pour voir un docteur, il faut attendre des semaines, voire des mois. Et seulement si vous en avez les moyens, si votre voiture fonctionne, si vous pouvez vous absenter de votre travail. Cette pénurie de praticiens crée un surcroît intense de travail. Ceux qui exercent ne peuvent voir leurs patients que par tranches de dix minutes. Ils se contentent alors de faire des prescriptions, sans pouvoir faire un suivi sur les effets secondaires. On sait aujourd’hui que Purdue Pharma a faussé les études démontrant que le produit n’était pas addictif. On martelait aux médecins des phrases comme celles de Kent (représentant et compagnon de June, une infirmière d’abord candide puis qui a une prise de conscience sur le terrain, NDLR) dans le roman: “Ce médicament est la réponse aux prières de vos patients”. J’ai eu l’occasion de parler à des docteurs ou des réceptionnistes et les méthodes décrites ressemblent effectivement à ce qu’on voit dans Pain Hustlers, Dopesick ou Painkiller. Les représentants les bombardaient de fleurs, de chocolats, leur promettaient des séjours à Hawaï. Tout était en œuvre pour que les prescriptions suivent, sans souci éthique.
Lire aussi | La crise des opioïdes envahit la fiction