Dans ses mémoires vivifiantes, Deborah Levy donne à lire autant une femme en lutte qu’une écrivaine qui prend conscience du pouvoir de son art.
» Parler de notre vie comme bon nous semble est une liberté que, dans l’ensemble, on choisit de ne pas prendre », remarque l’autrice au début du Coût de la vie, lorsqu’une jeune Anglaise qu’elle observe se retient de tout expliciter d’une anecdote allégorique à un interlocuteur plus âgé et condescendant. C’est pourtant avec conscience de sa propre marge de manoeuvre pour se raconter et avec une maîtrise saisissante de ce qui, chez d’autres, pourrait passer pour des coq-à-l’âne qu’écrit Deborah Levy. Ce prélude fait ainsi littéralement brèche dans sa propre existence, alors que son couple vient de tomber en morceaux, et que la voilà, à 50 ans, » détricot[ant] le foyer auquel [elle a] consacré une si grande partie de son énergie créative« , avec le besoin » d’un bouclier pour [se] défendre contre la rage de son ancienne vie« . De l’anecdote professionnelle au registre universel, de la micro-étude du quotidien aux leçons à tirer de la littérature (de James Baldwin à Adrienne Rich, Emily Dickinson ou Marguerite Duras, quand une de ses étudiantes préfère Claude Cahun, Frantz Fanon ou Langston Hughes), l’autrice britannique a l’art de piquer là où il faut. Les aiguillons, ici, sont autant ceux, bien réels, d’abeilles qui tombent par mégarde dans la machine à lessiver (et qu’ adolescente, elle a pour corvée d’extirper de là), que ceux dont peuvent s’armer des mots choisis avec soin.
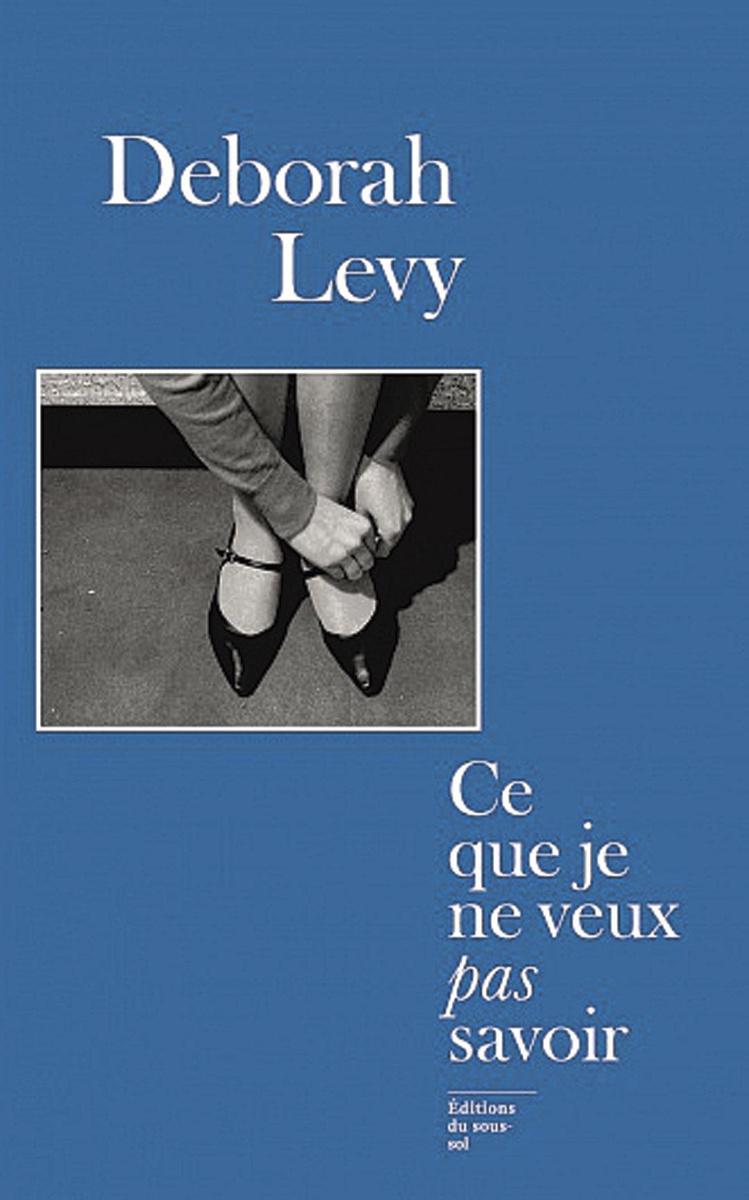
Le rire de Levy est assumé et volontiers féroce, qu’il vise les halls déprimants de son nouveau logement rebaptisés ironiquement » Couloirs de l’amour » ou les mères babillant dans un langage régressif, poursuivies par les jeunes femmes indépendantes qu’elles ont été jadis, avant que leur corps ne s’alourdisse sous une charge nouvelle induite par une société patriarcale. D’un volume à l’autre transparaît un même désir. La gamine blanche d’Afrique du Sud (dans Ce que je ne veux pas savoir), en attente de revoir son père prisonnier politique, se fait réprimander à l’école parce qu’elle profite de trop d’espace dans ses cahiers. Quant à la femme désormais séparée, elle comprend qu’écrire est sa planche de salut. Toutes deux ont cet élan vital à décider qui elles sont, à s’octroyer une plateforme suffisamment souple pour se dire, dans le chaos, la joie ou le chagrin. Avec Simone de Beauvoir en écho et son propre « Je » encore tremblant et tressautant, l’autrice veut s’extirper de l’exil symbolique où sont reléguées ses semblables et s’interroge sur les modèles étroits auxquels elles ont été de tous temps assignées, hantées par le fantôme d’une féminité scénarisée par les hommes. Il s’agira, alors, de redonner à toutes ses pairs des premiers rôles, de Maria la nounou africaine usée à la tâche à Melissa qui la première lui a fait hausser la voix jusqu’à sa mère, dont elle se rend compte qu’elle ne la laissait pas être elle-même.
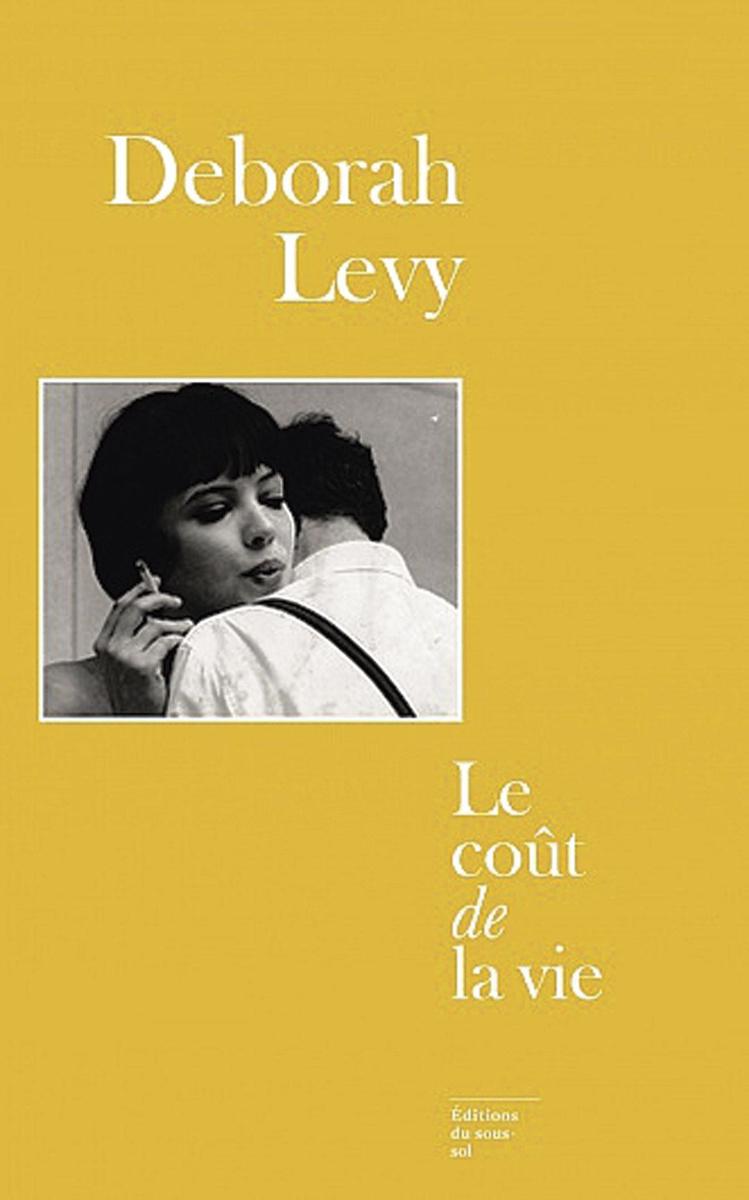
Ce que je ne veux pas savoir
Le Coût de la vie
De Deborah Levy, éditions du sous-sol, traduits de l’anglais par Céline Leroy, 144 pages et 160 pages.
8
