La question taraudait Adam Thirlwell: l’écrivain s’est donc lancé dans Le Livre multiple, un tour de passe-passe littéraire en forme d’essai tout à la fois savant et désinvolte. Pointu, mais ludique, le Britannique.
« Après tout, tout lecteur est un sauteur-de-passages: un « lecteur intermittent ». Personne ne lit dans l’ordre. Mais le roman lui-même n’étant pas écrit dans l’ordre, le lecteur intermittent devient un lecteur ordonné. » Ce genre d’aphorismes à haut degré d’abstraction, et d’idées mises sur la tête, le nouvel opus d’Adam Thirlwell en regorge: il suffit de se servir -et pas forcément dans l’ordre, donc. Phénomène littéraire britannique polyglotte (français: excellent, russe: lit Tchekhov dans le texte), Adam Thirlwell, 35 ans, affectionne les contradictions et les postures. Hipster universitaire, romancier intello largement adoubé par sa caste (Milan Kundera est fan), le Londonien au look faussement négligé a démontré qu’on pouvait appliquer le syndrome geek à la littérature, la pratiquant en usager compulsif, fanatique des références et joueur.
Bien sûr, son profil inhabituel a valu à Thirlwell quelques mésaventures -il est sans doute le seul « Fellow » de l’hyper prestigieux All Souls College d’Oxford (un statut accordé sur élection à seuls deux undergraduates par an) à avoir, à 25 ans, utilisé la chambre et la conséquente bourse qui lui étaient allouées à des fins de publications universitaires pour l’écriture d’une… fiction. Politique était né (sorti en 2003), et d’une certaine manière, le roman n’en était pas tout à fait un. Histoire d’un couple à trois servie par des personnages prétextes, un second degré caustique et d’incessantes théories hilarantes sur tout et rien, Politique tournait son principal sujet, l’érotisme, en dérision, et révélait Thirlwell de manière fulgurante. Sur le coup, l’universitaire sera remercié d’Oxford (« tout le monde me déteste, là-bas », lâche-t-il d’un regard malicieux), mais il sera élu la même année dans l’influente revue Granta comme l’un des Best of Young British Novelists (au même titre, par exemple, que Zadie Smith).
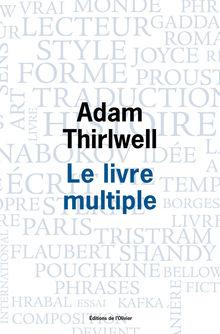
Le trentenaire a largement confirmé depuis: deuxième roman (L’Evasion, en 2009) et participation active à la vie littéraire anglo-saxonne proprement effervescente que l’on sait (articles, revues, collaborations…). Une bibliographie hétéroclite à laquelle Adam rajoute aujourd’hui ce qu’il nomme, frondeur, son « essai romanesque » (paru en 2007, déjà, en anglais). Soit, à la lecture, une sorte d’hybride entre journal de lecteur (les rayonnages de sa bibliothèque sont impressionnants), exercice d’admiration pour ses maîtres (Joyce, Kundera et Nabokov en tête) et livre-enquête fantaisiste sur le roman et sa traduction, largement (dé)cousu d’idées et d’indiscrétions biographiques. Mais si Le Livre multiple (éds. de l’Olivier) est du propre aveu de son auteur « un roman sans intrigue, ni fiction, ni dénouement: une expérience d’autres vies -un roman qui prétend ne pas en être un du tout », il n’en reste pas moins une fois refermé un plaidoyer courageux et vibrant pour une forme internationale du roman. Donc pour une approche décomplexée du « multiple ». Explications.
Votre premier roman Politique a été traduit dans plus de 20 pays: est-ce de ce traumatisme qu’est née l’idée du Livre multiple?
A la publication de Politique, j’ai été embarqué dans une sorte de tournée littéraire mondiale. Et cette expérience de devoir parler de mon livre dans d’autres langues, tout en ne sachant pas vraiment s’il s’agissait exactement du même bouquin, m’a beaucoup marqué. Quand votre livre est en cours de traduction, vous recevez plein de courrier de vos traducteurs, et vous êtes amené à réaliser les problèmes que certains passages peuvent poser dans d’autres langues -le pire restant quand même de ne pas recevoir de courrier du tout, parce qu’à ce moment-là, vous vous angoissez en vous disant: « Ma traductrice suédoise avait tant de questions, pourquoi le Hongrois semble ne pas s’en poser du tout? » (rires). J’avais beau intellectuellement militer pour une vision internationale du roman, j’étais dans le même temps vraiment angoissé à l’idée qu’un traducteur puisse ne pas comprendre mon livre, et plus généralement, par cette question: un roman dans une autre langue reste-t-il le même livre? C’est pour résoudre cette sorte d’obsession grandissante que j’ai commencé la rédaction du Livre multiple.
Voir son livre traduit, c’est accepter une forme de dépossession?
C’est une forme de violence très particulière. La traduction est une attaque à la vanité philosophique et artistique d’un romancier: en tant qu’écrivain, on aime penser que ce qu’on fait est unique, et si linguistiquement particulier qu’il est impossible de le transporter dans une autre langue. Mais ce n’est pas le cas. Dès qu’on publie un livre, en fait, ce n’est déjà plus le nôtre, parce que chaque lecture qui en est faite est déjà une forme de dépossession. La traduction, c’est le même problème, encore magnifié.
Dans sa version anglaise de 2007, Le Livre multiple s’intitulait Miss Herbert. Qui est-elle?
Juliet Herbert était anglaise, elle était la gouvernante de la nièce de Flaubert, et elle a vécu un temps avec lui et sa mère à Croisset. Juliet a quitté Croisset juste après la parution de Madame Bovary, puis Flaubert s’est rendu à Londres plusieurs fois pour la voir. On sait qu’elle lui a appris l’anglais, mais on n’en sait pas beaucoup plus. Je pense en fait qu’ils ont eu une histoire d’amour. Plusieurs sources indirectes indiquent qu’ils auraient fait ensemble une traduction de Madame Bovary. Mais le manuscrit s’est perdu -c’est aussi le cas de l’ensemble de leur correspondance, qui a disparu. Le plus probable est que Juliet a tout brûlé, horrifiée à l’idée que quelqu’un tombe sur des preuves de cette liaison à sa mort. Peut-être le manuscrit de cette version anglaise de Madame Bovary n’a-t-il jamais existé, mais pour moi il est devenu une sorte de symbole mélancolique d’un idéal perdu: j’aime penser qu’il existe une traduction parfaite de chaque oeuvre quelque part…
En 2009, Dave Eggers vous a proposé d’être l’éditeur invité d’un numéro de sa revue McSweeney’s, une édition devenue collector dans laquelle vous avez monté une super entreprise de traduction. Vous pouvez nous en parler?
L’idée, c’était de tester les idées que j’avais développées théoriquement dans mon livre. Je pensais qu’il serait intéressant de choisir un récit et d’établir une chaîne de traductions à partir de lui, c’est-à-dire traduire le texte de sa langue d’origine vers le français, le hongrois, l’allemand ou le japonais, tout en repassant entre-temps par l’anglais pour voir à chaque étape si quelque chose subsistait du récit original -quelque chose comme son âme, ou son « style vrai ». Pour ce faire, j’ai choisi non pas des traducteurs professionnels, mais des romanciers qui feraient ça en amateurs (au départ de textes de Kafka, Kharms et Kenji Miyazawa, les traductions seront signées Lydia Davis, David Mitchell, Zadie Smith, John Banville, Javier Marías, Gary Shteyngart ou Jeffrey Eugenides, ndlr). A l’arrivée, il a bien fallu constater que la plupart des transpositions étaient parvenues à garder la substantifique moelle du texte premier. D’où ma conviction, aujourd’hui, qu’une traduction n’a pas besoin de partir de l’original-original, mais qu’elle peut très bien être faite à partir d’une autre traduction. Car ce qui est en jeu dans la fabrication du multiple n’est pas la fidélité, mais la recréation.
Comment définiriez-vous la notion de « multiple »?
Il faut en revenir aux visions de Duchamp et Warhol, de leur conviction qu’une oeuvre d’art peut être reproduite autant de fois qu’on le désire. Duchamp invente l’objet d’art comme ready-made: un objet produit en masse, qui n’a besoin que de la signature de l’artiste. Andy Warhol produit ses images en séries dans la Factory. Dans les deux cas, il ne s’agit pas de choisir entre les 100 copies: chacune est en propre l’oeuvre d’art. En ce qui concerne le roman, il n’est jamais donné au lecteur de voir le manuscrit original du romancier, l’oeuvre d’art ne peut être « consommée » que dupliquée: ce qu’on lit, c’est donc déjà un multiple. Et la traduction est selon moi une autre forme de multiple, c’est-à-dire un même roman dans une autre langue. La traduction crée un deuxième original. Mais deuxième ne veut pas dire moins bon… D’ailleurs, je suis opposé à cette idée d’une hiérarchie entre auteur et traducteur. On publie bien l’intégrale d’un écrivain, pourquoi ne pourrait-on pas éditer les oeuvres complètes d’un traducteur?
Vous rappelez d’ailleurs que Borges défendait l’idée qu’une traduction peut surpasser l’original…
Evidemment, c’est possible. Prenez Edgar Allan Poe, traduit par Baudelaire. Pour moi, en anglais, Poe, c’est un poète de rien, presque risible, avec des rythmes absolument terribles, des rimes enfantines et des idées clichés. Alors que je peux voir que Baudelaire -et Mallarmé, dans une moindre mesure- en a fait un poète romantique, diabolique et très intéressant. Souvent il ne s’agit que de détails, de petits changements. Prenez The Imp of the Perverse: pour moi, « imp » (« lutin, diablotin », ndlr) désigne quelque chose de féérique, qui relève du conte de fées. Alors que Baudelaire le traduit par « démon »: Le Démon de la perversité. D’un seul coup, c’est terrifiant… et ça charrie toute une théologie. Je dis toujours qu’Edgar Allan Poe n’existe pas vraiment: il est une invention de Baudelaire (sourire).
Existe-t-il des romans intraduisibles?
Pour moi, aucun roman n’est intraduisible. Prenez Finnegans Wake de James Joyce: une oeuvre a priori absolument intraduisible, parce que Joyce ne l’écrit presque pas en anglais à la base, mais dans une langue expérimentale, folle, inventée. Eh bien, sa traduction française, entre autres par le surréaliste Philippe Soupault, sur une esquisse de Beckett, est incroyable. Bien sûr, elle a été supervisée par Joyce lui-même, qui modifiait certaines choses en cours de route à cet effet. Mais pour moi, si même Finnegans Wake a pu être traduit, c’est bien que la valeur esthétique de n’importe quel roman peut être transportée. Il n’y a pas de raison de penser qu’une expérience ne puisse pas exister dans toutes les langues. Et un style peut-être à la fois unique et reproductible à l’infini, parce qu’un style est un dispositif à créer des expériences. La traduction idéale doit donc chercher à reproduire dans une autre langue l’expérience que le roman mène dans ses mots d’origine. Après, le hasard joue un grand rôle, et la question est de savoir si une oeuvre finira ou pas par trouver son traducteur…
