Après Just Kids ou M Train, l’idole Patti Smith revient avec Dévotion, un conte noir et glacé sur la possession en même temps qu’un essai très personnel sur l’inspiration. De quoi rappeler que la chanteuse, performeuse et photographe a toujours -et peut-être avant tout- écrit. Entretien.
C’est bien connu: les écrivains sont des êtres inquiets qui protègent jalousement les conditions de leur art, c’est pourquoi il est rare de les voir aborder la question de l’écriture sans prétention ni tabous. Dans Dévotion et à 71 ans, Patti Smith, parcours iconique de reine punk et physique baudelairien, plonge dans le mythe romantique de l’inspiration pour le désacraliser avec humilité. Celle qui dans l’imaginaire collectif est d’abord musicienne y expose, fac-similés de pages manuscrites et photos noir et blanc à l’appui, comment elle a, pour paraphraser Raymond Roussel, « écrit certains de ses livres« : la façon dont une image (le visage de Simone Weil jeune), un mouvement (ce tournoi de patinage artistique entraperçu à la télévision) ou un climat (la mélancolie dans les livres de Modiano) peuvent, en s’entrechoquant soudain sans logique, la mettre au travail dans la construction d’une histoire. Aussi, le livre est-il hybride: s’ouvrant sur son journal (Smith est alors à Paris, en pleine crise d’inspiration), il fait dans un deuxième temps place à la nouvelle, intitulée Dévotion, qu’elle se représentera écrire comme dans un état second. Soit l’histoire, sombre et faustienne, d’Eugenia, jeune prodige du patin à glace, qu’un riche marchand d’art va séduire et pervertir en la révélant à ses désirs (au prix de son âme?). De quoi montrer, presque en temps réel, comment finissent par s’ordonnancer dans la fiction (mais déplacés ailleurs, ou altérés comme sous les effets déformants d’un rêve) des motifs accumulés dans la matière de la vie réelle. Patti Smith: idole, poétesse, alchimiste.
Dévotion est un texte de commande. Quelles en ont été les circonstances?
Il y a quelque temps, j’ai reçu un prix à Yale. Une partie du prix consistait à produire un long essai sur l’écriture qui serait publié aux Yale University Press dans une collection intitulée « Why I Write ». Ce prix, c’était un honneur, et Yale est une université prestigieuse, alors j’ai dit: « Ok, je vais le faire. » Mais aussitôt après j’ai pensé: « Comment vais-je pouvoir faire? Je ne suis pas essayiste. Et tant de gens brillants ont déjà écrit sur l’écriture. » Et puis, j’ai repensé à ce petit livre de Marguerite Duras, qui s’appelle Ecrire. Ce livre a une structure qui lui est propre; Duras n’essaie pas réellement d’y analyser quoi que ce soit: elle écrit, simplement. C’est un livre que j’avais adoré, et j’ai pensé que j’allais essayer de l’utiliser comme un exemple.
Jusqu’ici, vos livres étaient autobiographiques. Dévotion est -au moins en partie- un texte d’invention, avec des personnages imaginaires. Comment avez-vous vécu ce passage à la fiction « pure »?
En fait, c’est le contraire qui s’est produit: la fiction est ce que j’ai toujours écrit. Dans les années 80, je vivais à l’écart du monde, au calme, avec mon mari, à élever mes enfants et j’écrivais des romans et des histoires chaque jour. Ça a duré pendant des années. Mais je n’ai jamais rien publié de ce que j’ai écrit à cette période: j’écrivais de manière privée. Et puis juste avant de mourir (en 1989, NDLR), Robert Mapplethorpe m’a demandé d’écrire notre histoire. Et je n’étais pas… Je n’avais jamais écrit de non fiction, je n’avais aucun background, et cela m’a pris longtemps pour comprendre comment écrire ce livre (Just Kids sera finalement publié en 2010 et recevra le National Book Award dans la foulée, NDLR). Cela impliquait tant de responsabilités: il fallait être précis et exact sur l’époque et sur New York, fidèle à la nature de notre relation avec Robert, et à tous ces gens qui passent dans le livre. Ça a représenté une véritable masse de travail. Il faut croire que quelque chose en moi s’est habitué à écrire à la première personne après ça.

Vous montrez qu’écrire cette petite fiction à l’intérieur du livre s’est révélé être une sorte d’accident, un geste imprévu. Où placez-vous la part de destin dans le processus littéraire?
Je pense que l’écriture, c’est une part de compétences, une part de destin, une part d’imagination et une part de travail. Le destin nous apporte certaines circonstances ou une certaine atmosphère qui nous inspirent. Notre imagination les laisse couler. Et nos compétences nous autorisent à travailler sur ces choses. En ce qui me concerne, j’ai une imagination très fluide, et assez débordante. Mais je suis très mauvaise en grammaire. Je n’ai pas eu de formation complète à l’école et il y a des choses dans lesquelles je ne suis toujours pas bonne aujourd’hui, comme les mathématiques ou les échecs. La grammaire en fait partie. Donc je dois vraiment travailler. Une fois que j’ai tout écrit, je dois encore m’assurer que je suis bien en train de dire ce que je voulais dire. Cela fait partie du processus pour moi. Je peux vous dire que je travaille très dur sur tous mes livres.
Jusqu’à un certain point, vos personnages semblent être l’un à l’autre une inspiration -pour créer ou bien se nuire. Quels rôles ambivalents peut jouer une muse?
Une muse est par définition ambivalente parce qu’elle vous inspire à travailler, mais elle peut aussi exercer un pouvoir cruel. Regardez Gérard de Nerval: il a donné non seulement son imagination et ses écrits mais aussi son coeur à cette actrice qui était sa muse, et elle a fini par le briser. Je dirais qu’il y a une communication d’ordre abstrait entre un artiste et sa muse. Mon mari (Fred « Sonic » Smith, guitariste avec qui elle aura un fils et une fille, NDLR) a été ma muse. C’est pour lui que j’ai écrit les chansons Frederick, Dancing Barefoot, Because the Night, 25th Floor et plein d’autres. Avant cela, je n’avais pas de muse particulière: mon album Horses est un miroir de ce qui arrivait dans ma vie et dans le monde à ce moment-là, par exemple (long silence). Et puis j’ai été suffisamment chanceuse pour être moi-même une muse. Robert Mapplethorpe avait l’habitude de dire que j’étais sa muse. J’ai été son premier modèle.
Votre héroïne parle énormément de langues différentes. Quand vous regardez en arrière, voyez-vous votre vie divisée entre ces différents langages que sont la musique, le dessin, la photographie et l’écriture?
Je ne l’ai jamais envisagé comme ça, parce que je me suis toujours vue incapable de parler aucune langue excepté l’anglais. Je suis mauvaise en langues. Très. Mais vous me faites penser à l’instant que les disciplines dont je dispose sont nombreuses. Et j’imagine que les voilà, mes langages. Si je dois les diviser, mentalement je ferai plutôt la partition entre mes langages publics, et ceux qui me sont donnés dans la solitude. Dès qu’il s’agit de donner des concerts, ou même de composer des chansons, c’est presque toujours collaboratif: j’écris ou je monte sur scène avec d’autres musiciens, et des techniciens. Et il y a une responsabilité à ce moment-là: il s’agit d’être présente, concernée par le bien-être de tout le monde, et d’un public qui peut aller de 300 à 75.000 personnes. Dans ce monde-là, tout ce que vous faites, vous le faites pour quelqu’un d’autre. Alors que quand je prends des photos, ou que je dessine, je ne me préoccupe de rien. Et bien sûr, je n’ai besoin de personne pour m’aider à écrire: vous savez, j’ai écrit durant toutes les années 80 des milliers de pages que personne n’a jamais vues. Cela ne me dérangeait pas que personne ne les voie. Je ne me suis jamais senti incomprise, ni rien. Je pensais juste: « Je suis en train d’écrire, d’évoluer, d’apprendre et de m’exprimer. » Au final, je suis plutôt chanceuse: tout se passe comme si j’étais une artiste bipolaire. J’ai ces deux axes intenses: celui qui implique une responsabilité et dépend d’une énergie collaborative, et celui qui tire tout son parti de la solitude.
Vous écrivez que jeune, la question morale intervenait peu voire pas dans votre création. Vous vous rappelez à quel moment ça a changé?
Quand j’étais jeune, j’avais une amie proche qui était photographe, j’avais quelque chose comme 19 ans, et devant son objectif je prenais certaines poses, et je m’en foutais bien de le faire en ayant retiré mes sous-vêtements. Et quand j’ai fait l’album Horses; ces paroles « Jesus died for somebody’s sins but not mine » ont causé de grandes fureurs, les gens m’ont écrit des lettres, des menaces de mort, ils me disaient que je serais foudroyée par les éclairs de Dieu. Je posais des gestes qui faisaient polémique, mais je n’en avais rien à faire. Et puis quand j’ai eu mes enfants, j’ai commencé à voir les choses à travers leurs yeux, et à penser un peu plus au fait que ce que je disais ou faisais avait des conséquences et pourrait les affecter. Je ne voulais pas qu’ils soient victimes de ma négligence ou de ma désinvolture.
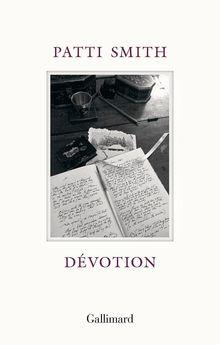
Pour autant, pensez-vous au lecteur quand vous écrivez?
Quand j’écrivais Just Kids, il m’arrivait de m’inquiéter de la manière dont il pourrait avoir une mauvaise influence sur les jeunes qui le liraient. Cette idée traversait bien mon esprit parfois, mais j’essayais de ne pas y prêter attention: parfois, vous devez juste faire votre travail. Je vous dirais que pour moi, le sentiment de responsabilité n’entre pas en ligne de compte dans l’écriture. Si j’étais vraiment responsable, jamais je n’aurais écrit Dévotion, d’ailleurs. C’est une autre raison pour laquelle cette petite histoire m’a choquée. Est-ce moi qui l’ai vraiment écrite? Vous savez, je vis seule: je n’ai pas de compagnon, je vis une vie vraiment monastique et j’ai pensé: « Il y a beaucoup de sexe dans mon histoire, d’où est-ce que cela peut bien venir? » (rires). Honnêtement, je ne sais pas! Je pourrais tenir le rythme du train dans lequel je l’ai écrite en partie responsable… Mais il s’agit d’une histoire, et vous devez avoir la garantie d’un certain degré de liberté pour l’écrire. Pensez à Nabokov quand il a écrit Lolita. Quand j’écris, je ne m’inquiète pas du lecteur et je ne me censure pas. C’est très différent dans la musique, parce que dès le départ vous écrivez une chanson pour les gens.
Vous écrivez: « J’éprouve des vagues de nostalgie y compris dans un présent parfait. » Comment définiriez-vous votre rapport à la nostalgie?
Quand j’écris cela, je suis à Saint-Germain-des-Prés, en train de me balader. Tout est parfait: la lumière, la qualité de l’air. Je suis dans le présent, je me sens en harmonie avec ce qui est. Mais dans le même temps, la perfection du présent m’amène à goûter au sentiment de ce voyage fait avec ma soeur à Paris dans les années 60. Je ne sens pas la nostalgie quand je suis malheureuse. C’est quand tout est beau autour de vous et dans les étoiles, que cela vous ramène en arrière, à la sensation d’un temps révolu, mais que vous pouvez presque expérimenter à nouveau: tout à coup, une certaine odeur dans l’air vous rappelle… Le parfum des lilas me fait me souvenir de ces moments où mon mari et moi étions jeunes, où il était vivant, et ces soirées romantiques où nous nous mettions à danser au beau milieu de la rue sous les lilas en fleurs, et où nous ne regardions même pas s’il y avait des voitures… La nostalgie est un sentiment agréable. Il a partie liée avec une certaine dose de mélancolie et de tristesse bien sûr, mais c’est aussi un sentiment magnifique. Dans la nostalgie, vous vous souvenez des belles choses.
Le propos de Dévotion pourrait être une illustration de cette citation d’Albert Camus: « Il y a un temps pour vivre, et un temps pour témoigner de vivre« …
Je ne connaissais pas cette phrase de lui, et c’est merveilleux: d’une certaine manière, oui, c’est une illustration parfaite de ce que je raconte dans Dévotion. C’est amusant, parce que dans le livre, j’explique que je suis allée visiter sa maison de Lourmarin, et que j’ai eu accès au manuscrit original de Le Premier Homme (resté inachevé à la mort de Camus en 1960, NDLR). Vous ne pouvez pas vous imaginer combien c’était merveilleux: la plus belle des opportunités! J’aurais pu me contenter de regarder, savourer, parler à sa fille Catherine calmement et seulement être heureuse. Mais je devais me dépêcher de finir parce que mon esprit voulait que je me précipite pour décrire cette expérience sur le papier. Vous savez, j’aurais juste pu vivre une vie -une vie heureuse ou peut-être une vie difficile, qui sait- passée à laver les draps, cuisiner, m’occuper des enfants et être une bonne compagne pour mon mari, mais je n’ai jamais pu faire seulement cela: j’avais besoin de cet autre temps qui est celui de l’écriture. Quand je viens à Paris, je pense souvent: « Est-ce que je ne pourrais pas tout simplement être une bonne touriste, en profiter pour tout regarder? » Mais au lieu de ça, je finis toujours par m’asseoir dans un café, et écrire sur le fait d’être à Paris au lieu d’être véritablement à Paris. C’est de la folie, d’une certaine manière… Mais cette citation d’Albert le montre: en tant qu’écrivain, nous ne pouvons pas seulement vivre. S’il m’entendait en ce moment, il dirait: « Oh, je comprends. J’ai déjà dit une chose de ce genre quelque part. » (rires)
Dévotion de Patti Smith, éditions Gallimard, traduit de l’anglais (USA) par Nicolas Richard, 160 pages.
