Un an après Né d’aucune femme, Franck Bouysse revient avec un ensorcelant Buveurs de vent transcendé par une plume trempée dans de la lave en fusion où l’auteur imagine la légende du Gour Noir, au coeur du Massif central.
Ce neuvième roman de l’auteur de Grossir le ciel et de Glaise est un tour de force littéraire tant Buveurs de vent (1) voit Franck Bouysse se muer en alchimiste des mots et sculpter et malaxer la langue le temps de cette légende quasi mythologique, aux accents universels, se déroulant au coeur du Massif central de l’après-Seconde Guerre mondiale. Marc, Matthieu, Mabel et Luc forment une fratrie soudée comme jamais face à un père à la main lourde et une mère refusant de voir les tourments familiaux qui rongent un équilibre somme toute précaire. Dans la vallée du Gour Noir, les habitants triment sang et eau pour Joyce, le propriétaire mégalo et dictatorial de la centrale électrique et du barrage. Au fil des pages jalonnées d’une tension sourde, Franck Bouysse signe un (grand) roman rageur et incandescent autour de l’insoumission.
Tout passe par l’éducation. J’ai été enseignant assez longtemps pour savoir combien c’est important.
Comment est né Buveurs de vent?
Je suis à la pêche avec Théo, mon plus jeune fils, et je me retrouve face à ce viaduc (NDLR: le viaduc ferroviaire du Gour Noir, en Corrèze), ce monument de mon enfance, où mon père m’emmenait quand j’avais 7 ou 8 ans, un des rares moments où je me retrouvais seul avec lui. Lorsque je suis rentré avec Théo à la maison, j’ai écrit: « Quatre ils étaient. » J’avais vu ces quatre gamins suspendus au viaduc avec le train qui passe et je sentais les vibrations dans ma tête. Comme une sorte d’émotion sortie de l’enfance.
Comment verbaliser cette frénésie qui s’empare de vous?
Je sais que j’ai enflammé une mèche et j’espère avoir assez de poudre pour aller jusqu’au bout de l’histoire parce que je ne la connais pas.
Qu’est-ce qui fait que vous êtes aussi poreux, quasi sans filtre, capable d’ « écouter » d’autres voix?
Ça demande une espèce d’absence du réel. J’essaie d’être concentré sur ce qui se déploie, face à un paysage qui prend forme. D’abord les gamins et le viaduc ; ensuite, c’est la centrale électrique, le barrage, la ville, la vallée, la rivière. Je ne suis pas disponible pour le réel mais bien pour cette vérité qui est en train de s’écrire. Une vérité aux accents mythologiques parce qu’il y a un peu d’ Odyssée et beaucoup d’ Iliade.
Vous venez de citer Homère ; certes, mais Buveurs de vent possède aussi une dimension très shakespearienne… Inévitable lorsque l’on écrit une tragédie?
J’ai retenu de Shakespeare l’idée de ne pas avoir de lieux précis. On s’en fout de parler des droits du Danemark ou d’Athènes (NDLR: l’auteur fait référence à Hamlet et à Timon d’Athènes). Ce qui est important, c’est l’humanité, les sentiments, les émotions. Au lecteur de se débrouiller avec ce petit point d’ancrage, ce timbre-poste, pour arriver à quelque chose d’universel. En revanche, le nom des lieux et des personnages sont très importants. L’histoire se déroule au Gour Noir, un nom qui fait peur. Et les personnages aussi. Martin, c’est biblique. Joyce, Snake, ces noms s’imposent.
Le nom de Joyce fait directement référence à l’écrivain irlandais. L’auteur des Dubliners est-il un phare au même titre que Faulkner?
James Joyce compte pour moi, rien que pour les cent dernières pages du Monologue de Molly Bloom. Je pense qu’il faut lire Joyce mais je concède que cette triple narration est déstabilisante. Faulkner et Homère, c’est du génie pur. L’instinct est tellement fort que ça conduit à tous les excès. Détruire la chronologie ou inventer une forme de narration. Parler à la place de. Les bourgeois et les aristocrates faisaient parler le petit peuple avec un langage de bourgeois, ils essayaient de se mettre à la place. Chez Faulkner, c’est le personnage qui parle. Il lui rétrocède la parole.

Parmi les quatre enfants, il y a Marc, qui se réfugie dans les livres. A quel âge la littérature a-t-elle fait une entrée fracassante dans votre vie?
La littérature débarque dans ma vie vers 14 ans, à l’âge de Marc. Chez mes parents, il y avait bien une bibliothèque avec le plus haut rayonnage auquel nous avions l’interdiction de toucher, ma soeur et moi. C’était Balzac. Pendant les vacances, ma mère lisait des sagas comme Les Eygletière de Henri Troyat. Mon père, je ne l’ai jamais vu lire. Ça ne l’intéressait pas. Mes premiers livres, c’est via ma grand-mère qui, quand j’étais malade, m’a offert L’Ile au trésor, Les Enfants du capitaine Grant, Moby Dick, L’Iliade et L’Odyssée ou L’Enéide de Virgile. Ce sont, à des degrés divers, des livres fondateurs.
Votre réponse est une clé pour « décrypter » les fondations littéraires sur lesquelles s’appuie Buveurs de vent. Vous y pensez?
Tout part de ces livres-là. C’est tellement l’affaire de ma vie, la littérature parce que j’y découvre une atmosphère amicale qui veut du bien au garçon intro- verti que je suis dans monde étriqué face un père assez dur. Avec le peu de sous que je gagne, je vais dans les librairies parce que je veux les posséder, ces livres. Et je lis parfois Bob Morane ou Tintin mais aussi Mallarmé, Maupassant, Shakespeare, T.S. Elliot ou Alexandre Dumas.
Vous évoquez peu votre enfance, alors que c’est souvent là que naissent vos romans. Comment la décririez-vous? Heureuse malgré l’absence de sentiments démonstratifs propre à la génération de vos parents?
J’étais docile et quand je faisais une connerie, ça tombait. Mon père, c’était une force de la nature ; ça ne rigolait pas. Ma mère est une pure Corrézienne. Rien ne transparaît chez elle. Le premier compliment qu’elle m’a fait après Grossir le ciel, c’est: « Tu n’as pas intérêt à te louper pour le prochain. »
Vous faisiez allusion à votre grand-mère. Quel est son rôle dans votre monde « étriqué »?
J’ai un grand-père que je n’ai pas connu et l’autre, le pauvre, est revenu de la Seconde Guerre mondiale bien amoché. En revanche, j’avais deux grands-mères extraordinaires. Ma grand-mère maternelle a été veuve à 30 ans. Ma mère n’a pas connu son père. Avec une ferme sur le dos, un gamin de 11 ans et une gamine de 1 an dans un monde d’hommes, je l’ai toujours vue avec le sourire et pourtant elle en a bavé. Comme quoi tout est lié parce que quand mon oncle a repris la ferme, j’ai commencé à lui amener des livres, à Mémé Marie. Le même monde qui s’était ouvert à moi à 14 ans s’est ouvert à elle à 70 ans. Lorsqu’elle est devenue aveugle, j’allais lui chercher des livres audio. C’étaient des cassettes à l’époque et elle m’attendait comme le Messie avec mon sac de cassettes. Je lui ramenais beaucoup de romans du terroir et, de temps en temps, je faisais un petit pas de côté et ça marchait parfois.
Aujourd’hui, une opinion n’est plus le fruit d’une réflexion mais bien d’une émotion.
Et votre grand-mère paternelle?
Si mon père était comme il était, ça vient de sa mère qui avait une étonnante force de caractère. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a hébergé dans son moulin un déserteur allemand, une espèce d’artiste qui est devenu l’ami de tous les gens du village.
Quel est l’impact de cette histoire magnifique sur votre conscience politique? La résilience qui transparaît chez vos personnages féminins, toujours très forts et ancrés?
Peut-être par le fait que je me retrouve de plus en plus en porte-à-faux avec ce monde d’apparences dans lequel on vit aujourd’hui. On voit ce que l’on a envie de voir. Il n’y a plus de place pour la réflexion. Aujourd’hui, ce serait juste un Allemand. Qu’il soit déserteur ou pas. La grande différence, c’est qu’à l’heure actuelle, une opinion n’est plus le fruit d’une réflexion mais bien d’une émotion. On réagit tout de suite, sans prendre du recul. Mon lieu de réflexion est là-dedans. D’ailleurs, je défie quiconque de savoir mon opinion politique, même si on peut en deviner certaines couleurs dans mes livres.
Qu’est-ce que Buveurs de vent nous dit sur le monde d’aujourd’hui?
Ce n’était pas un projet conscient de ma part mais il se trouve qu’il est encore plus ancré dans l’actualité que les autres. J’ai besoin de beaucoup réfléchir, de laisser mûrir les choses et cette révolte décrite dans le roman s’impose d’elle-même. Je ne ménage personne et je pense à cette phrase de Nietzsche qui dit que « les victimes se transforment en bourreaux ». N’empêche, il y a des combats légitimes, des choses inadmissibles. Joyce recrute sa garde rapprochée parmi les gens du petit peuple. C’est un peu l’histoire de la petite frappe de banlieue qui brûle des bagnoles, devient dealer, se paie une BMW et ne comprend pas, qu’un jour, on va lui brûler sa voiture. On ne retient pas. C’est l’amnésie permanente. Finalement, je pense être assez pessimiste. Je suis persuadé que l’avenir, s’il y en a un, ne s’écrira pas avec nous mais avec les gamins. Tout passe par l’éducation. J’ai été enseignant assez longtemps pour savoir combien c’est important. La grande carence, c’est l’éducation. Eduquer, par exemple, à ne pas balancer les masques sur les trottoirs ou les mégots par la fenêtre de la voiture. Ça me rend dingue.
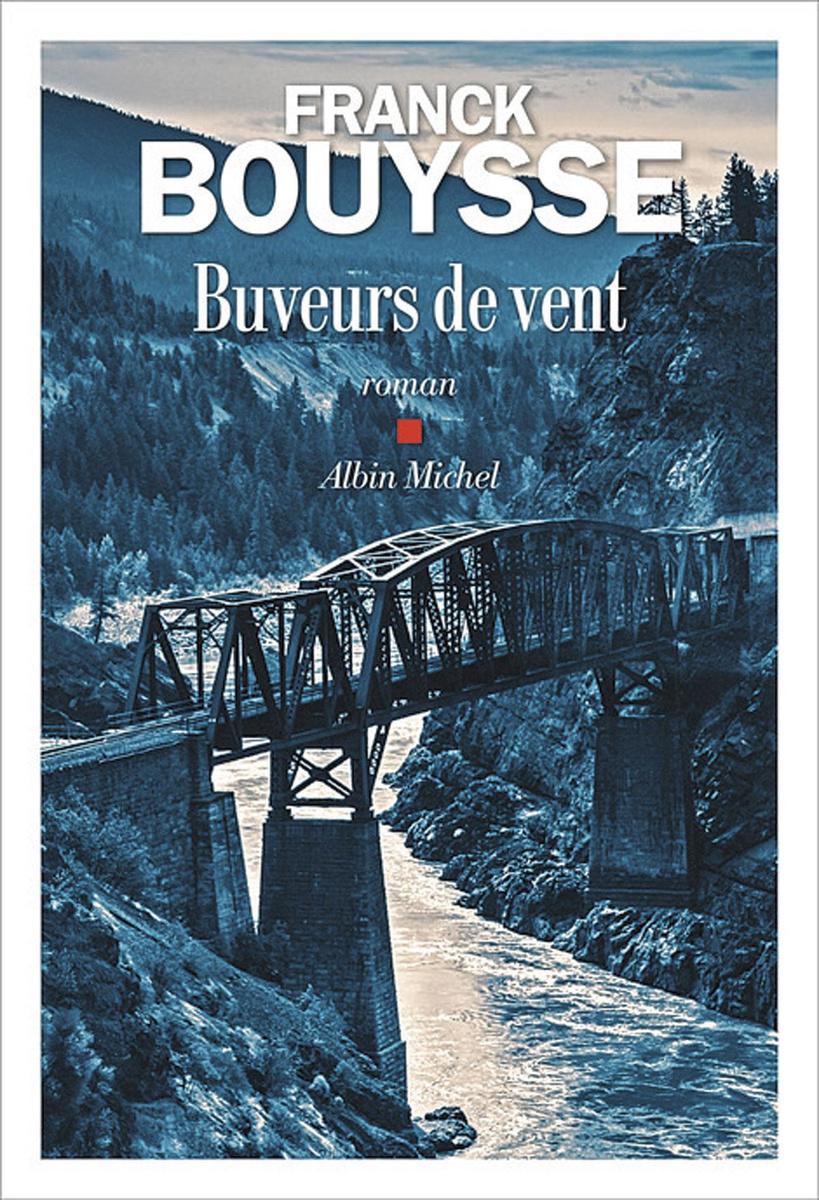
D’où vient cette tension sourde, cette violence souterraine parsemée de secousses sismiques, qui habite votre écriture?
Cette tension que j’ai en moi, que je continue d’avoir et qui se retrouve aussi dans l’écriture, dans la phrase, dans le tendu de la phrase, dans sa chair, vient du terreau. Des choses qui ne sont pas réglées, qui sont tues parce que vous êtes une éponge, vous observez, engrangez, vous ne vous sentez pas en droit de réagir, vous n’avez pas la légitimité de le faire…
