Peut-on encore faire de l’autofiction en 2016? À l’heure de la rentrée littéraire, rencontre croisée avec deux jeunes romanciers, Emmanuelle Richard et Édouard Louis, qui font l’histoire d’une passion amoureuse, tout en questionnant la légitimité de l’écriture de soi.
Que faire des conséquences d’une passion amoureuse aliénante et dévastatrice quand on est un écrivain? Comment oser s’emparer d’un motif aussi usé? Sous quelles nouvelles formes identifier écriture et vérité autobiographique? Et comment départager impudeur et littérature? Parmi les 476 romans de la rentrée littéraire de janvier, les livres d’Emmanuelle Richard, 30 ans, et Edouard Louis, 23 ans, affrontent un peu les mêmes enjeux. Il y a deux ans, leurs premiers romans déjà, La Légèreté pour elle (éd. de l’Olivier), et En finir avec Eddy Bellegueule pour lui (éd. du Seuil), citaient conjointement l’écriture de soi d’Annie Ernaux et la sociologie de Pierre Bourdieu, creusant les questions liées à la découverte, à l’adolescence, de la sexualité et des origines sociales -des hontes que l’on peut en nourrir. Tandis que la première faisait une entrée sensible sur la scène littéraire, le deuxième connaissait l’inattendu raz-de-marée critique et public que l’on sait (100 000 exemplaires vendus). Deux ans plus tard, les jeunes adultes ont grandi, et reviennent l’un et l’autre -hasard de l’édition- avec un second livre dans une nouvelle coïncidence chronologique -et thématique. Dans les deux cas, même si très différemment, il s’agit d’une expérience de la passion vécue, puis racontée, à la première personne du singulier, prolongeant le pacte de lecture amorcé à l’heure de leurs premiers romans: faire de certains épisodes de leur vie la matière vivante de leur écriture. Roman personnel? Ecriture de soi? Autofabulation? Autonarration? Apparu en 1977 sous la plume de l’écrivain Serge Doubrovsky, le terme « autofiction » a l’avantage d’être à peu près tout cela à la fois -indécidable genre littéraire qui aurait autant à faire avec l’authenticité qu’avec la fiction, avec le caractère brut d’une existence qu’avec sa nécessaire scénarisation, et la recherche formelle poursuivie à travers elle. Et si accusée, à son pire, de nombrilisme, d’indécence ou de gratuité, l’autofiction était aussi le courant le plus plastique de la littérature? Aussi multiforme que les histoires individuelles qu’elle prend pour objet. Se livrer -c’est-à-dire faire, de soi, un livre-: pourquoi?, comment? L’autofiction nouvelle génération, de l’intime au monde social.
Emmanuelle Richard, Pour la peau

« Je ne vis jamais les choses dans le but de les écrire. Mais que je sois sur un livre ou pas, je suis toujours un peu malgré moi en train d’essayer de capter une sorte de sous-texte dans tout ce qui se joue. J’ai la sensation d’être à un poste d’observation permanente. En l’occurrence, quand je vivais cette histoire d’amour-là, avec cet homme-là, j’avais la perspective très nette, même si je ne prenais pas de notes, qu’elle avait une portée éminemment littéraire. Je ne savais pas comment ça allait se finir, même s’il était probable que cela se finirait mal, mais je percevais déjà cet homme comme un motif littéraire possible… Je ne trouve pas ça confortable du tout, de mettre son coeur sur la table. J’aimerais pouvoir faire autre chose, être capable de produire du grand roman américain. User d’un imaginaire merveilleux, foisonnant. Mais il se trouve que je ne sais faire que ça: non pas inventer, mais recomposer -tenter de m’approcher d’une certaine vérité du réel. Ma propre vie est mon seul et unique matériau. » Longiligne « i » saisi dans la circulation du boulevard Montparnasse, en face de la lourde porte de son éditeur parisien, Emmanuelle Richard, regard franc et doigts nerveux, publie son deuxième livre à 30 ans. Il y a tout juste deux ans, cette diplômée en lettres enchaînant les petits boulots (elle tient aujourd’hui la caisse dans un cinéma) faisait sa toute première rentrée littéraire avec La Légèreté, teenage novel rêche et sensible sur le malaise d’une ado face à son corps et à son désir, sorte de Pauline à la plage à la fois sociologique et intime. « J’ai découvert Annie Ernaux à l’adolescence. Sa lecture a tout dé-figé. J’ai eu envie de dire les choses aussi librement qu’elle. Annie Ernaux a libéré tout un pan du discours sur le féminin. C’est beaucoup moins dangereux pour moi aujourd’hui, beaucoup moins courageux de parler de ces questions de sexualité et de désir. »
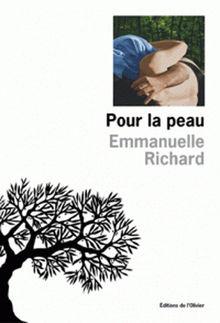
Dans Pour la peau, Emmanuelle Richard expose scène par scène, et sans filtre, le récit du désir aliénant d’une jeune femme pour « E. », quarantenaire écorché rencontré en province, sans que l’identité de cette héroïne ne fasse le moindre doute (usant du « je », « Emma » est au même moment en train de publier son premier roman à Paris…). Crudité physique et émotionnelle, exposition et prise de risque: Pour la peau donne dans l’intime. « La réception, je n’y pense pas, explique la jeune romancière. Pas au moment où j’écris. Mais là, à la veille de la sortie du livre, je suis quand même encombrée de parler d’un texte aussi intime… (grand silence). La question n’est pas que mon livre parle de sexualité. Ce n’est pas ça, pour moi, l’intime. Ce qui est intime, c’est de décider de livrer ce qui s’est joué dans une relation amoureuse entre deux personnes, dans un souci d’hyperréalisme et du moindre détail. Mais je me dis que si je ressens ça, c’est peut-être que j’ai précisément atteint le noyau noir, le coeur des choses, d’une certaine façon… C’est un truc que je ne voulais sans doute pas m’avouer en écrivant, mais ce livre, c’est une lettre d’amour que j’adresse à cet absent. Pour essayer de le faire revenir. C’est pour ça que j’écris: pour renverser le cours des choses de ma propre vie. »
Transformer un homme aimé en personnage, faire décoller la littérature de la réalité: lancée à la base « dans l’urgence et la nécessité« , sans vision littéraire, la mécanique a pourtant peu à peu commencé à bouger -et une certaine forme de fiction à perfuser. « Maintenant que j’ai du recul, je ne peux que constater que j’ai écrit la passion amoureuse d’une jeune femme pour un homme, et qu’on ne sait à aucun moment ce que lui pense. Même s’il n’y a pas une ligne qui soit inventée, c’est ma propre subjectivité qui parle entièrement: la manière dont j’ai ressenti les choses -les détails sur lesquels mon regard s’est posé. Dès qu’on ouvre la bouche, on fictionnalise. On tente de se raconter une histoire qu’on a vécue. On essaie de trouver la vérité, mais il n’y a pas de vérité. » Hypersubjectivité et découpage du temps millimétré (le roman choisit d’entrer et sortir de la passion en 223 pages), mais aussi reproduction de textos, paroles de chansons, listes d’adjectifs: la fictionnalisation, cette lectrice d’Eric Reinhardt et Bret Easton Ellis (« pour moi, Lunar Park, c’est un des plus grands livres. Un sommet d’autofiction« ) l’a surtout filée par la forme. Devenu projet littéraire -dresser le portrait fragmenté d’un homme par tous les biais possibles, de manière de plus en plus zoomée et concentrique-, Pour la peau tire un parti sensible du motif éculé, mais toujours recommencé, de la passion. « J’ai tenté d’épuiser mon propre sentiment. Tenté de sauver ce qui s’était passé, et le transformer en chose littéraire pour me résoudre à sa disparition. De transmuer un truc dévastateur en quelque chose de concret, et positif. Même si on vit des choses douloureuses, être quand même celle qui reste avec l’histoire quand ça s’arrête. C’est une pensée que je trouve assez réconfortante. »
Edouard Louis, Histoire de la violence

« L’autofiction a traditionnellement beaucoup à voir avec la souffrance. Moi je m’intéresse davantage à la violence, qui est un paradigme, moins autocentré, de la souffrance. C’est pourquoi il y a un fossé presque chronologique entre ce que j’essaie de faire et l’autofiction telle qu’elle a été produite jusqu’ici, parce que ce qui m’intéresse, c’est ce qui vient avant la souffrance. » Quand on lui parle « autofiction » dans le café du 11e arrondissement où il a ses habitudes, Edouard Louis, allure de sage étudiant en lettres, regard fort et nez de boxeur, s’applique immédiatement à marquer une distance. Dans Histoire de la violence, son deuxième roman très attendu, il revient pourtant, dans le détail et en son nom propre, sur un épisode traumatique de sa vie. La nuit du 24 au 25 décembre 2012, Louis rencontre un garçon dans la rue. Le désir est immédiat: ils passent la nuit ensemble, et Reda en vient naturellement à lui confier des pans intimes de son histoire -circonstances de l’arrivée de son père algérien en France et violence du racisme. Mais au petit matin, après qu’Edouard le prend en flagrant délit du vol de son iPad, Reda devient comme fou, essaie de tuer son amant, l’étrangle, le viole. Et disparaît. « La violence s’était rappelée dans ma chair: comment aurais-je pu dès lors écrire sur autre chose? J’ai naturellement commencé à m’atteler à un roman sur l’expérience de cette nuit particulière. »
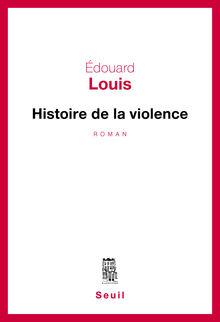
La violence, Edouard Louis en faisait déjà la matière de son premier roman autobiographique coup de poing, En finir avec Eddy Bellegueule -violence de l’intolérance et des origines, puisqu’il y exposait sans jamais l’atténuer le milieu -le nord de la France populo et homophobe- et la classe sociale -dominée- desquels il avait fini par s’extraire pour sa propre survie. Une pure opération d’autofiction dans et hors le livre: c’est à travers ce premier roman qu’Eddy Bellegueule (son vrai nom) se réinventait pour devenir Edouard Louis l’écrivain, au fil de l’ascension sociale qui en ferait un transfuge de classes selon la terminologie bourdieusienne. Cette conception de la littérature comme premier outil, Edouard Louis l’a logiquement ranimée à l’heure de son deuxième roman, où il est à nouveau question de creuser devant témoins un vécu intime. « Quand j’écris, je n’ai aucun sentiment de pudeur. Ou plus précisément, c’est l’impudeur qui m’anime. La pudeur consiste à créer un partage entre le dicible et l’indicible, entre le public et le privé, et moi je ne ressens pas cette distinction. Parce que ces choses que je dis et qui peuvent paraître très impudiques et très privées sont en fait des expériences communes, partagées. » C’est qu’à 23 ans, le diplômé en sociologie et désormais directeur de collection (Des mots, aux PUF) défend une littérature engagée, tenue par une obsession personnelle, mais aussi nécessairement politique: « Ce que je veux montrer dans ce roman, c’est que chacun des gestes infimes que nous avons posés cette nuit-là, Reda et moi, aussi intimes et personnels soient-ils, étaient reliés et connectés au monde social. Quand je rencontre Reda, je ne suis monté à Paris que depuis un an, et je me sens encore pris dans tout un tas de complexes sociaux. En réaction, je me mets à jouer un rôle, à surjouer le bourgeois pour cacher d’où je viens. J’arbore une lavallière, ou un costume trois-pièces pour aller à la boulangerie. Et concernant Reda, il se trouve que plus je suis attiré par lui, plus je me donne une allure de privilégié, parce que je ne sais pas ce qui m’arrive, je crois que ça va le séduire. Et j’exerce une violence sur lui -ce qui le blesse probablement au plus profond de lui-même. Dans ce sentiment provoqué par le monde social qui fait qu’on a honte de qui l’on est et d’où l’on vient. »
La réinjection du social dans le privé, mais aussi un procédé stylistique singulier: dans Histoire de la violence, Edouard Louis réinvente le mécanisme de la confession chère à l’autofiction en confiant la narration d’une histoire qui lui appartient à une succession de tiers: sa propre soeur (un monologue écrit dans une langue populaire -celle de son enfance- rare en littérature), mais aussi, plus largement, le corps médical et la police. Parler à travers des témoins qui sont censés parler pour soi: Louis explore le procédé cacophonique qui transmue toute histoire privée en fait divers. « On est tous constamment pris dans le récit que les autres font de nous, la manière dont ils racontent nos vies. Pendant tout le livre, je suis constamment dépossédé de cette histoire qui est la mienne. J’ai écrit Histoire de la violence pour répondre à cette volonté: c’est la littérature comme vengeance, comme tentative de réappropriation. Je me débats pour avoir une parole au milieu de tous ces discours qui m’enserrent. » Faire entendre sa voix, afin de reprendre place au sein de sa propre histoire: comme chez Emmanuelle Richard, le dispositif a beaucoup à voir avec la puissance cathartique -indéniable, presque pléonastique- de l’autofiction. « J’ai voulu trouver une manière de parler de ce qui m’était arrivé pour faire que cette histoire ne devienne pas le centre de ma vie. Faire Histoire de la violence, ça a aussi signifié pour moi chercher à défaire cette violence. » Faire et défaire: une nouvelle définition de l’autofiction. Jusqu’à la prochaine fois.
POUR LA PEAU, D’EMMANUELLE RICHARD, ÉDITIONS DE L’OLIVIER, 224 PAGES.
HISTOIRE DE LA VIOLENCE, D’ÉDOUARD LOUIS, ÉDITIONS DU SEUIL, 229 PAGES.
