Journaliste, Christophe Boltanski entre en littérature avec La Cache, un premier roman qui raconte les Boltanski, ou l’époque identitaire, en temps de guerre, d’une famille hautement romanesque. Rencontre.
Boltanski. Sur la couverture bleue nuit, le nom ne passe forcément pas inaperçu. Christian, plasticien vedette? Luc, ex-disciple de Bourdieu, sociologue pragmatique? Jean-Elie, auteur d’ouvrages de linguistique? Non, il s’agira cette fois de Christophe, grand reporter pour Libération puis l’Obs. Issu, comme les précités, de ce qu’il faut bien appeler une famille géniale, le journaliste se fait écrivain à travers un premier roman qui revient précisément sur les origines d’un patronyme: La Cache (lire critique ci-dessous). Le livre, très réussi, raconte la destinée d’une famille de migrants devenus français -de leurs petites légendes ordinaires à la grande mystification qu’ils imagineront pour sauver le grand-père juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand il évoque les siens, devenus ses personnages, Christophe Boltanski, yeux malicieux et voix d’une grande douceur, use du « ils » ou du « nous » -bien plus rarement de noms. Pas étonnant, pour une histoire où il est question de multiples falsifications identitaires et de la réinvention d’un clan: un véritable appel d’air pour la fiction.
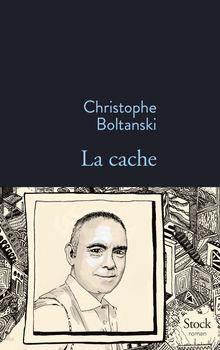
Votre roman vous ramène dans la maison familiale -celle où vous avez vécu avec vos grands-parents. Quel rapport entretenez-vous avec ces lieux?
C’est le lieu qui compte le plus pour moi, j’y reviens tout le temps. Les seuls souvenirs qu’on ait dans la famille y sont tous rattachés. Il n’y a jamais eu aucune patrimonialisation chez nous: on était bourgeois, mais on vivait dans une sorte de précarité permanente qui voulait qu’on jette les chose au fur et à mesure. Mes grands-parents avaient contemplé la possibilité de leur propre destruction, et ils ne voulaient pas que les objets leur survivent. Aujourd’hui, les photos ont disparu, il ne reste pas de lettres, pas même de tombes -je ne sais pas où sont enterrés mes grands-parents. Mais il reste cette maison: c’est notre album de souvenirs. Et notre sépulcre. Ecrire a donc consisté pour moi à retourner visiter ces lieux pas à pas, à physiquement re-rentrer à l’intérieur des pièces, chacune d’elles étant comme une boîte à souvenirs: c’est de cette manière que j’ai agencé les chapitres du livre.
Cette histoire familiale faite de trous, de vides, appelait forcément la forme romanesque?
C’est le propre des migrants que de se réinventer, de réécrire leur propre histoire à l’aide de mythes. En l’occurrence, j’ai enquêté, et je me suis rendu compte que l’identité de mes grands-parents, de mon arrière-grand-mère, n’avait été qu’une suite de faux: des sobriquets, des surnoms, des identités falsifiées. Une vraie poupée russe. Ils ont toujours refusé les assignations identitaires, les déterminismes, parce que tous les étiquetages peuvent être dangereux -surtout à certains moments de l’Histoire. C’est la raison pour laquelle mon récit n’est pas un récit linéaire: il y a énormément de silences, de vides. Ma démarche n’était absolument pas celle d’une biographie classique, il y a des choses que je n’ai pas voulu savoir. Par exemple, comme ma grand-mère refusait absolument de dire son âge, je n’ai pas cherché à obtenir son extrait de naissance. Aujourd’hui je ne sais toujours pas quel âge elle avait quand elle est morte. J’ai voulu respecter cette pudeur-là. De toute façon, quelle importance?
Vous avez vécu coupés du monde. A tel point que, comme Christian Boltanski l’a dit à plusieurs reprises, vous auriez tous pu terminer à l’hôpital psychiatrique. Comment expliquer que vous soyez parvenus à en tirer une telle créativité individuellement?
Dès lors que mes grands-parents se sont retirés du monde, ils ont voulu en recréer un qui leur soit propre -il y a eu une démarche de création complète, au sens fort. C’était une démarche utopique. Mon père et mes oncles ont été retirés de l’école: ils n’ont pas été soumis à cette pression sociale très forte de l’école à la française, à la censure, aux carcans. La Rue-de-Grenelle était un lieu très libre: on n’y était pas jugé, et chacun de nous a pu développer des choses, hors du regard des autres. Alors est-ce que l’enfermement favorise la créativité, est-ce que l’imaginaire se développe plus facilement quand il n’est pas confronté au réel? Je n’ai pas de réponse, mais c’est une question que je pose dans le livre.
Vous êtes très présent dans les univers artistiques ou les écrits des uns et des autres. Comment ce roman a-t-il été reçu par les vôtres?
Je ne suis pas le premier à briser le tabou: ma grand-mère a écrit des romans en partie autobiographiques, mon père Luc des poèmes qui mobilisent des souvenirs personnels, et puis il y a tout le travail de Christian Boltanski, qui a complètement puisé dans notre histoire en cherchant à mêler le vrai et le faux. Les seules photos familiales que je connais sont par exemple dans ses oeuvres: il les a mêlées à d’autres clichés, anonymes, empruntés à n’importe qui. Enfant, je jouais avec lui au grenier, dans son atelier qui était déjà une installation en soi: il n’y avait pas de rupture entre mes jeux et son travail artistique -c’était un continuum, ça faisait partie de la vie de cette maison. Ce n’est qu’après que j’avais la surprise de voir ces objets qui m’étaient tellement familiers derrière des vitrines, dans des musées… Décidant d’écrire sur mes proches, ma démarche leur était donc familière. Je crois qu’ils ont pris le livre comme un roman -un roman vrai, mais où il s’agit de ma vérité, pas forcément de la leur. Ils m’ont reconnu cette liberté-là.
Dépliant les plans de la maison où il a grandi, Christophe Boltanski questionne les notions d’héritage et d’identité au sein d’une famille géniale et névrosée.

Curieusement, la visite de la maison commence par la voiture. Une Fiat 500 Lusso de couleur blanche qui « constitue la première pièce de la Rue-de-Grenelle, son prolongement, son sas, sa partie mobile, sa chambre hors les murs, ses yeux, son globe oculaire. » Entassés à cinq ou plus dans une petite automobile: quand les Boltanski quittent leur antre, c’est exclusivement motorisés (à tel point que Christophe Boltanski confie n’avoir jamais vu ses grands-parents marcher ordinairement dans la rue). L’une des névroses ordinaires d’un clan qui n’en manque pas: grand reporter à Libération puis à l’Obs, Christophe Boltanski est issu d’une famille qui semble née pour la fiction. Un clan notoire: chez les Boltanski, on connaissait déjà Christian (artiste contemporain), Jean-Elie (linguiste), Luc (sociologue) ou Anne Franski (photographe). Christophe est le fils de Luc; il décide, dans ce qui est son premier roman, de faire le récit de ses singulières armoiries, et en premier lieu le portrait de ses grands-parents, chez qui il a vécu -Eugène, médecin chef de service des hôpitaux de Paris, et Myriam, grand-mère infirme (victime de la polio peu de temps après la naissance de son premier enfant). Il est le fils d’émigrés ukrainiens d’Odessa ayant fui, à la toute fin du XIXe siècle, la maladie et les pogroms, elle est issue d’une famille de bourgeois désargentés qui l’ont fait adopter par une étrange marraine: ils s’aimeront et établiront leur propre descendance Rue-de-Grenelle à Paris. L’endroit, quelques pièces -du grenier à la voiture, donc-, est un nid curieux, genre de château ambulant et « bric-à-brac identitaire » à l’image des êtres excentriques et paradoxaux qui l’habitent: bourgeois clochardisés, intellectuels déscolarisés, propriétaires terriens encartés au parti communiste, Juifs convertis au catholicisme… Un microcosme joyeusement foutraque et autarcique où l’on fait corps contre les menaces du monde extérieur -réelles ou fantasmées.
Voyage autour de ma chambre
Son arbre généalogique étant ce qu’il est (nébuleux, fabuliste), Boltanski a pris le parti d’une arborescence plus solide pour déplier son roman-conte. Reproduisant en entrée de chaque chapitre le plan de la maison, le néo-romancier ajoute les niveaux et les pièces au fur et à mesure qu’il les ré-explore, jusqu’à atteindre le point aveugle de l’histoire familiale: la cache, cavité d’un mètre 20 de hauteur dans laquelle son grand-père, juif d’origine, se terra secrètement (y compris aux yeux de ses propres enfants) durant 20 mois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une structure romanesque ludique, qui cite tout à la fois le plateau de jeu du Cluedo et la carte de L’Ile au trésor de Stevenson. Métaphore continue d’un livre claustrophile, la vision de la maison comme corps (les escaliers pour les jambes, le bureau pour le cerveau…) permet ailleurs à Boltanski de métaboliser un héritage singulier. Manière, pour ce descendant « en mal de cohérence » de venir questionner les notions d’identité et d’héritage. Manière aussi, par le romanesque, de remettre de l’ordre dans une histoire de disparition (on pense à Georges Perec, forcément) autant que d’ancrage, et dans laquelle l’anticonformisme fut avant tout une question de vie ou de mort. Car comme le dit une rescapée au romancier Daniel Mendelsohn dans Les Disparus, citée dans La Cache: « Si vous n’aviez pas une histoire étonnante, vous n’auriez pas survécu. »
DE CHRISTOPHE BOLTANSKI, ÉDITIONS STOCK, 344 PAGES. ****
