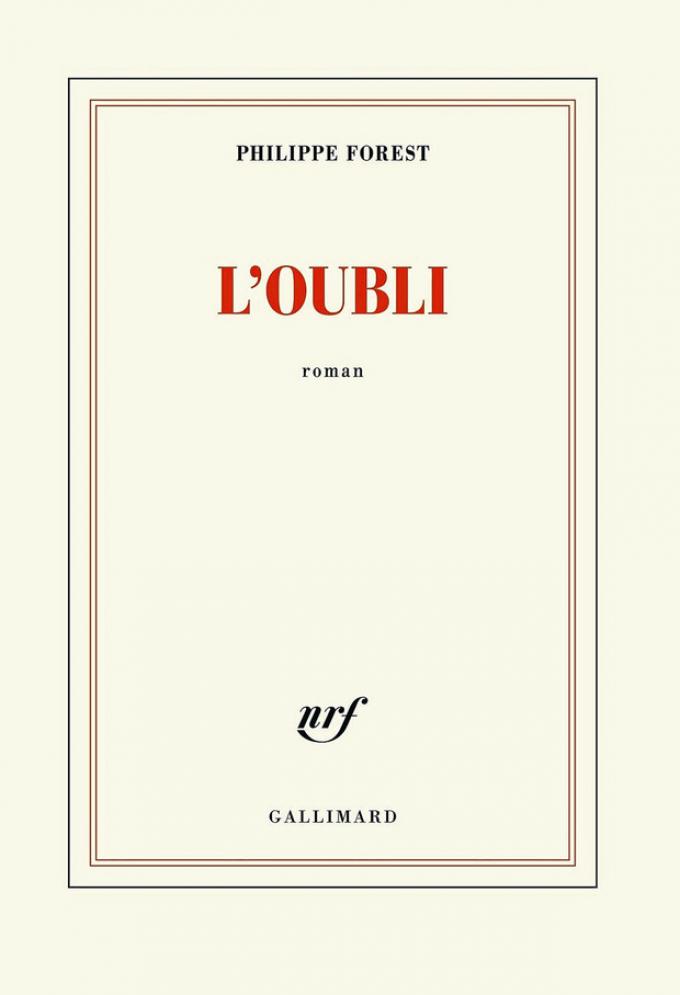
L’Oubli
Un homme se réveille, convaincu d’avoir égaré un mot dans son sommeil. Il est incapable de se le rappeler, et son langage se défait, les souvenirs se détachent de lui. Sur une île, observant l’océan depuis sa fenêtre, peut-être le même, peut-être un autre, s’imagine distinguer une forme qui l’appelle. « De ma vie, je n’ai jamais cherché d’histoires. Elles sont simplement venues à moi les unes après les autres. » Philippe Forest est un écrivain éminemment intelligent qui sait emmener son lecteur sur la pente diaphane de l’impalpable. Où les phrases sont des dunes, où le vent passe son peigne, souffle dans l’air nu qui vibre. Dans ses livres hantés par la disparition ( Le Chat de Schrödinger, Crue), tout change mais les fantômes demeurent. Ici, le roman se dédouble pour dire « Toute la part immense du perdu: tellement de gens, tellement de choses en allés! Cela fait beaucoup, déjà. » Plongé dans le bain révélateur du langage, le monde brille par son absence, dont subsiste un écho: « (…) Des suppliques, des prières, les dialogues de la conversation que l’on se fait à soi-même, les répliques que vous retourne un interlocuteur imaginaire, on s’imagine pourtant reconnaître une histoire familière (…). » À la première personne du très singulier, le « Je » ne cherche pas à tirer la couverture à soi, les mots se retrouvent, prennent langue, se liguent, vibrent à l’unisson. En territoire ami, certains se hasardent à sortir pour donner forme aux images du profond de la nuit. On y fait son lit, entre en résistance contre la perte du souvenir. « Le langage des hommes dépérissait. À vue d’oeil. Tout le monde en convenait. Munis d’une petite poignée de mots, ils vivaient. » Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.
De Philippe Forest, Gallimard, 240 pages.
8
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici