
Série ville et livres (1/7): New York, dust to dust
« Si vous lancez une pierre d’un des toits de New York, vous avez une chance sur 2 que le projectile atteigne la tête d’un écrivain. » Derrière le célèbre bon mot de Rick Moody, romancier de son état, se cache l’évidence: la Ville qui ne dort jamais a toujours été celle qui torturait le plus d’auteurs au mètre carré, avides de signer -impossible quête- son portrait ultime. Dans la nuée, Jay McInerney. L’homme de toutes les sauteries new-yorkaises eighties, l’oiseau de nuit mythique complice de Bret Easton Ellis. De l’avoir côtoyée de si près, il est aujourd’hui l’un de ceux qui a su rendre les battements vitaux d’une ville à travers la destinée d’une de ses sociétés particulières -la haute. C’est pourtant loin de New York, dans une retraite bucolique, que McInerney raconte avoir composé, à 15 ans d’intervalle, les quelque 1000 pages de son célèbre diptyque, constitué de Trente ans et des poussières et de La Belle Vie. A croire qu’on ne capte jamais aussi justement une ville qu’à bonne distance de son smog et que, à l’autre bout de la longue-vue, on n’embrasse jamais autant d’humanité qu’en étreignant des destinées individuelles.
Dès 1992, McInerney entame en l’occurrence le suivi passionnant de celles de Corrine Calloway, courtière en bourse, et de son mari Russel, éditeur de littérature. Trentenaires et des poussières, ils sont « les fiancés de l’Amérique » à qui le monde appartient, le couple le plus en vue et envié de Manhattan cuvée 1987. Dans leur sillage, un certain nombre de personnages, écrivains, financiers, golden boys tentent de recueillir quelque retombée de la somptueuse lumière qui les nimbe. Interdépendants, emplis de d’autant plus de prétentions qu’ils rejettent violemment leurs racines provinciales, tous croient au pouvoir de métamorphose de New York, du Dow Jones et de la littérature.
Accordant son itinéraire à leurs existences étourdissantes, le roman les suit, entre superficialités des choix et profondes détresses du désir, de la Cinquième avenue aux allées du Whitney Museum, des Bains russes de la 10e au romantique Gramercy Park, de la distribution d’une soupe populaire dans le glauque Bowery (Corrine s’y donne bonne conscience) aux pince-fesses de la New York Review (Russel y aiguise sa réputation). « Quelle ville merveilleuse si l’on avait possédé 3 corps distincts. L’un pour travailler comme un perdu, pour s’en sortir, le second pour déjeuner au Café des Artistes, assister aux ventes chez Sotheby, aux expositions du Met et aux lectures poétiques du YMCA. Le troisième pour s’éveiller tard dans l’après-midi et sortir jusqu’à l’aube. » L’omnipotente et nourricière Big Apple leur donne le change, faisant miroiter dans les vitres de ses gratte-ciels le remplissage du grand vide des existences: « Russel s’était installé à NY, croyant pénétrer au centre du monde, (…) il y avait toujours une porte derrière laquelle de nouveaux mystères étaient accessibles, une salle de bal en haut du firmament d’où s’échappait l’irrésistible musique, une source secrète d’où émanait la folle énergie de la métropole. »
McInerney, grand maître de cérémonie, excelle à faire regarder acteurs et décor dans la même direction -anthropomorphisant la ville, urbanisant les protagonistes. Dès la moitié du roman, et suivant une lente décompression qui s’étirera jusqu’à son dernier souffle, l’ensemble s’assombrit. Une baleine vient s’échouer sur le rivage au beau milieu d’un cocktail mondain. L’art se monnaie de plus en plus ostensiblement. Les marchés soudain s’effondrent -le krach d’octobre 1987-, les courtiers sautent de leurs temples financiers en perdition, les tensions sexuelles basculent dans l’indomptable, des êtres chers s’enfoncent dans les drogues dures. La cité de tous les possibles, qui s’est prise au piège de sa propre chute, reprend ce qu’elle avait donné. On ne mord pas New York impunément. Les dernières lignes du livre, conclusion sublime de noirceur, suffisent à s’en convaincre, entre sensations de perte diffuses et vagues promesses d’obscurcissement futur.
A la parution du livre, McInerney semble lui même au fond, qui s’abîme dans une sévère descente aux enfers, entre crise de la quarantaine, divorces successifs et production en perte de puissance. Jusqu’à ce que New York se rappelle violemment à lui, à 10 ans de là, le matin du 11 septembre. Vivant avec effroi la matérialisation inimaginable d’une liquidation qu’il avait su si bien prédire, il s’attelle alors à La Belle Vie, nouveau projet d’écriture qui lui permettra d’accuser le choc. Le roman se fait alors diptyque, Jay retrouvant là ses anciennes amours: Russel et Corrine, mariés 2 enfants, dans un New York de 2001 méconnaissable, au visage déformé, plus que jamais gentrifié, peuplé de 4×4 aux vitres fumées, d’indifférence sournoise et de toujours plus fastueux dîners de gala.
Entre chien et loup
Passant sur des images par trop diffusées par ailleurs, McInerney choisit d’étudier l’impact du double effondrement sur le skyline pulvérisé des existences, évoquant si justement Pompéi et ses habitants, « silhouettes figées dans leurs postures d’agapes et de festivités ». Corrine s’engage comme volontaire sur le site de Ground Zero, Russel affronte la disparition de son meilleur ami, leur couple se délitant de plus en plus irrévocablement. Il y a encore cette scène, magnifiquement contemplative, dans laquelle Luke, autre personnage phare de ce second tome, vient éclairer la tonalité de l’ensemble romanesque, étudiant de sa fenêtre, au lendemain de l’attentat, « la sénescence de la lumière diurne, qui semblait presque gluante, prête à coaguler, s’efforçant d’enregistrer ce moment parfait de transition entre le jour et le soir, cet instant où la lumière, en mourant, était au plus proche de son essence ». Et il semble que toute l’écriture de McInerney elle-même n’a cessé de capturer ces instants entre chien et loup, guettant les êtres au moment de leur basculement. Comme en réponse au destin d’une mégapole qui, passant sans transition de l’éclat au désenchantement, se trouve sans mémoire collective. Truman Capote disait de New York qu’elle évoquait « un mythe différent pour chacun de nous ». Celui de McInerney semble nous faire revivre inlassablement ce terrible passage de la ville aux mille lumières à la nécropole des passions. De la belle vie à la poussière.
Ysaline Parisis
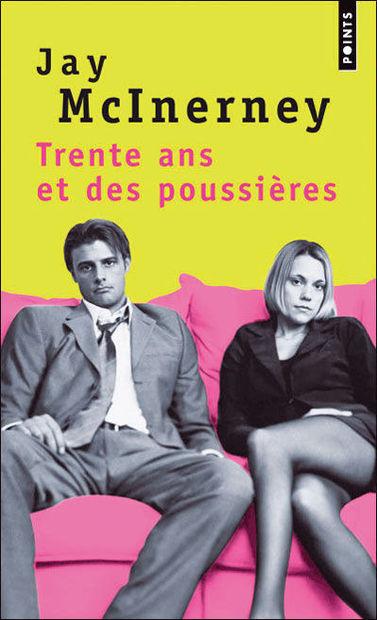
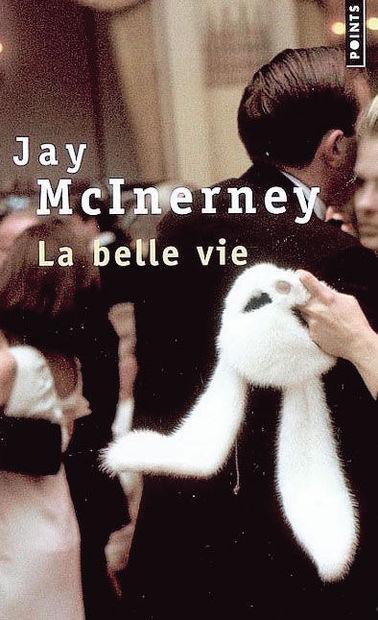
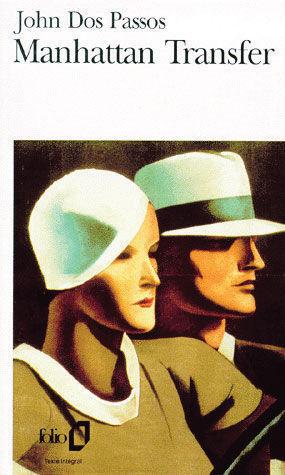
Manhattan transfer de John Dos Passos, éditions Folio.
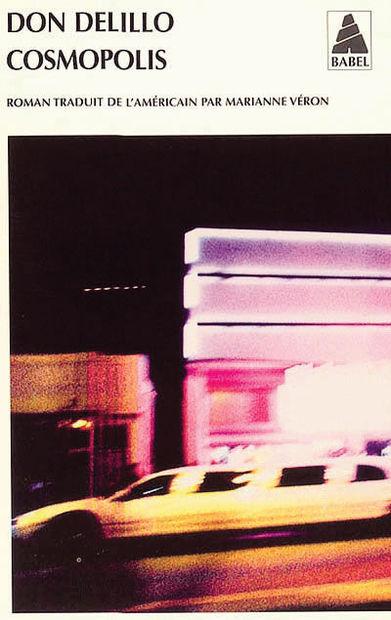
Cosmopolis de Don Delillo, éditions Babel.
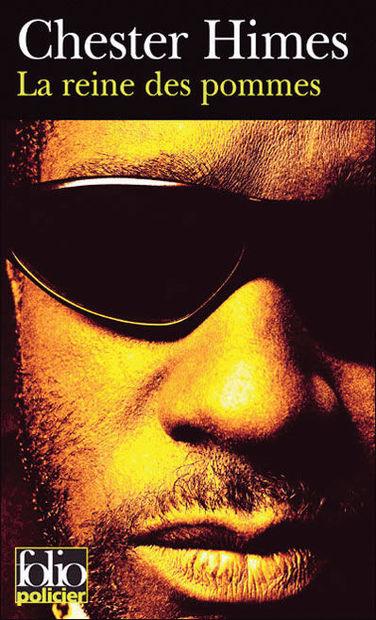
La reine des pommes de Chester Himes, éditions Folio policier.
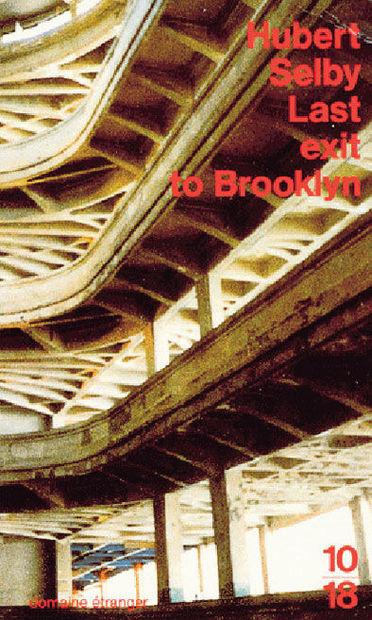
Last exit to Brooklyn de Hubert Selby Jr., éditions 10/18.
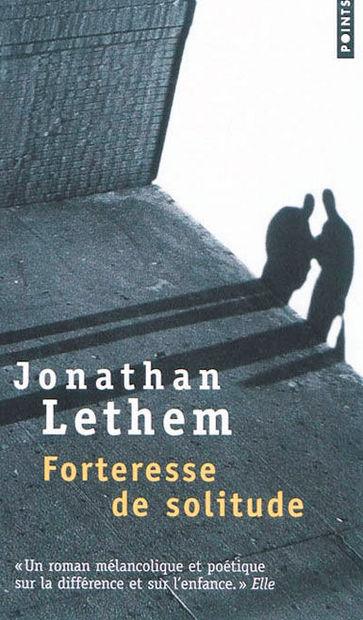
Forteresse de solitude de Jonathan Lethem, éditions points.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici