
Colum McCann, à cor et à écrits
Dans Lettres à un jeune auteur, le grand romancier conseille les futurs plumitifs. Mais lui, comment écrit-il? Conversation.
L’Irlandais de New York vient de sortir Lettres à un jeune auteur, un recueil de conseils aux aspirants écrivains. Il fait donc la tournée des grands-ducs à Paris, journalistes aux trousses et foulard- ficelle autour du cou. Quand on lui avoue avoir eu le coeur brisé à cause de ses Saisons de la nuit et de ses Treize Façons de voir, il répond: « Oh merci, ça me fait tellement plaisir. » Sourire ravi à l’appui. Assis dans le canapé d’un hôtel chic de Saint-Germain-des-Prés, Colum McCann s’exprime avec fougue malgré le décalage horaire qui lui déboîte le crâne. Plaisir de s’offrir, joie de recevoir.
Au fond, Lettres à un jeune auteur est plus une exhortation à écrire qu’un simple guide…
Exactement. Tant de gens habités par l’envie d’écrire hésitent, tétanisés par la peur de l’échec. J’explique que la capacité d’échouer est une bonne chose, qu’il faut sauter de la falaise encore et encore parce qu’on apprend à développer des ailes dans la chute. Il faut se forcer et persévérer. Se jeter dans ce qui semble le plus dur, aller à contre-courant, porter la contradiction, combattre le monde. Et lire, lire, lire.
Quels auteurs lisez-vous?
Il y en a tant! Edna O’Brien, James Joyce, Michael Ondaatje, Don DeLillo, Jim Harrison…
Jim Harrison était devenu votre ami. Comment vous êtes-vous rapprochés?
J’avais raté une lecture qu’il avait donnée à New York, un été, en 1993. J’étais fou de frustration parce que j’adore Harrison. En apprenant qu’il était toujours en ville, j’ai dégoté l’hôtel où il était, je l’ai appelé et il m’a donné rendez-vous au bar. On a papoté et bu. Beaucoup. Après, je lui ai envoyé mes livres, on s’est écrit et je suis allé le voir chez lui à plusieurs reprises. On parlait de littérature, de poésie, surtout. C’était un homme extraordinaire.
A quel moment avez-vous compris que vous vouliez devenir écrivain?
A l’âge de 9 ans. Nous sommes allés à Londres voir mon grand-père dans sa maison de retraite. Il m’a parlé de sa vie, de son combat au sein de l’IRA, de ses batailles pendant la guerre civile et la guerre d’Espagne. De retour à Dublin, à l’école, notre instituteur nous a demandé de rédiger une histoire sur la personne qui comptait le plus pour nous. J’ai raconté celle de mon grand-père. Je me souviens de l’émotion ressentie en l’écrivant. C’est vraiment là que j’ai su que j’en ferais mon métier. Mais j’ai attendu d’avoir 21 ans pour me lancer, je suis parti aux Etats-Unis.
Pourquoi les Etats-Unis?
C’était mythique, j’avais lu Kerouac, Ginsberg, Burroughs, je voulais moi aussi faire partie de la Beat generation. Là-bas, j’ai acheté une machine à écrire, des rames de papier et au bout de quatre mois à suer sur le clavier, j’ai compris que je n’avais rien à dire. Je n’avais rien vécu. Alors j’ai pris un vélo, j’ai sillonné l’Amérique, fait des petits boulots et écouté les gens que je rencontrais. C’est comme ça que j’ai appris à raconter des histoires. En me cognant à la réalité.
Depuis, vous menez de véritables enquêtes pour nourrir vos romans…
C’est une nécessité pour moi. J’ai besoin d’être en prise avec le réel pour enrichir mes fictions. Pour Les Saisons de la nuit, j’ai fréquenté des SDF qui vivaient dans des tunnels en lisière de New York. Ils étaient contents de s’ouvrir à quelqu’un qui les écoutait vraiment. Pour Zoli, je me suis rendu dans un camp de Tsiganes en Slovaquie. Je ne connaissais pas leur langue, mais je les comprenais en regardant leurs visages, en entendant leurs chansons. Ces expériences sont bénéfiques pour l’écriture et pour moi en tant qu’humain.
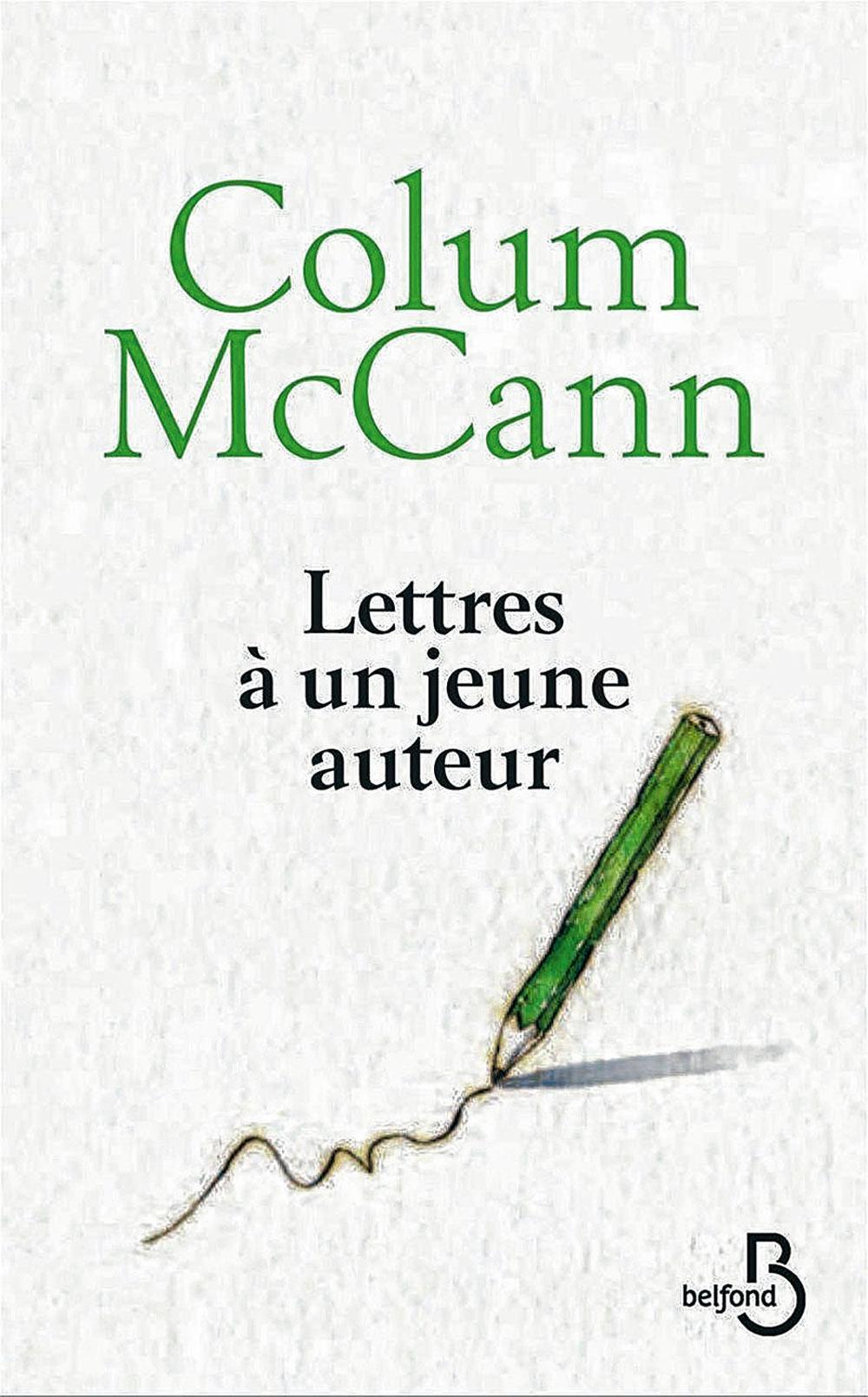
Vous laissent-elles des blessures, parfois?
Les sans-abri m’ont brisé le coeur, ils sont en moi à jamais. L’accouchement des Saisons de la nuit, qui a duré environ quatre ans, a été une douleur de chaque jour. Quand le roman est sorti, la douleur est partie. A force d’en débattre avec les journalistes, j’ai évacué le chagrin. Seuls les souvenirs sont restés.
Vos romans s’appuient sur la noirceur pour aller vers la lumière. Y a-t-il une part de ténèbres en vous?
Oui et je ne sais pas d’où elle me vient. J’ai eu une enfance heureuse, j’ai toujours été entouré d’amour. Mais la noirceur s’est imposée à moi, en moi. Je pense que c’est une question d’empathie. Ce qui se passe autour de moi, lointain ou proche, me touche et m’imprègne. Reconnaître ma noirceur est un acte de lumière, et je pense qu’en m’y frottant je deviens quelqu’un de meilleur. C’est peut-être égoïste ou vaniteux de ma part.
Comment ça, vaniteux?
Parce que je veux être celui qui comprend ce qu’est la noirceur de notre société. Avec mes romans, je voudrais bousculer les préjugés, bouleverser les lecteurs et, ne fût-ce qu’un tout petit peu, changer le monde. En ce moment, j’écris un livre sur Israël et la Palestine, rien de politique, mais très compliqué à mettre en forme. J’ai rencontré des habitants des deux pays, chaque camp étant sûr d’être dans son droit. Moi, ce que je vois, c’est qu’un territoire est occupé, que des civils souffrent et sont tués. Des milliers de gens avant moi ont traité le sujet, qui suis-je pour penser que j’ai quelque chose de plus spécial à en dire? Je suis vain en croyant en être capable, tout en étant conscient que je ne le suis pas, mais je tiens quand même à le faire.
Avec toutes ces contradictions, dans quel état écrivez-vous?
Dans l’angoisse et la terreur. Qui sont d’excellents moteurs pour créer, même si c’est éreintant. Chaque fois que je commence un roman, je suis persuadé que je n’arriverai jamais au bout, que je suis un charlatan et qu’on va le découvrir. Mais je continue. Quand je le termine, je suis rincé et je sais s’il est bon. Je ne veux pas que ce soit facile. Je souhaite qu’on se souvienne de moi comme de quelqu’un de dingue et d’aventureux, qui a pris des risques. Un jour, Jim Harrison m’a dit que j’étais un salopard cinglé, c’est le plus beau compliment qu’on m’ait jamais fait.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici