
Matthew E. White: « Mes deux premiers disques étaient des albums de songwriter. Cette fois, j’ai travaillé comme un producteur »

Matthew E. White se fait plus éclectique que jamais sur un troisième album qui a le sens du groove et fourmille d’idées. Rencontre.
Il a des allures de gros nounours. Un nounours à lunettes. Look de charpentier. Barbe et chevelure christiques. Matthew E. White est fils de missionnaires catholiques. Il est né en Virginie (c’était le 14 août 1982), a vécu aux Philippines et au Japon. Il n’a cessé de courir le monde depuis 2012 et la sortie d’un premier album à l’accueil méritoirement dithyrambique. « J’ai ressenti le syndrome classique de l’imposteur, avoue-t-il. Je ne m’attendais pas à ce que Big Inner rencontre autant de succès. Il s’agissait de mes sept premières chansons. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais et je me retrouvais avec une maison de disques et un contrat d’édition. J’en parlais à des centaines de journalistes. Ils écrivaient dessus dans les magazines. »
Le label Domino ne lui a pas mis la pression mais White est du genre à se poser beaucoup de questions. « Tu te demandes comment occuper cet espace que tout à coup on t’octroie. Je sais aussi comment fonctionnent les médias. Ils t’accordent beaucoup de crédit pour des choses que tu ne mérites pas mais ils vont aussi vite en besogne avec les reproches. Big Inner avait été gonflé par la hype. Il est assez unique en son genre. Ce que je veux dire, c’est que parfois, ce que tu fais de bien résulte juste de la chance ou de concours de circonstances. »
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Depuis une vingtaine d’années, Matthew vit à Richmond. Cette ville universitaire où il a débarqué pour ses études, plantée à 160 bornes au sud de Washington. « Je ne pourrais pas monter un groupe à New York ou à Los Angeles comme celui que j’ai ici. Il n’existe aucun substitut à des relations et une complicité musicale de 20 ans. » White est à Richmond dans son studio. Pas celui où il a enregistré son disque, celui où il a dû déménager à la naissance de son fils. L’album était déjà terminé quand il est né. « Je tenais à utiliser tout l’espace sonore pour mettre à profit ce que je savais faire et ce que j’avais appris. Par le passé, j’avais parfois tendance à me tourner vers la collaboration pour masquer une certaine fainéantise ou remplir des blancs que j’aurais très bien pu combler moi-même. J’ai pris confiance avec les années comme songwriter mais aussi comme chanteur, comme arrangeur, comme producteur. »
Matthew E. White est un entrepreneur. Il a aménagé plusieurs studios, a créé son propre label. « Je n’ai jamais voulu être trop dépendant de l’industrie. Alors, je me suis construit une île. Je sentais, consciemment ou pas, que j’étais un outsider. Il y a à la fois un côté entrepreneurial et cette volonté de ne pas entrer dans l’industrie musicale traditionnelle. À cause d’un esprit contestataire sans doute mais aussi d’une certaine insécurité face au business. Je n’ai pas de problème à prendre des risques financiers pour miser sur moi-même. Ce que fait fondamentalement un entrepreneur. »
Miles Davis, Phil Spector, Brian Wilson…
Riche, fourmillant d’idées, K Bay est un disque lumineux et faste, teinté de soul, de funk, de rock, de folk, de hip-hop. « Il touche à beaucoup de choses mais je me sens à l’aise dans ce genre d’environnement. Quand j’écoute mes deux premiers albums, je rigole un peu de l’étroitesse des références par rapport à ce qui m’intéresse réellement. Pour être totalement moi-même, je devais me montrer plus courageux. Je pense à un morceau comme Let’s Ball: ça peut sembler tout nouveau pour des gens qui me suivent mais pour ceux qui écoutent de la musique avec moi, c’est tout sauf une surprise. » Let’s Ball a été écrit avec Natalie Prass. Un tube groovy et disco très seventies qui donne envie de lever les bras en l’air et de foncer sur la piste de danse… On n’aurait pas pris un autre exemple. White avoue qu’il avait trouvé le hook pour quelqu’un d’autre. « Je l’aimais beaucoup et je voulais le garder pour moi. Donc, j’ai enregistré une démo assez merdique pour qu’il n’en ait pas envie. »
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
L’Américain dit avoir assimilé les leçons de ses idoles: Teo Macero, Phil Spector, Brian Wilson, Miles Davis, Lou Reed, Bob Dylan… « Les gens que j’admire vraiment sont des artistes qui ont travaillé sur un paquet de disques et ont une patte. Je pense à un David Axelrod ou à Charles Stepney, un arrangeur de Chess qui a notamment bossé pour Rotary Connection et l’alors très jeune Minnie Riperton. C’est super ambitieux. Je me retrouve vraiment là-dedans. What’s Going On de Marvin Gaye est probablement mon disque favori. C’est dansant. C’est partout. C’est tentaculaire. »
Le garçon affectionne les albums qui ont de l’ampleur et du souffle. Il aime l’ambition. Les orchestrations flamboyantes, les visions panoramiques et les grandes échelles. « En gros, je me demande ce que je peux sortir de plus grand avec ce que j’ai à ma disposition. Ce que je sais faire, le fric que me file le label et les talents que j’ai autour de moi. Mes deux premiers disques étaient des albums de songwriter. Cette fois, j’ai travaillé comme un producteur. On a rassemblé beaucoup d’amis et créé des environnements dans lesquels ils pouvaient exceller. »
Matthew E. White et sa bande ont enregistré la plupart des chansons deux fois. L’une dans un format pop relativement traditionnel et l’autre dans un esprit jazz, libre, basé sur une suite d’accords, une mélodie, une rythmique, un feeling… « Derrière, j’ai assemblé ce qui me plaisait. J’ai étudié les edits de Teo Macero, l’utilisation du sample dans le hip-hop, cette idée de collage. Et je me suis demandé comment je pouvais mettre tout ça à profit. Certaines improvisations ont fini par devenir Broken Mirror , mon disque avec Lonnie Holley. »
Si K Bay n’a rien d’un concept album (« Il reflète juste celui que je suis« ), Only in America parle de privilèges blancs, de racisme systémique, de brutalité policière. White planche sur cette chanson depuis les événements de Ferguson il y a sept ans. « À Richmond, cette culture et cette histoire esclavagistes sont gravées dans la communauté. Il n’y a pas longtemps, alors que je promenais mon fils en poussette, je me suis engueulé avec des mecs très à droite, qui nettoyaient les monuments et effaçaient les graffitis après des manifs Black Lives Matter…«
Matthew E. White, K Bay, distribué par Domino/V2. ****
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
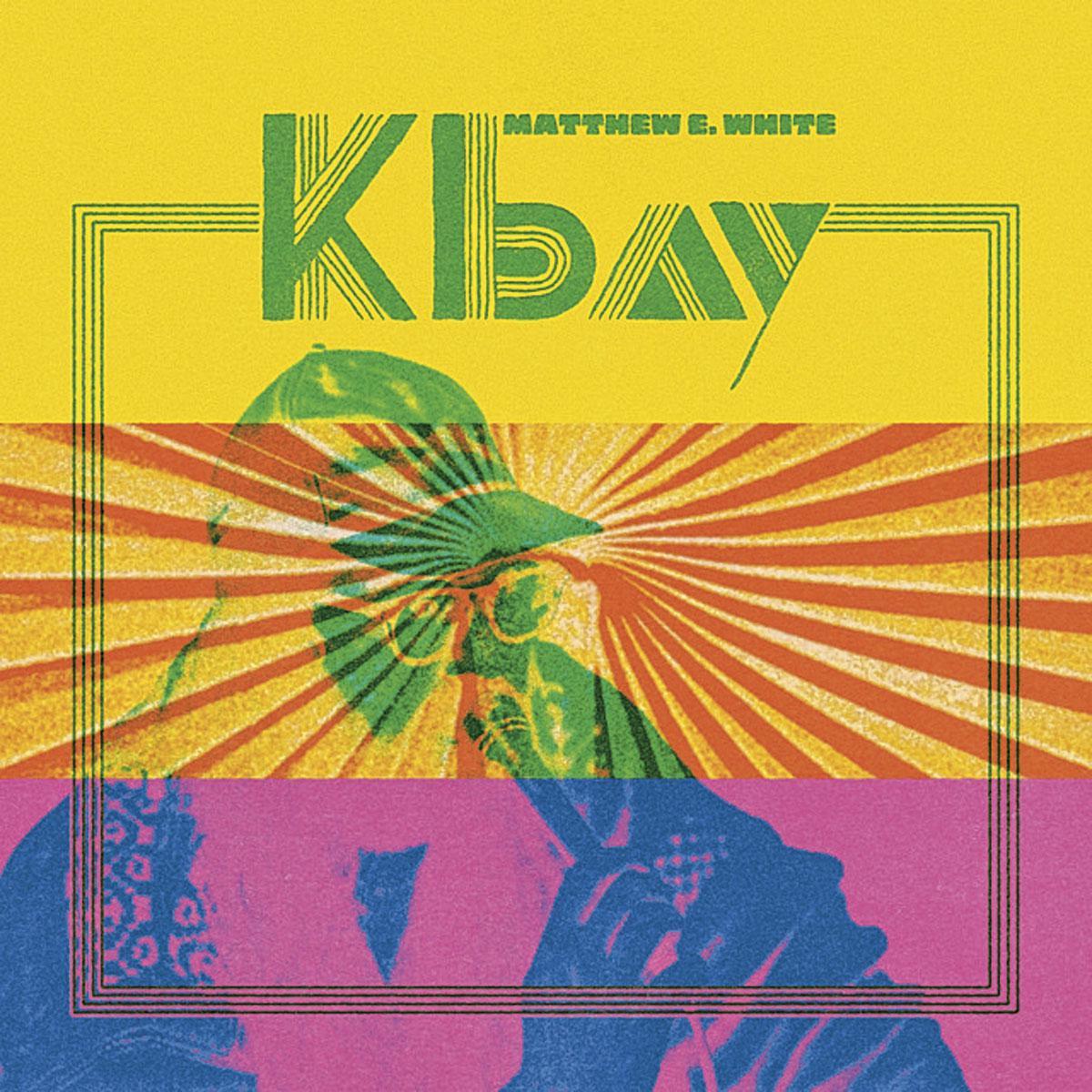
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici