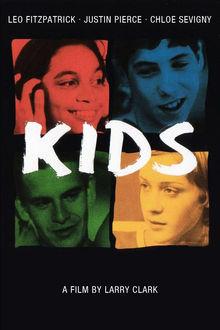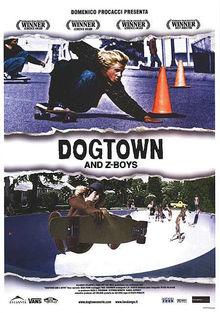Bandes à part (6/7) : le skateboard, planche de salut

Popularisé par des surfeurs cherchant à occuper leurs journées sans vagues, le skateboard a inventé une contre-culture urbaine et bétonnée de la glisse, repensé l’architecture et accéléré le punk. De l’écume au bitume, récit en roue libre.
Purs produits de la société des loisirs et de divers mouvements menés par les baby-boomers et leurs rejetons, les sports de glisse se sont développés au fil des décennies dans le sillage de la beat generation, du mouvement hippie, du punk et du hip hop. L’histoire de la culture skate est celle d’une guérilla contre le mainstream avec pour principales armes une planche à roulettes, une farouche volonté d’indépendance, le goût de l’improvisation et un esprit résolument Do It Yourself.
Roulez jeunesse. A la fin des années 30, le patin à roulettes et la trottinette sont déjà à la mode. Le premier, inventé vers 1760 à… Huy par Jean-Joseph Merlin, est un jouet bon marché. Mais la seconde, aujourd’hui avec la barbe et le bonnet dans la panoplie de tout hipster qui se respecte (ou pas), se veut alors plus sophistiquée et forcément coûteuse. Les gosses fauchés et/ou bricoleurs prennent leur divertissement et leur destin en main et se mettent à fabriquer les leurs. Ils coupent leurs patins en deux, clouent chacune des parties aux extrémités d’une planche en bois et y ajoutent un guidon fixé sur un cageot. En abandonnant leur « gouvernail », ils donneront naissance aux premiers skateboards, aussi rudimentaires soient-ils.

En 1956, Humco devient la première marque à les produire industriellement et trois ans plus tard, les Roller Derby manufacturés en série et vendus 1,99 dollar apparaissent sur le marché. La « sidewalk surfboard », comprenez « la planche à surfer les trottoirs », devient de plus en plus populaire mais reste encore considérée comme un jouet. Pas mal de surfeurs y voient une sympathique alternative à une journée sans vagues. Ils découpent leurs planches en forme de mini surfs dans du chêne massif et s’en vont glisser sur le bitume quand l’océan se fait récalcitrant. Au milieu des sixties, les skateboards se vendent par millions. Le best-seller, le Hobie Super Surfer, coûte 20 dollars. Des compétitions sont organisées. Des marques en tous genres financent leurs équipes. Les premières chaussures apparaissent (avant ça, on skate souvent pieds nus) et les Jan and Dean chantent Sidewalk Surfin’.
Le raz-de-marée fait long feu. Les associations de médecins s’érigent contre le nombre croissant de bras cassés. Considéré comme périlleux, le skate, du moins sa pratique, est interdit dans une vingtaine de villes des Etats-Unis. Les riverains et les piétons se plaignent de cette nouvelle nuisance. Et d’un autre côté, le matériel reste de mauvaise qualité. Ce qui accentue sa dangerosité et rend toute forme de progression particulièrement compliquée. Proche de la Nouvelle Vague, le Québécois Claude Jutra signe à l’époque un court métrage de fiction documentaire, Rouli-Roulant (le mot pour « skateboard » au pays de la poutine et du caribou), faisant écho aux Quatre cents coups de Truffaut et épinglant avant les autres la formation d’une nouvelle culture jeune. « Quel est donc ce mal qui se propage de ville en ville, qui traque les populations, les paralyse et les affole? » questionne-t-il moqueur. Le réalisateur canadien, qui dédie son film à toutes les victimes de l’intolérance, rigole de cette invasion, de ce fléau, de cette fureur, de cette nouvelle apocalypse… Il montre les gamins chassés des lieux publics par des flics qui leur confisquent leurs montures et ne les leur restituent que s’ils acceptent de s’enfermer dans des gymnases désespérément plats pour pratiquer leur activité « en toute sécurité ».
Le skate est mort. Vive le skate! C’est dans la banlieue de Los Angeles qu’il faut aller chercher la suite d’une histoire désormais rangée du côté de la marginalité.
Artefacts

Skaterdater (1965)
Grand prix du court métrage au vingtième festival de Cannes, c’est a priori le premier film s’intéressant d’aussi près à la « culture » skate. Et ce pratiquement dix ans avant l’essor du skateboard moderne même si les championnats nationaux passaient déjà à la télévision. Noel Black y suit les pérégrinations de sept skateurs préadolescents dans une petite ville côtière des Etats-Unis. Premiers émois amoureux. Deux jeunes équilibristes s’y défient sur leur planche sous le soleil californien pour gagner les faveurs d’une petite blonde. Dépourvu de dialogues mais accompagné d’une bande son surf composée par Mike Curb, futur fondateur de Curb Records et lieutenant gouverneur (républicain) de Californie, Skaterdater a la planche juvénile et le charme suranné.
Join the army (1987)
« Beware he’s possessed to skate!/Skating takes him up in height/He’s a pilot on a modern flight/See him flying through the air/If he don’t land then he don’t care. » Avec Possessed to Skate, extrait d’un album, Join the Army, qui fait la jonction entre rock hardcore et thrash metal, Suicidal Tendencies signe l’un des hymnes de la planche à roulettes. Emmenés par Mike Muir, frère de Jim (Z-Boy qui deviendra propriétaire de la marque de skateboard Dogtown fin des années 80), les mecs de Venice qui s’en prennent avec férocité à toute forme d’autorité parlent dès leur premier album en 1983 aux skateurs californiens. On créera même un sous-genre musical, le skatecore, qui leur sera quasiment réservé.
Kids (1995)
Cri d’alarme sur la situation de la jeunesse au début des années 90, le premier long métrage de Larry Clark plonge dans le quotidien chaotique de skateurs new-yorkais. Si Telly aime la planche à roulettes, son sport favori est de dépuceler ses conquêtes. Ce qui, pense-t-il, le met à l’abri de toutes les maladies. Dialogues crus, scènes de cul, de viol, de bastonnade et de vol, Clark (qui batifolera encore avec la culture skate dans Ken Park, Wassup Rockers et The Smell of Us) impose d’emblée son regard singulier sur l’adolescence. Pour son film, il s’est inspiré d’une bande de skateurs de Manhattan qu’il a reconvertis en acteurs le temps du tournage. Deux d’entre eux ont disparu depuis. Justin Pierce s’est suicidé par pendaison en 2000 et Harold Hunter est mort d’une crise cardiaque due à sa consommation de cocaïne en 2006.
Tony Hawk’s Skateboarding (1999)
Considéré comme l’un des meilleurs skateurs de tous les temps, Tony Hawk est aussi l’un de ses plus grands businessmen. Cascadeur qui a tenu des petits rôles au cinéma et à la télévision, le premier homme à avoir effectué un 900 (une rotation de deux tours et demi en l’air) a donné dès 1999 son nom à un jeu vidéo de simulation. Univers urbain, ambiance rock (Dead Kennedys, Primus, Suicidal Tendencies) et hip hop… S’il n’est pas le premier des jeux de skateboard apparus sur le marché, Tony Hawk s’est vendu dans ses différentes versions à plusieurs millions d’exemplaires et a contribué à un regain d’intérêt pour le skate. Le natif de San Diego surnommé l’Homme-Oiseau a encore démocratisé ce qui restait alors une contre-culture.
« 200 ans de technologies américaines ont involontairement créé une aire de jeu de béton d’un potentiel illimité. Mais ce sont des jeunes de onze ans qui en ont perçu le potentiel. » Réalisé par Stacy Peralta, l’une des premières stars adolescentes du skateboard dans les années 70, coécrit par Craig Stecyk, qui accéléra en tant que photojournaliste l’essor de la planche à roulettes, et narré par Sean Penn, Dogtown and Z-Boys raconte les précurseurs du skateboard moderne. Montage serré, images vidéo et photos des années 70, interviews de ces héros de la glisse devenus depuis adultes qui se remémorent leurs heures de gloire et leurs cache-cache avec la police pour skater illégalement dans les piscines de Los Angeles… Un docu excitant et jouissif.
This ain’t California (2012)
Formidable et surprenant objet documentaire que ce This Ain’t California réalisé par l’Allemand Marten Persiel. A travers le destin de Denis Panik Paracek, ado programmé pour devenir champion de natation qui s’évade sur des planches à roulettes artisanales, Persiel raconte le skate dans les rues tristes de Magdeburg et les paysages froids, bétonnés et rectilignes de Berlin. Une bande de gamins en quête de liberté dans une Allemagne coupée par le Mur. Utilisant des photos et des reportages de l’époque communiste, des scènes reconstituées (le skateboarder et mannequin Kai Hillebrand incarne notre héros) et des montages d’animation, This Ain’t California partage le quotidien d’une jeunesse sous surveillance dans une RDA où il est mal vu d’utiliser la rue comme terrain de jeu.
Locals only
A Santa Monica, comme dans beaucoup d’autres villes, une frontière économique découpe le paysage urbain. D’un côté il y a les quartiers bourges et friqués et de l’autre il y a ceux qui en rêvent. Une communauté centrée sur l’art, la culture et le divertissement s’était développée en bord d’océan, une espèce de Coney Island de l’Ouest avec son parc d’attraction et ses jeux aquatiques. Mais tout s’est mis à foirer dans les années 60 et les lieux sont devenus miteux. Pacific Ocean Park a fermé en 1967 pour devenir un no man’s land. Le rendez-vous des pyromanes, junkies, clochards, artistes et surfeurs.
La jetée abrite The Cove (« la crique »). Les adeptes de la glisse y slaloment entre les piliers, les carcasses de manège rouillés et les débris dans l’un des spots les plus dangereux du monde. « Locals only », agresse un graffiti. Les habitués repoussent physiquement le curieux et le téméraire à jets de pierres, de verre et de bières… The Cove n’est pas le genre de plage cosy où l’on s’en va passer ses vacances. C’est plutôt la décharge qui rencontre l’océan. Un taudis de bord de mer. Sale. Crasseux. Délabré. Sable et vague d’accueil pour des surfers alors parias.
L’un d’eux, Jeff Ho ouvre un magasin au coeur de Santa Monica. Une boutique spécialisée, Jeff Ho Surfboards and Zephyr Productions, où il repousse avec un sérieux d’ingénieur les limites du design. Influencé par l’art mural des gangs locaux et les couleurs de la culture automobile de la région, Craig Stecyk, l’intellectuel de la bande, leur donne le ton des quartiers multiculturels qui les entourent.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Tributaires des vagues, les gamins en quête de sensations fortes trouvent avec le skate, d’abord leur moyen de transport, de quoi occuper leurs journées. Ils usent leurs roues sur les plans inclinés qui bordent les cours de certaines écoles à flanc de collines et transcrivent à même le béton les mouvements qu’ils ont l’habitude d’effectuer sur l’eau. Summum du cool, les Z-Boys comme on les appelle sont aussi provocateurs et arrogants sur la flotte déchaînée que sur leurs skateboards et cultivent un style particulier hérité du surf, comme leur image de vilains garnements.
Piscines, walkmen et VHS
Même si les skateparks sont apparus très tôt, dès 1965, à Tucson, dans l’Arizona, et se sont généralisés dix ans plus tard après la mort d’un jeune skateur renversé par une bagnole, aucune tribu de jeunes ne s’est jusqu’ici dans l’histoire autant approprié son environnement, l’espace public et le paysage architectural que les adeptes de la planche à roulettes. Dans les années 70, les skateurs exploitent tout ce que leur offre l’urbanisme: bancs, escaliers, poubelles, bornes à incendie. « Les skateurs sont par nature des guérilleros urbains, note Craig Stecyk. Ils utilisent les objets inutiles du fardeau technologique et emploient l’oeuvre de la structure du gouvernement/entreprise de mille façons dont les architectes originaux n’auraient jamais pu rêver. » Ces jeunes têtes brûlées en apportent la plus spectaculaire illustration pendant la pire sécheresse que connaît la Californie.

Milieu des seventies, la pluie se fait tellement rare sur la côte ouest qu’il est interdit d’arroser son jardin et de servir automatiquement de l’eau dans les restaurants. Les piscines se vident. Avec leurs parois courbes, elles vont devenir le terrain de jeu favori des Z-Boys. Pour goûter aux sensations illicites du skate en swimming pool, les vilains garnements recherchent dans les agences immobilières l’adresse de riches maisons inhabitées, font du repérage en descendant le canyon avec des jumelles ou arpentent les ruelles debout sur le toit de leur voiture, épiant au-dessus des murs et palissades. Equipés, ils se promènent avec des pompes, des tuyaux de drainage et des balais… Nettoyant leur aire de jeu pour mieux réinventer l’art de la glisse en attendant l’arrivée, souvent rapide, de la police.
Personne n’est aussi agressif et radical sur sa planche à roulettes que ces gamins, mioches pour la plupart issus de foyers désunis, qui font de l’art sur les ruines encore fraîches du XXe siècle. Les Zéphyrs révolutionnent la discipline et s’ils l’érigent au rang de contre-culture, c’est grâce notamment aux articles de Craig Stecyk dans les colonnes du magazine Skateboarder. Les Zéphyrs sont rapidement récupérés par les grandes marques. L’équipe se dissout et le maga ferme en 1976. Mais le bonhomme devenu photojournaliste a déjà eu le temps de tracer l’attitude et l’esthétique libres et radicales, illégales s’il le fallait, qui allaient définir le skate moderne. Skate que Stecyk avait compris avant les autres comme un prolongement de la société.
Jay « The Original Seed » Adams (mort il y a quelques années d’une crise cardiaque) incarne plus que tout autre ce sentiment de liberté. Comme le fougueux Tony Alva, « Chuck Berry du skate », qui tourna le dos aux grosses marques pour créer sa propre compagnie à 19 ans. Image de rock star, comportement rebelle. Le skateboard devient l’accessoire d’une attitude.
Si des magazines américains comme Thrasher (1981) érigent clairement des ponts entre le skateboard et la musique, la culture skate doit beaucoup aux walkmen, aux magnétoscopes et aux cassettes, qu’elles soient audio ou VHS. Ils l’aident à définir son identité, lui permettent de contourner les systèmes de distribution traditionnels et d’affirmer son indépendance vis-à-vis de la télévision et du cinéma.
« Le meilleur exemple de fusion d’un genre musical et d’un sport de glisse vient de la rencontre du punk et du skate au tournant des années 70 et 80, explique Christophe Perez dans son ouvrage Surf, Skate and Snow.Le punk parle directement aux skateurs qui trouvent dans son énergie brute et sa cadence un alter ego musical à leur sport. Certains deviennent des groupes influents et des modèles du genre: Big Boys à Austin, Hüsker Dü à Minneapolis, Bad Brains et Minor Threat à Washington DC… » Liste interminable en tête de laquelle figurent assurément un Black Flag et un Suicidal Tendencies.
D’Henry Rollins à Ed Templeton
Influencés par les bandes-son des vidéos de skate (« clips » qui servent à promouvoir une marque, son esthétique et ses codes sur lesquels par exemple un Spike Jonze s’est fait les dents), les goûts de la communauté se sont diversifiés au fil des années. Le skate punk, le punk hardcore dont il est un dérivé et le thrash metal ont fait de la place au hip hop (appartenant comme lui à la street culture américaine et marqué par un fort esprit de contestation sociale) et dans une moindre mesure au jazz, à la new wave, aux musiques électroniques et au rock indé…
« Tous les gens qu’on trouvait dans les skateparks étaient des excentriques, des phénomènes de foire et des exclus« , déclare dans le bouquin de Perez l’introverti Tony Hawk au sujet des années 80. Créateurs dans l’âme comme les surfeurs et les snowboardeurs, certains skateurs ont lancé leurs marques de matériel de glisse et de vêtements. D’autres ont publié des magazines et fanzines ou sont devenus graphistes, vidéastes, photographes… Nombre d’entre eux, amateurs et professionnels, ont aussi créé leur groupe. D’Henry Rollins (Black Flag) à Ian MacKaye (Minor Threat, Fugazi) en passant par les Beastie Boys ou plus récemment les Odd Future, on ne compte plus les rockeurs et rappeurs ayant fait leur éducation musicale autour de leur planche à roulettes.
Les cultures de la glisse ont aussi enfanté le support d’un art prolifique dont les origines sont à aller chercher dans les années 50 du côté de la Kustom Kulture, de Kenny Howard, de la customisation de choppers et de voitures anciennes… Certaines planches sont aujourd’hui considérées comme des chefs-d’oeuvre et font l’objet de collections. Dans les années 90 marquées par une explosion des styles et des genres, elles se transforment en éléments de provocation et de dérision. Supports d’un art outsider et éphémère abîmé par la pratique. Ces mêmes années 90 (dont Ray Pettibon, Jim Shaw et Mike Kelley étaient les pionniers) ont réinventé le skate, en guerre contre la morale et le politiquement correct, et ont étendu son influence sur la culture, la mode et l’art. Certains mouvements artistiques initiés par les chevaliers du bitume sont d’ailleurs passés dans les années 2000 de l’underground au musée notamment grâce à un Ed Templeton. Mais ça, c’est encore une tout autre histoire…
L’ASBL CLIC JEUNES QUI PROGRAMMAIT RÉCEMMENT DOGTOWN AND Z-BOYS AU SKATE PARK DE COINTE (LIÈGE) Y DIFFUSERA LE MERCREDI 24 AOÛT VERS 22H LE DOCUMENTAIRE DANGER DAVE DE PHILIPPE PETIT.
Décryptage

1. Les cheveux longs
Héritage de son grand frère le surfeur, quand il n’a pas lui aussi le pied marin à ses heures perdues, le skateur a dans les années 70 la chevelure abondante et grasse. Symbole de liberté, de rébellion contre les normes culturelles et sociales, cette habitude du poil long s’est depuis longtemps perdue.
2. Les protections
Ils ne serviraient à rien, sentiraient mauvais, entraveraient les mouvements et indiqueraient la médiocrité de ceux qui les portent. Les genouillères, les gants et les coudières n’ont pas vraiment la cote auprès des skateurs frimeurs d’aujourd’hui mais rappellent que la planche à roulettes est un sport. Un sport « dangereux »qui, à l’instar du surf, sera en 2020 au programme des Jeux Olympiques de Tokyo.
3. Le short
Vêtements amples, pantalon baggy et sweat à capuche (influence hip hop et silhouette XXL) ou futal skinny et tenues moulantes (merci au rock’n’roll et au punk): difficile de nos jours d’identifier un skateur à son look. Pendant les seventies, le vrai glisse souvent en short et à moitié dévêtu. Ça permet de bronzer et de pas niquer ses fringues. Californian style…
4. Les chaussettes hautes
Symbole de haut statut social jusqu’au Moyen Âge (elles demeurent longtemps l’apanage des classes aisées), les chaussettes chez les skateurs se portent longues, blanches, hautes et solides.
5. Les baskets
Si les skateurs des débuts roulent souvent pieds nus, la Randy 720 est en 1965 la première godasse spécifiquement conçue pour le marché du skateboard. Sa semelle très souple est inspirée de la chaussure nautique. Les baskets pour skateurs se doivent d’adhérer au mieux à la planche.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici